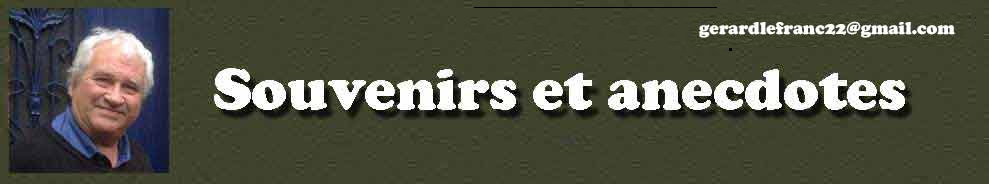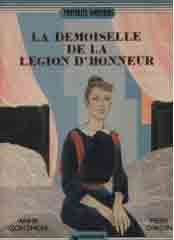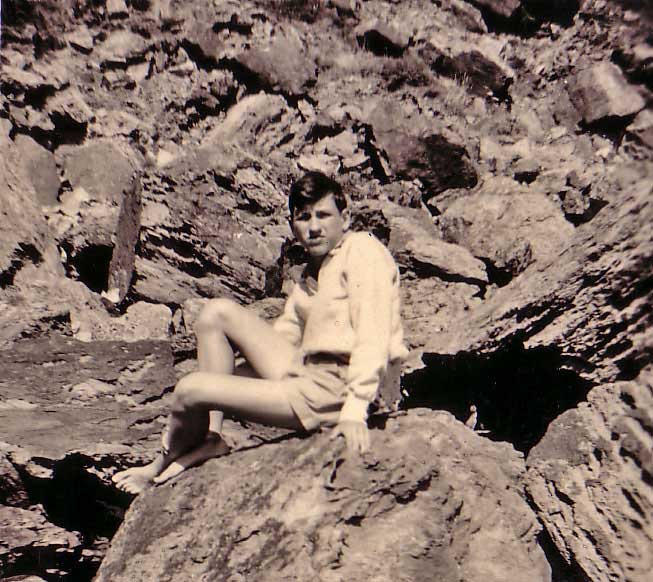Quelques souvenirs de famille
Mis
à jour le 26 août 2024
Allons y
J'ai essayé de transcrire ici quelques anecdotes qui revenaient souvent dans les histoires que racontaient mes parents. Un peu de tout, mais ce serait dommage que cela disparaisse avec moi ou les rares personnes qui s'en souviennent encore un peu. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les confier pour augmenter cette page.
Pour vous y retrouver un peu vous pouvez consulter mon site de généalogie ici.
J'ai également trouvé intéressant de reproduire, sur une page à part, des lettres que j'avais envoyées à mes parents lorsque j'étais enfant ou encore jeune homme. Ma mère les ayant dactylographiées avec soin, il ne m'a pas été trop difficile de les transcrire. Ce sont des souvenirs parfois très personnels mais qui constituent un témoignage vécu d'une époque révolue dont les détails ont vite été oubliés: découverte de la Bourgogne et du Jura en 1946 - 48, l'Angleterre et l'Italie des années 52 - 54 vues à travers les yeux d'un gamin de 13 - 14 ans, l'Espagne franquiste et le Portugal de Salazar en 1954 -55, l'Algérie en 1958, du temps où elle se voulait encore française.
Le garçon bien éduqué et encore
assez naïf que j'étais, s'est trouvé parfois confronté, pour
la première fois de sa vie, à des choses pas bien ragoutantes:
corruption, colonialisme, racisme, mépris et il a réagi avec
beaucoup de fraîcheur et une franchise totale (mais il
s'agissait de lettres destinées à mes parents et non destinées
à être publiées). Maintenant, il y largement prescription.
J'ai toutefois estimé nécesssaire d'y ajouter quelques
commentaires (en italique) pour replacer ces écrits dans leur
contexte.
C'est vu naïvement, par le petit
bout de la lorgnette et pour ceux que ça tenterait ça se
trouve sous ce
lien.
C'était encore au bon vieux temps
Lorsque grand'mère Simon s'est
mariée on lui a offert un appareil de photos et le nécessaire
pour les développer elle-même (car les laboratoires
n'existaient pas encore). N'oublions pas que Chalon-sur-Saône
était la ville de Nicéphore Niepce, l'inventeur de la
photographie.
Grand'mère a photographié toute sa vie et laissé plusieurs
albums bien remplis de photos qui sont autant de témoignages
de la vie de la famille Simon, même si une bonne partie des
visages ne peuvent plus être identifiés par les survivants,
qui sont hélas de moins en moins nombreux. Grand'mère datait
toutes ses photos mais ne les titrait que rarement. Les
personnes photographiées étaient sensées être connues de tous.
Mais l'oubli est un mal puissant et rapide.
Si vous pouvez m'aider, ce serait vraiment bien de pouvoir faire revivre tous ces gens, avec un nom à eux. J'ai scanné un grand nombre de ces photos et les ai regroupées sur un DVD pour qui est intéressé. Je possède également deux grands cartons remplis de négatifs en bon état, qui ne demandent qu'à être tirés.

Mis à part le monsieur à
moustaches et la dame en noir au fond, qui sont les parents de
Sophie, mes arrière-arrière-grands-parents donc, je ne suis
capable d'identifier personne avec certitude mais je crois
reconnaître mon grand-père à califourchon sur le banc) et ses
sœurs Henriette et Joséphine sur sa droite.
C'est la plus ancienne
photo de ma famille maternelle qui ait été conservée: toute
la famille et quelques amis à Chalon-sur-Saône vers 1895,
sous la protection de mon arrière-grand-père Jean-François
Simon (au milieu du dernier rang), avec mon grand-père
encore jeune homme devant lui. Une cousine plus âgée que moi
a pu identifier presque tout le monde. Cela fait un point de
départ.

Les Simon de Chalon ont
d'ailleurs toujours été avides de progrès techniques. La
distillerie a eu très tôt un numéro de téléphone (le numéro
29). Leur maison a été l'une des première de la ville à être
éclairée à l'électricité, alors que la plupart des autres
s'éclairaient encore au gaz, ou avec des lampes à pétrole.
D'après les gens ayant connu ces modes d'éclairage, c'est
encore le gaz qui fournissait la meilleure lumière, plus
forte et plus vive que les anciennes ampoules électriques;
mais c'était en train de passer de mode et il faut bien
vivre avec son temps, n'est-ce-pas? Entre les deux guerres,
grand-mère avait acheté une caméra "Pathé-baby" avec
laquelle elle a filmé plusieurs événement familiaux et des
vues de vacances. Je ne sais ce que sont devenus ces films,
que j'ai vus dans mon enfance et il est peu probable que le
projecteur, s'il est retrouvé, fonctionne encore. De plus
les films, s'ils ont été conservés, sont certainement
devenus très fragiles et presque impossibles à manipuler.
C'est bien dommage. C'est également à Chalon que j'ai
entendu mon premier micro-sillon, dans les années 50: il
s'agissait de la symphonie pastorale, sur un seul disque (je
ne sais pas si vous vous rendez compte?) et presque sans
bruits de fond. La Hi Fi quoi! Quoique... Papa prétendit
avoir entendu parler de haute fidélité toute sa vie, depuis
les premiers gramophones à rouleau jusqu'aux chaînes les
plus récentes, sans jamais avoir retrouvé ne serait-ce que
l'illusion de la réalité.
Il me revient soudain un
souvenir de gramophone. C'était à Ruffiac. Un voisin de mes
grands-parents avait déniché une réclame dans une revue (on ne
parlait pas encore de publicité) promettant l'envoi d'un
phonographe gratuit à qui en ferait la demande. Cela semblait
trop beau pour être vrai et personne ne voulait se ridiculiser
en écrivant à l'adresse indiquée. Une personne plus hardie
finit par s'y risquer et, contre toute attente, le phonographe
lui fut livré, avec un unique rouleau sur lequel était
enregistrée la Marseillaise. Bien entendu les rouleaux que
l'on pouvait déjà trouver dans le commerce n'étaient pas
compatibles avec l'appareil et, pour en avoir d'autres, il
fallait débourser.
Un peu vexé, le propriétaire du phonographe ne commanda jamais
d'autres rouleaux mais chaque année, au passage de la
procession de la Fête-Dieu devant sa maison, tout le monde
pouvait entendre une nasillarde mais énergique Marseillaise
s'échappant de ses fenêtres grand ouvertes.

cette ancienne publicité prouve qu'il
ne s'agit pas d'un cas isolé
Retour à la table des matières
Car la procession de la Fête-Dieu était une institution incontournable. Chaque quartier de Ruffiac édifiait son reposoir et la compétition était rude à qui aurait le plus beau, le plus grand le plus étonnant. La palme serait revenue une année à celui du quartier de mes grands-parents qui non seulement était imposant mais en plus animé. Ma tante Yvonne, la plus jeune sœur de papa y trônait habillée en ange, avec les ailes qui battaient et, comble de merveille, il y avait derrière elle un jet d'eau qui jaillissait de façon sporadique, sous la pression d'un couvercle de cabinets qu'un domestique s'efforçait d'enfoncer en cadence dans un seau plein d'eau. Le tout, bien entendu, au son de la Marseillaise. On en parle encore.

c'était quelques années plus tard...
Et puis les temps sont passés et
les processions en ville ont disparu. Une des dernière
processions de la Fête-Dieu dont je me souvienne passait
devant la maison où habitaient mes parents, rue du Mené à
Vannes. Il y avait du monde: le grand séminaire recrutait
encore à plein et mon jeune neveu Frédéric, penché à la
fenêtre, n'en revenait pas de voir passer tous ces gens en
aube blanche, chantant des cantiques. Alors il appela son
grand-père: "papi, papi,
viens voir: des druides!". Belle éducation
religieuse... mais influence certaine d'Astérix.
J'ai peu connu l'oncle Auguste,
frère aîné de mon grand-père Lefranc, mais son souvenir a
certainement marqué la famille, car c'était un personnage hors
du commun. Auguste Lefranc était prêtre. Au début de sa
carrière il aumônier à Lorient. On m'a raconté qu'on lui avait
fait cadeau d'un jeune faon dont la mère avait été abattue
lors d'une chasse à cours et qu'il a élevé au biberon. Le
personnage de ce prêtre en soutane promenant en laisse une
petite biche dans les rues de Lorient lui avait acquis dans
cette ville, au début du siècle, une célébrité certaine.
Il a ensuite été en charge de diverses paroisses, en
particulier comme curé de Rohan. Pendant la Grande Guerre, on
lui avait confié l'éducation de papa, mis en pension chez lui
pour palier aux difficultés de déplacement qui rendaient
l'accès au collège assez difficile. L'oncle Auguste n'avait
guère à enseigner que le latin et le grec mais il en a gavé
papa, au point qu'il ne supporta plus de rester à Rohan et
qu'après deux années passées chez son oncle on l'en retira
pour le mettre au Petit Séminaire de Ploërmel, relativement
proche de Ruffiac, où les messes à haute dose lui ont fait
perdre définitivement le peu de pratique religieuse qui lui
restait.
L'oncle Auguste acheva sa carrière comme curé de Malestroit,
avec le titre de chanoine honoraire. Il a laissé le souvenir
d'un homme extrêmement distrait. On raconte qu'un matin, alors
qu'il attendait quelques collègues pour le déjeuner, il sortit
pour marcher un peu et lire son bréviaire le long du canal. Il
se trouva tellement absorbé par ses pensées qu'il en oublia
ses invités, continua à marcher le long de la route et
téléphona à la nuit tombée pour qu'on vienne le rechercher...
à Vannes! (c'est ce qu'on prétend, en fait je pense plutôt
Redon, ce qui faisait tout de même une bonne trotte)
C'était le parrain de Albert Lefranc, un de ses neveux, qui
chaque année venait lui présenter ses vœux et se faire un
malin plaisir de consulter l'heure sur une belle montre de
gousset, en argent, qui attirait immanquablement l'attention
de son oncle:
- oui mon oncle.
- on te l'a offerte?
- mais oui mon oncle.
- eh bien on ne s'est pas moqué de toi. Et qui te l'a offerte?
- c'est vous mon oncle.
Chaque année ça marchait!
On raconte également - mais là il n'y est pour rien - que
devant recevoir à déjeuner l'évêque et quelques autres
chanoines, l'oncle Auguste avait fait venir tout exprès une
belle bourriche d'huîtres. Pendant que l'on préparait le repas
et que ses invités faisaient une petite promenade apéritive le
long du canal, un paroissien qui passait devant la cuisine du
presbytère vit la bonne du curé fort embarrassée avec les
huîtres, qu'elle voyait pour la première fois de sa vie. Il
s'offrit donc à l'aider et lui montrer ce qu'il convenait d'en
faire. Il part avec la bourriche et revient quelques instants
plus tard avec un monceau de coquilles d'huîtres vides, disant
à la bonne: "ces gens de la
ville ne savent vraiment pas vivre; te rends tu compte
qu'ils t'avaient livrées les huîtres sans même se donner le
mal de les vider?". La bonne remercia chaleureusement
son bienfaiteur, mais Monseigneur dût se contenter d'autre
chose que d'huîtres et se passa d'entrée.

une des rares photos que j'ai retrouvées de l'oncle Auguste,
sur la gauche, avec l'oncle Victor et papa, à Malestroit
Pour prendre sa retraite,
l'oncle Auguste se fit construire une maison sur les bords de
l'Oust, pour lui et sa sœur Marie qui, restée vieille fille,
vivait avec son frère et s'occupait de son intérieur. Il
confia à son vicaire, qui se piquait d'architecture, de lui en
dessiner les plans. Le vicaire oublia de prévoir un escalier:
erreur classique et bien connue des architectes (voir Flaubert
- Dictionnaire des idées reçues: "Architecte - oublie l'escalier"). Les plans
ne pouvant sans doute plus être modifiés, il fallu convaincre
le voisin de vendre un petit bout de terrain en pignon de la
maison pour édifier l'escalier. Il paraît que le voisin en
profita pour en exiger un prix exorbitant du mètre carré,
aussi se contenta t-on d'un escalier exigu par lequel la tante
Marie, qui était fort corpulente, ne put jamais passer,
laissant à son frère toute liberté pour vivre comme il
l'entendait à l'étage. Elle en était malade et les mauvaises
langues prétendent que cet état des choses était voulu et
provenait d'un arrangement de l'oncle avec son vicaire et le
voisin. C'est ma foi, le connaissant, bien possible mais
laissons le doute planer.
Cela n'empêcha tout de même pas la tante Marie de continuer à
rire: ses fous rires étaient légendaires et ses neveux se
faisaient un jeu de la faire rire à en perdre le souffle pour
le plaisir, je cite papa "de
voir son gros ventre sauter de joie".
Voici la notice que lui consacre le Dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine - par Jean-Marie Mayeur et Yves Marie:
Fils d'instituteur, d'une famille profondément
chrétienne, il fit ses études auCollège Stanislas de Ploermel
puis au Grand Séminaire de Vannes.
Avant même son ordination, en 1882. il enseignait déjà au
Petit Séminaide Ploërmel et prépara une licence en lettres.
Cependant, dès 1891, il fut orienté vers le ministère
paroissial, pour lequel il n'avait pas de spéciales aptitudes.
Vicaire à Rochefort-en-Terre, puis à Josselin, aumônier de la
Retraite de Lorient depuis 1898 jusqu'à l'expulsion des
religieuses, recteur de Pluherlin, en 1904, curé de Rohan de
1908 à 1919. Dans ces deux paroisses, il construisit une école
chrétienne. En 1919. il se retira à Malestroit, où il put
s'adonner librement à sa passion d'écrire.
Dès Ploërmel, il s'était essayé au théâtre avec deux drames
historiques: Clovis et Du Guesclin. Il publia aussi, en 1889,
ses Poèmes bibliques (P, 280 p.). Puis, il se lança dans une
œuvre historique Olivier de Clisson (P, 1898, 460 p.). qui a
plus de valeur qu'on ne l'a dit parfois. Un voyage en Terre
Sainte l'enchanta au point qu'il en parlait tout le temps. Il
lui inspira ses Vues et impressions d'Orient (Vannes, 1906) et
un roman biblique Marie de Magdala (P. 1912) qu'il dut retirer
du commerce *. Un autre
livre de poèmes: De l'Univers à Dieu (P, 1920) avait déjà une
orientation apologétique. Il écrivit aussi un petit ouvrage
pour défendre L'évènement de Pontmain (P, 1923). Son
Apologétique nouvelle (P, 1936) est un florilège cueilli dans
les œuvres des grands auteurs chrétiens.
Esprit éminemment curieux, l'abbé Lefranc. s'intéressait aussi
aux découvertes archéologiques et aux inventions
scientifiques. Il fut des premiers à utiliser pour son
ministère, d'abord la bicyclette, puis la motocyclette et
enfin l'automobile. Avec un poste à galène de sa fabrication,
il avait appris avant tout le monde la Mobilisation de 1914.
Chanoine honoraire depuis 1912, il fut aussi pendant 30 ans
président des Anciens élèves du Petit Séminaire de Ploërmel où
ses distractions étaient devenues légendaires.
* Dans ce roman, que j'ai lu
étant jeune, il laissait entendre à mots couverts qu'il y
aurait pu avoir une liaison amoureuse entre Jésus et
Marie-Madeleine. L'ouvrage fut mis à l'index et Auguste
Lefranc préféra le retirer de la vente.
La jument qui n'aimait pas les coiffes
Grand-père Lefranc, qui était
grossiste en grains, avait besoin de chevaux pour tirer les
lourds chariots qui, au début de 20ème siècle, faisaient
office de camions. Il a donc eu, un temps, une puissante
jument qui était parfaite, à un petit détail près: elle ne
supportait pas de voir une coiffe... allez savoir pourquoi? Ce
trait de caractère, à une époque où toutes les femmes, dans la
campagne bretonne, portaient une coiffe était parfois la cause
de petits problèmes.
Grand-père, sa nombreuse famille et les domestiques,
habitaient sur la place centrale de Ruffiac, dans le Morbihan,
une vaste maison bâtie autour d'une cour à laquelle on
accédait par un porche. Les écuries se trouvaient sur un côté
de ce porche avec lequel elles communiquaient par une porte en
deux parties, haute et basse, le vantail supérieur étant
souvent laissé ouvert pour une meilleure ventilation.
C'est également sur cette place que se tenait le marché
hebdomadaire et il arrivait parfois qu'une acheteuse des
environs, prise d'un besoin pressant, choisisse de venir se
soulager sous le porche, ignorant la présence de la fameuse
jument; c'était l'erreur fatale.
Alors que la brave dame était accroupie, au pied de la porte
des écuries, la jument passait la tête par curiosité et, à la
vue de la coiffe là, juste sous son museau, elle n'hésitait
pas un seul instant et d'un vigoureux coup de mâchoire elle
arrachait prestement la coiffe intempestive... avec une belle
poignée de cheveux pour faire bonne mesure.
Tout Ruffiac, évidemment, était au courant aussi, lorsque le
jour du marché on voyait surgir du fameux porche une femme
hurlant, sans coiffe et rajustant ses jupons, chacun de
commenter avec un petit sourire: "encore une qui ne savait pas qu'il ne faut jamais,
au grand jamais, se soulager sous le porche du père
Lefranc!"
Papa m'a relaté que son père lui avait dit avoir, dans sa jeunesse, joué à la soule. Ce très ancien jeu, bien qu'interdit depuis 1369 à cause d'excès de violence, avait perduré dans nos campagnes et, en particulier en Bretagne, jusque dans les permières années du XXè siècle. Le principe était simple. Dans notre région il opposait, généralement une fois l'an, les hommes de deux communes voisines; tous étaient requis dans la mesure de leurs moyens. Tous les coups étant permis, la gens féminine se contentait d'observer (et parfois de soutenir par des actions "stratégiques").
Selon ce que papa m'en a
dit, une grosse balle de cuir rembourrée de foin était
placée au pied de l'église d'une commune proche. Le curé, en
général, ou le maire selon sa vigueur, donnait le coup
d'envoi d'un bon coup de pied. Après quoi l'enjeu était
d'amener ladite balle sur le territoire de sa commune, par
n'importe quel moyen, loyal ou déloyal, par force ou par
ruse. La partie pouvait durer plusieurs jours. Elle ne
cessait que lorsque la balle avait pénétré sur le sol de la
commune d'une des deux équipes en lice. C'était viril, mais
c'était un bon défouloir et bien des tensions entre voisins
s'en trouvaient apaisées. On ripaillait ensuite.
Maman m'a parlé à plusieurs reprises d'une grand'tante à elle qui aurait vécu jusqu'à l'âge avancé de 103 ans. Il faut croire que l'on a chez nous un gêne de longévité puisque je compte, tant dans mes familles paternelle que maternelle, par moins de 3 centenaires et au moins 7 personnes ayant dépassé les 90 ans (et ce en un temps où ce genre de choses était bien moins fréquent que de nos jours), sans compter les vivants.

Ma tante Madeleine le jour
de ses 100 ans
Bref, ce personnage a vécu fort
longtemps. Si c'est quelqu'un de la famille Simon il ne peut
s'agit que de Marianne Simon (épouse Christophe), sœur unique
de Jean-François Simon Aîné.
Elle était restée jusqu'à la fin en pleine forme, au point que
s'étant cassé le col du fémur par une chute dans l'escalier,
alors qu'elle était déjà centenaire, elle s'en serait
parfaitement remise et, quelques mois plus tard, était capable
de remonter seule à l'étage. Je dois préciser que les
prothèses de fémur ne se posaient pas à cette époque et que,
par conséquent, seule sa robuste nature avait pu la soigner.
À sa mort, maman me dit qu'elle avait encore toute sa tête et
que sa seule lubie était d'avoir acquis avec l'âge un goût
immodéré pour les sucreries, à tel point qu'il avait fallu
placer les sucriers de la maison sous clef.
Toujours d'après maman, sa grand'tante étant jeune fille
aurait passé plusieurs années de sa vie à Saint-Petersbourg,
dans une noble famille russe, comme préceptrice et demoiselle
de compagnie, en un temps où toute la noblesse de Russie se
piquait de ne parler que le français. Impressionné et pour
tester les connaissances que l'école m'avait enseignées,
j'avais demandé à maman "mais
alors la tante, elle a connu Raspoutine?". La réponse de maman avait été sans
appel: "Raspoutine, mais
réfléchis donc un peu, elle était bien trop vieille à
l'époque de Raspoutine!". Cette réponse m'a laissé
songeur. Les générations se télescopent parfois de façon bien
étrange. Notre vieille bonne Mathurine, dont je parle plus
loin, ne m'a t-elle pas dit qu'elle avait entendu le soir à la
veillée, étant toute gamine, des vieillards raconter leurs
souvenirs de la retraite de Russie? Ils avaient été engagés
très jeunes dans les armées de Napoléon et vivaient encore en
cette fin du 19ème siècle. Je regrette de ne pas avoir un peu
plus interrogé Mathurine, qui n'était guère bavarde: j'aurais
eu des informations presque de première main sur l'histoire
napoléonienne. Mais les enfants, quoi qu'on dise, ne sont
guère curieux. Ou alors c'est au hasard de conversations. Je
me souviens avoir demandé un jour à papa: "ça date de quand les
moquettes?" Papa m'avait appris que les premières
moquettes, du moins sous ce vocable, étaient arrivé après
1945. Il y avait bien eu, entre les deux guerres, quelques
revêtements de sol de ce genre mais ils étaient appelés "tapis
cloués" et considérés avec un certain mépris comme étant juste
bons pour cacher des parquets abîmés.
Maman m'a plusieurs fois raconté
que son grand-père, Jean-François SIMON avait eu une
secrétaire qui avait vingt frères! Elle était la seule fille
d'une famille de 21 enfants, tous de la même mère et ne
comportant pas de jumeaux. Tiens, cela me rappelle un ami qui
me disait n'avoir jamais connu sa mère autrement qu'enceinte
et avec un marmot dans les bras. Mais tout de même,
vingt-et-un...
Mon arrière-grand'mère Coudray était restée veuve assez jeune, avec une seule petite fille: Marie-Louise, ma future grand'mère Simon. J'ai entendu dire que Marie-Louise était sujette, dans son enfance, à des crises de somnambulisme. On l'avait admise en pension chez les Demoiselles de la Légion d'Honneur à Saint-Denis et l'on raconte qu'on l'a trouvée un matin, couchée dans son lit, toute habillée de son uniforme, qu'elle avait bien entendu quitté pour aller dormir. On n'a jamais su comment Marie-Louise avait pu mettre cet uniforme, qui comportait (et je crois comporte encore) de larges rubans noués dans le dos, qu'une personne seule ne peut absolument pas attacher sans aide.
Mais là n'est pas le propos.
L'arrière-grand'mère, donc, tenait un café au 55 boulevard
Saint-Martin à Paris (adresse indiquée sur son l'acte de décès
de son époux, en 1899). Les affaires marchaient bien. On m'a
raconté que les garçons de cafés faisaient la queue chaque
matin à sa porte pour être embauchés (car on les embauchait à
la journée et ils n'étaient payés que de leurs seuls
pourboires). La nuit venue, à la fermeture (tardive) de
l'établissement, l'arrière-grand-mère remontait dans son
appartement, qui était à l'étage mais sans accès direct depuis
le café, avec la caisse de la journée. On lui avait dit bien
souvent que c'était dangereux, pour une femme, de transporter
seule de grosses sommes d'argent dans un escalier ouvert à
tous; mais elle ne tenait pas compte de ces conseils.

mon arrière-grand'mère Coudray dans son café

le café tel qu'il est actuellement, avec son store à rayures (vue Google Street)
Un soir donc, en
arrivant sur le palier de son appartement elle entend derrière
elle un léger bruit. Elle se retourne: personne, mais il lui
semble que la poignée de porte de toilettes donnant
directement sur le palier est en train de tourner lentement.
Un peu affolée, elle ne perd toutefois pas son sang froid et,
tout en cherchant ses clefs dans son sac, fait mine de sonner,
appelant bien fort une hypothétique personne qui se serait
trouvée à l'intérieur de l'appartement. Puis elle ouvre la
porte, s'y engouffre et se cadenasse. À la réflexion, elle se
dit que c'était une illusion, qu'elle a eu peur pour rien mais
décide tout de même de se faire accompagner à l'avenir.
Quelques mois plus tard elle reçoit une convocation au
commissariat du quartier, sans autre précision. Le commissaire
l'interroge: "tel jour, à
telle heure, tard le soir, n'avez-vous rien remarqué
d'insolite?". Sur le moment elle ne voit pas puis la
mémoire lui revient: "vous
allez sans doute me prendre pour une folle, mais voilà ce
que j'ai cru voir ce soir là". Et le commissaire "vous n'étiez point folle et
vous aviez bien vu. C'était un dangereux criminel, que nous
venons d'arrêter. Il s'attaquait toujours à des femmes
seules portant de l'argent ou des bijoux, se cachait pour
les surprendre puis, avec un grand couteau de cuisine, il
les égorgeait. C'était un homme très ordonné et qui notait
tout. Or, sur son agenda, que l'on a retrouvé, il avait noté
ce soir là à votre adresse: veuve Coudray et en face, LOUPÉ".
Mon arrière-grand'mère s'évanouit sur le champ. Du coup, mais
est-ce pour cela ou tout simplement parce que la solitude lui
pesait, elle se remaria en 1906 avec Monsieur Rompteau, non
sans avoir préalablement vendu, ou mis en gérance, le café à
un certain François Burvinge (qui figure comme 4è témoin, à
l'adresse du 55 boulevard Saint-Martin, sur l'acte de mariage
de ma grand-mère en 1903.
Mon
arrière-grand'mère Coudray avait acheté un perroquet. C'était
je crois, un ara du Gabon; en tous cas il était gris perle
avec un jabot rose vif: magnifique. L'oiseau parlait assez
bien mais son répertoire favori était l'imitation des bruits
de la maison et les cris des autres animaux (chiens, chats,
poule...). Combien de fois ma grand'mère Simon, qui avait
hérité de l'oiseau (car les perroquets vivent très vieux) ne
s'est-elle pas laissée surprendre, croyant avoir laissé un
robinet ouvert, alors que c'était une imitation du perroquet
qui l'accueillait avec de grands éclats de rire.
Il avait une mémoire étonnante et apprenait vite. Lorsque mon
grand-père Simon était encore fiancé, il avait sifflé devant
le perroquet un air d'opérette à la mode, une seule fois
paraît-il et depuis, à chaque fois qu'il venait visiter sa
fiancée et avant même que l'on ne l'ait entendu arriver, le
perroquet se mettait à siffler le fameux air, à la perfection.
Comme il ne le sifflait jamais hors de la présence d'Étienne,
tout le monde était informé de son arrivée.
Une autre fois, la lingerie de la maison étant occupée par je
ne sais quoi, on pria la lingère, qui venait une fois par
semaine à la maison faire du repassage et du raccommodage,
d'aller faire ce travail dans une chambre. On avait oublié que
Coco s'y trouvait. La lingère ouvrant la porte fut accueillie
par un sonore "et alors, on
ne peut pas frapper?". Ne voyant personne elle revint
apeurée et on eu toutes les peines du monde à la persuader
qu'il n'y avait personne d'autre dans la pièce que le
perroquet, qui riait à gorge déployée.
Une autre fois, maman s'étant vantée auprès de ses camarades
de classe des prouesses vocales de l'oiseau, une petite
délégation vint voir le fabuleux animal. Voici donc la petite
troupe face à Coco, bien planté sur son perchoir et refusant
obstinément d'émettre le moindre son, malgré les
encouragements et caresses de sa maîtresse. Les petites amies
se moquèrent de maman: "il parle pas ton perroquet; tout ça
c'est de bobards". Coco restait muet. Il fallu bien se décider
à quitter la pièce. Alors que les petites filles passaient la
porte, Coco les rappela par un vigoureux "psit, psit!". Les
revoilà face au perchoir où l'oiseau se dandinait fièrement
d'une patte à l'autre, en roulant des yeux ronds... mais sans
rien dire. Après avoir eu le temps de faire son effet et
patienter l'auditoire, Coco consenti enfin à ouvrir le bec et
lâcha un "merrrrrrrde!"
retentissant avant de s'esclaffer bruyamment. Des années après
maman en avait encore honte.

Coco et ma tante Yvonne en 1917
Coco ayant fini par
mourir d'une pneumonie, un hiver rigoureux, il fut remplacé
par une tortue, moins bavarde mais d'humeur vagabonde. Combien
de fois la tortue ne s'échappa t-elle pas du jardin et ne fut
elle pas ramenée par les voisins? Pour en finir, on lui
peignit la carapace en rouge sur lequel on pouvait lire, en
grandes lettres blanches "Simon Aîné". Après quoi il n'y eut
plus à s'inquiéter de la perdre. En prime la tortue assurait
une originale publicité dans le quartier.
Ma cousine Thérèse m'a raconté que, pendant la guerre de 1870, Laurent Pelletier père n'avait pas été mobilisé, mais affecté dans la "territoriale" à Dijon. Un jour d'hiver où il se trouvait dans les vignes avec un détachement de territoriaux, ils sont surpris par des salves de fusil: ça tirait dans tous les coins! Pas de doute, les allemands étaient arrivés en Bourgogne. Mais ils eurent beau chercher, ils ne trouvèrent personne alors que les détonations poursuivaient de plus belle. Or ce jour là, il faisait très froid et, comme on dit, il gelait à pierres fendre. C'est précisément le bruit des pierres fendues par le gel qui les avait surpris.

Laurent Pelletier père
Retour à la table des matières
À Chalon, chez les
grands-parents, il y avait toujours une foule d'enfants. Non
seulement ils ont eu cinq filles mais, le grand-père Simon
étant lui-même l'aîné d'une nombreuse famille (pas moins de 11
frères et sœurs) il y avait toujours une ribambelle de cousins
et cousines qui étaient invités, tous à peu près du même âge,
car la maison était vaste et accueillante.
Évidemment, cela n'allait pas sans son lot de bêtises et les
parents avaient beau avoir l'œil, ils ne pouvaient pas tout
voir.
On m'a raconté qu'un jour grand'mère n'entendant pas les
enfants depuis un moment, commençait à s'inquiéter et
descendit dans le jardin pour voir ce qui se passait. À
première vue, tout semblait normal, aucun bruit mais, levant
la tête grand'mère se rendit compte qu'un curieux manège se
passait au dernier étage de la maison.
La maison de Chalon comportait un sous-sol, deux étages hauts
de plafond et au dessus des chambres aménagées, dans des
combles mansardés. Au niveau du rez-de-chaussée, un balcon
courrait sur toute une façade de la maison, auquel on accédait
par deux larges escaliers, abondamment utilisés pour toutes
les photos de famille réunissant beaucoup de monde.

Et voilà que
grand'mère voyait les enfants qui s'agitaient aux lucarnes
surplombant le balcon de 7 ou 8 mètres. Elle mit un temps à
réaliser ce qui se passait. Le jeu, car il s'agissait d'un
jeu, était de faire passer quelque chose d'une lucarne à
l'autre, tenu à bout de bras, en passant par la gouttière.
Mais quel était ce paquet blanc que se passaient ainsi les
enfants? Horreur, il s'agissait de la petite Suzanne, sœur de
maman, qui était encore bébé...
Il a fallu beaucoup de sang-froid à grand'mère pour ne pas
hurler, ne pas affoler les enfants et faire rentrer tout ce
petit monde en sécurité à l'intérieur de la maison. Mais à
quoi donc pensent les gosses?
Il faut croire que cette aventure avait marqué la petite
Suzanne car, deux ans plus tard environ, elle ne trouva rien
de mieux que de s'aventurer seule dans la gouttière et chuter,
devant toute la famille qui prenait le thé dans le jardin, sur
le balcon... d'où elle se releva en pleurant mais sans la
moindre égratignure!

Maman et Suzanne en 1908
Suzanne n'en garda aucune séquelle et ce n'est certainement pas des suites de cette chute qu'elle mourut au cours d'été 1911, lors de vacances à Berck, d'une dysenterie foudroyante (on a plus tard parlé de scorbut) mal soignée, dit on, par un médecin local). Pour la petite histoire, le propriétaire de la villa louée, cet été là, par la famille n'a rien trouvé de mieux que de mettre tout le monde dehors, par peur de la contagion... et trouver à se reloger à Berck en pleine saison, je ne vous dis pas!

Suzanne (au centre) sur la plage de Berck, quelques jours
avant sa mort
Retour à la table des matières
D'après ma cousine
Thérèse, mon arrière-grand-père Jean-François Simon, dit aîné,
avait paraît-il des idées très arrêtées sur la place des
femmes dans la société. Selon lui, une femme devait être bonne
épouse et bonne mère mais, surtout, s'en tenir là. C'est sans
doute la raison pour laquelle aucune de ses filles, dont
certaines comme Jeanne étaient assez brillantes, n'a jamais pu
se voir accorder la moindre responsabilité dans la
distillerie.
C'est également la raison pour laquelle aucune de ses filles
n'a jamais été autorisée, de son vivant, à chevaucher une
bicyclette...

tout de même mieux que la bicyclette!
Mon grand oncle Pierre Simon devait avoir 6 ou 7 ans lorsque, lors d'un repas avec des invités un peu guindé, dans la grande salle à manger de la maison de Chalon, il déclara ingénument: "j'aime bien quand il y a des invités à la maison, car le lendemain on a de bons restes à manger". Cela lui valu m'a t-on dit du grand-père Simon, qui ne plaisantait pas avec les bonnes manières, une gifle dont il s'est souvenu toute sa vie.

la famille Simon en 1905-
Pierre devant, le crane rasé
la petiote sur les genoux
de sa mère, c'est ma maman à moi
Retour à la table des matières
Jean-François Simon aîné voyait loin, paraît-il, et avait des idées commerciales bien arrêtées. Aussi estima-t-il nécessaire de faire apprendre les langues à deux de ses fils susceptibles de commercialiser ses produits à l'étranger. Joseph fut envoyé aux USA, où il représenta longtemps la société et Francisque s'en alla apprendre l'allemand à Leipzig. Lorsque la guerre 14-18 éclata, ses talents de germaniste furent précieux. Les français, en effet, se livraient à d'importants travaux de sape en dessous des lignes allemandes, dans les carrières au nord d'Arras, et certains tunnels étaient si près du fond des tranchées ennemies que l'on pouvait entendre les conversations. Francisque passa donc le plus clair de la Grande Guerre dans des souterrains, à écouter et traduire ce qui se disait au dessus de sa tête. Il en est revenu indemne, mais avide de soleil. On le comprend.
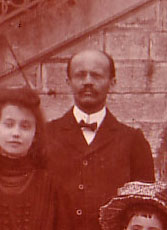
Francisque Simon en 1909
Retour
à la table des matières
Mes
grands-parents
maternels se sont mariés en 1903. Mon grand-père avait un
cousin germain ayant des plantations à Nabeul, en Tunisie.
C'est donc dans ce pays - à l'époque protectorat français -
qu'ils sont fait leur voyage de noce. Ils s'y sont plus et y
sont ensuite retournés plusieurs années de suite pour des
vacances et en ont ramené une belle collection de
photographies, que j'ai déjà mises en ligne dans une autre
partie de mon site mais pour lesquelles je pense intéressant
de founir un
lien direct depuis cette page. C'est sous nos yeux une vision disparue - et
cependant pas si éloignée - de la Tunisie coloniale au début
du XXè siècle. Le tourisme a changé bien des choses! Les
titres des photos sont ceux marqués par mes grands-parents
eux-même, dans l'album familial et j'ai tenu à les
conserver.

En vacances à Nabeul, hiver 1910 - ma grand-mère,
maman et sa soeur
Ce
cousin,
comme tout colon en Afrique du Nord, a fait son service
militaire comme zouave. Leur uniforme, très inspiré de celui
des ottomans, était splendide. Et encore, sur la photo, il
n'y a pas les couleurs! Lorsque la Tunisie est devenue
indépendante, le nouveau gouvernement a proposé à son fils
de racheter ses plantations, à un prix tellement sous-estimé
qu'il a cru devoir refuser. On lui a alors tellement cherché
de poux dans la tête qu'il a fini par céder (c'était la
vente ou la prison). Il a émigré en Italie, à Rome, où il a
fini ses jours. Sa vieille mère, qui avait vécu là bas toute
sa vie et, m'a t-on dit, avait fini par mieux parler arabe
que français, a préféré rester à Nabeul, sans être autrement
inquiétée, pour finir ses jours dans une petite maison
qu'elle avait conservée.

C'est
notre cousin, le deuxième à gauche. Il ressemblait
tellement à mon grand-père qu'on pourrait les confondre
Retour à la table des matières
Le petit Laurent, cousin de maman, qui habitait la même maison de Chalon qu'elle a laissé le souvenir d'un garçon plein de vie, mais terriblement inventif dans l'art de trouver des bêtises à faire. C'est évidemment lui qui avait eu l'idée de faire pipi dans le cuves de la distillerie, depuis la toiture (ce que je raconte dans une autre page de ce site). On lui doit aussi l'idée d'avoir escaladé un peuplier, dont une longue rangée bordait le canal du Centre à côté de Chalon et, une fois à la cime, de se balancer pour passer d'un arbre à l'autre, tel un jeune Tarzan, devant des parents morts de peur et qui ne savaient comment le faire descendre.

Laurent à Soissons en 1923
J'ai un autre souvenir de Laurent, beaucoup plus tardif. C'était à la libération. Laurent qui vivait alors au Sénégal nous avait envoyé pour Pâques un bel œuf en chocolat, denrée inconnue en France pendant la guerre et à laquelle je n'avais jamais goûtée. Dans mes souvenirs - mais ce sont des souvenirs d'un gamin de six ans - l'œuf était énorme. Il l'était peut-être un peu moins mais en tous cas suffisamment gros pour que je fasse une indigestion. J'ai été des années ensuite sans pouvoir avaler le moindre morceau de chocolat!

Laurent au début de la guerre
Et tiens, puisqu'on
parle de la libération, voici une autre anecdote. Nous étions
à Vannes et la région venait d'être libérée, non sans mal.
J'ai encore le souvenir de raids aériens qui nous avaient
obligé, à deux reprises, à fuir la maison vers les champs
voisins de la ville. Vannes n'a pratiquement pas été bombardé,
à l'exception de quelques maisons proches de la gare, mais je
revois encore le ciel embrasé à l'ouest, vu depuis la terrasse
de notre maison, lors des bombardements de Lorient, distant
pourtant d'une cinquantaine de kilomètres.
Bref, Vannes venait d'être libéré et une longue file de chars
américains entrait dans la ville en passant devant notre
maison, devant une foule qui les acclamait. Papa sortit d'un
placard deux mignonnettes de Suc Simon, la verte et la jaune,
et mes les confia pour que je les donne à des américains. Du
haut de mes six ans j'approchai un char en brandissant mes
cadeaux. Le char s'arrêta et on me hissa jusqu'à la tourelle.
Ce fut mon heure de gloire. En échange, les soldats du char me
donnèrent deux gros caramels que je ramenai tout fier à la
maison. Papa me dit "tu
t'es fait rouler". Peut-être, mais quel souvenir!

Retour à la table des matières
Mon arrière-grand-père Louis-Marie Lefranc avait épousé Anne-Marie Desbois, dont la famille habitait le château du Port de Roche, un peu plus au sud au bord de la Vilaine. (voir au sujet de cette habitation la page "histoire d'une maison", dans la rubrique "généalogie" de mon site).

le château de Port-de-Roche (au Grand-Fougeray 35)
La mariée avait fait sensation
en arrivant - on n'est pas près de l'oublier à Ruffiac - non
pas dans un attelage comme c'était l'usage, mais en
chevauchant son propre cheval. Ça ne s'était encore jamais vu!
Les noces ont été somptueuses. Elles ont duré plusieurs jours
et tous les habitants de la commune y ont été conviés.
Louis-Marie Lefranc a plus tard confié à son fils, qui l'a
lui-même raconté à mon père comme une autre chose étonnante,
que toute sa fortune en liquide, qui était déjà replète à
l'époque, y est passée et qu'à l'issue de noces il ne
possédait plus, en tout et pour tout, qu'un seul louis d'or.
Je pense qu'il s'est rattrapé ensuite.

les parents de la mariée,
Jacques-Aimé Desbois et Marie-Françoise Desbois (née
Grellier)
Retour
à la table des matières
En regardant ces photographies des parents de la mariée, je viens de réaliser que Marie-Françoise Desbois (née Grellier) était née au 18ème siècle, tout comme son époux Jacques-Aimé. Plus précisément le 21 septembre 1793, huit mois jour pour jour après la mort de Louis XVI alors que lui, un peu plus jeune, est du 19 décembre 1997. Les parents du marié (Jean-Marie Lefranc et Anne-Marie Lefranc, née Lebrun) ont, eux, carrément vu le jour pendant le règne de Louis XVI puisqu'ils sont respectivement de 1777 et de 1780. Jean-Marie avait déjà 16 ans à la mort de Louis XVI. Ainsi mon grand-père Lefranc, que j'ai parfaitement connu (j'avais 11 ans à sa mort) avait deux grands parents (qu'il n'a toutefois pas connus) nés sous Louis XVI et les deux autres très peu de temps après: pendant la Terreur, pour elle et, pour lui, pendant le Directoire. Et en plus de ça, nous avons des photos de ses grand-parents maternels! (car malgré le cadre, qui pourrait tromper, il s'agit bien d'un photographie). Nous avons même une seconde photo d'elle, figurant sur le faire-part de son décès.
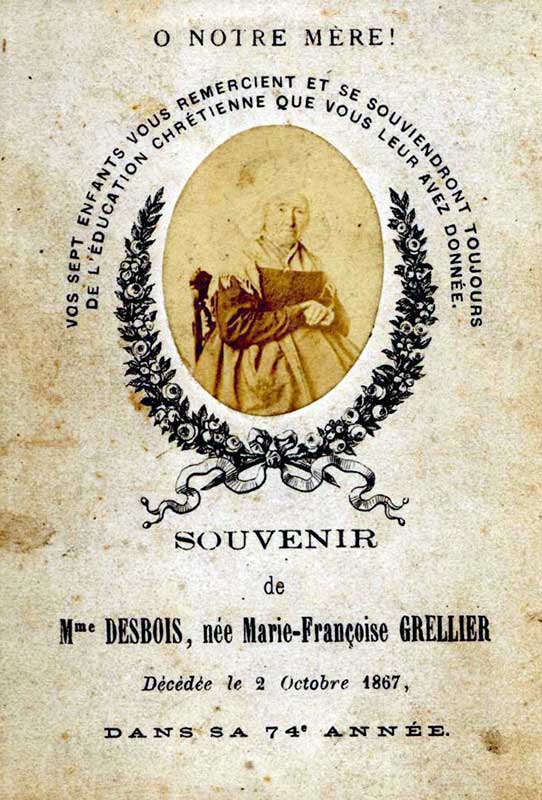
Cela laisse
songeur. Que de souvenirs de famille et de témoignages sans
doute à jamais perdus! Je me souviens de l'histoire, entendue
naguère à la radio, de ce médecin qui étant étudiant s'était
marié à une femme âgée (pour ne pas dire une vieille femme)
puis, resté veuf assez rapidement, s'était remarié alors qu'il
était lui-même en fin de vie, avec la toute jeune infirmière
qui prenait soin de lui. Cette personne, décédée pendant la
guerre 1939-45 pouvait dire "la
première femme de mon mari, qui est née sous Louis XV..."
Nous n'en sommes pas là mais je reste émerveillé d'avoir eu et
connu un grand-père dont les quatre grands-parents sont nés au
18ème siècle. Mais pourquoi pas? Ma tante Madeleine a bien
connu trois siècles, et deux millénaires. Née au 19ème siècle
(1896) elle s'est éteinte au 21ème (2002).
Continuons l'investigation avec ma grand'mère paternelle,
Marie Lefranc (née Berhaut) dont j'ai également un parfait
souvenir.

Ses grands-parents,
qu'elle a parfaitement connus, sont respectivement de 1804
(Guillaume Berhaut), 1812 (Joseph Frinault) et 1819
(Anne-Marie Frinault, née Chérel), sous les règnes de Napoléon
1er pour les deux premiers et sous Louis XVIII pour la
dernière. Son grand-père Guillaume avait déjà 11 ans lors de
la défaite de Waterloo. Du côté Simon à présent. Les
grand-parents paternels de mon grand-père Étienne Simon sont
de 1816 et 1821, soit tous deux sous Louis XVIII, monté sur le
trône en 1815 et mort en 1824. C'était, lui aussi un frère
cadet de Louis XVI. Ses grands parents maternels sont nés
respectivement en 1819 et 1822 (sous Napoléon Ier). Ceux de ma
grand'mère maternelle de 1830 et 1831, un peu plus tard.
Voilà comment, sans en avoir l'air, on touche du doigt
l'Histoire, avec un grand H.
Si je me réfère à
la garde-robe du mon grand-père Simon, telle que nous l'avons
trouvée à sa mort, mes grands-parents on mené une vie assez
mondaine. Mais il est vrai que l'époque était aux mondanités,
dans ce milieu de bourgeoisie provinciale. La maison s'y
prêtait d'ailleurs parfaitement et avait été conçue pour
recevoir. Le rez-de-chaussée y était entièrement dévolu: de
grands salons et des cuisines.
Bref, grand-père ne nous a légué pas moins de trois beaux
smokings. J'en ai conservé un mais, s'il fut un temps où je
pouvais m'y glisser, ce temps est bien révolu: grand-père
était resté svelte. Et ce n'est pas tout. Il disposait
également de deux costumes (à queue de pie) et d'une belle
jaquette grise, à porter sur un pantalon noir. Il y avait,
bien entendu, tous les accessoires qui allaient avec et sans
lesquels on n'est pas "habillé": chemises sans col, faux-cols
durs, une belle collection de nœuds papillons, boutons de
manchette, épingle de cravate ainsi que - et j'en étais resté
ébahi - des boîtes entières de gants de peau "beurre frais",
que l'on n'enfilait jamais (ils se tenaient négligemment à la
main) et devaient être souvent remplacés, pour rester
irréprochables.

On a également
retrouvé m'a dit mon père, bien rangé dans un tiroir, une
splendide tablier maçonnique dont mes tantes m'ont affirmé que
ce n'était pas le sien mais celui d'un de ses frères. Va
savoir: si ce n'est toi... de toutes façons, cela n'a plus
guère d'importance et j'ai beaucoup de respect pour les choix
de mon grand-père, qui était un homme de bien, aimable avec
tous, parlant peu et capable d'une grande écoute.
Chez les Lefranc on était maire
de Ruffiac de père en fils et conseiller général du canton de
Malestroit, de la même façon: cela ne se discutait même pas.
Cependant - et c'est un bien pour la démocratie - il y avait
un candidat d'opposition à chaque élection. On m'a raconté que
c'était généralement le pharmacien du coin qui tenait le rôle
de candidat régulièrement malchanceux jusqu'à ce que
grand-père, lassé de la vie politique, finisse par décider de
ne plus se représenter. Ce fut alors l'heure de gloire du
pharmacien.
Mais avant d'en arriver là, la lutte a été acharnée et tous
les coups étaient permis, même les plus bas.
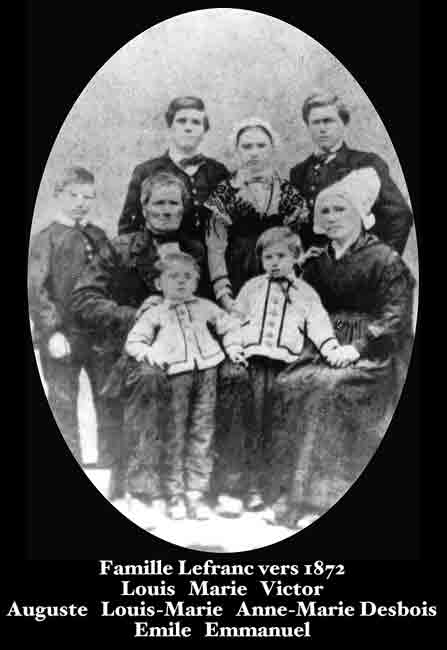
Ainsi de l'arrière-grand-père
Lefranc. Son épouse tenait à Ruffiac un magasin où l'on
vendait un peu de tout ce qui était nécessaire et, en
particulier, des étoffes en coupons. Ruffiac n'est pas tout à
fait la campagne profonde mais, dans certains domaines, le
progrès avait bien du mal à se faire une petite place. Cela
fut le cas du système métrique: un bon siècle après son
adoption les femmes de Ruffiac et des environs n'avaient pu
s'habituer à compter en mètres l'étoffe dont elles avaient
besoin pour se confectionner une blouse ou une robe. Elles
connaissaient leurs mesures et ces mesures s'exprimaient en
toises. L'ancienne toise de 6 pieds mesurait près de 2 mètres
(exactement 1,949 mètre). Il y avait donc
au magasin de l'arrière-grand'mère des toises en bois, qui
servaient pour la vente. Et chacun y trouvait son compte.
Lors d'une campagne électorale, l'adversaire de mon
arrière-grand-père le dénonça aux services de Poids et Mesures
qui vint faire une perquisition, avec deux gendarmes, et
saisit les fameuses toises qui furent brûlées publiquement sur
la place du village. Cette honte pour une personne sensée
représenter l'État faillit bien, cette année là, faire perdre
sa place de maire à l'arrière-grand-père, qui ne gagna les
élections que d'extrême justesse, contrairement aux autres
fois.
On m'a dit que depuis ce temps là, l'étoffe vendue par mon
arrière-grand'mère ne se mesurait plus en toises. Mais pour
autant elle n'employait toujours pas le mètre, y préférant
l'empan (distance mesurée en les extrémités du pouce et de
l'auriculaire, la main étant grande ouverte). Les mauvaises
langues racontent que mon arrière-grand-mère recrutait ses
vendeuses en fonction de la taille de leurs mains, plus
celle-ci était étroite et plus leur chance d'embauche était
grande!
Au passage cela me remet en mémoire une petite anecdote
gentiment égrillarde, mais qui avait toujours un franc succès
dans les repas de famille. Ma grand-mère Lefranc, qui avait
pris la succession du magasin après sa belle-mère reçoit un
jour un cliente un peu attardée qui voulait acheter des
culottes "fendues". Il y avait plusieurs modèles, plus ou
moins ouverts à l'avant et on lui demanda donc "fendues comment?". La
réponse, qui fit mourir de rire tout le magasin, fut "oh une bonne main d'homme".
Mais revenons aux campagnes électorales. Cette fois il s'agit
du grand-père Lefranc.
La maison de Ruffiac donnait donc sur la place du bourg, mais
entre la maison et la place se trouvait un large trottoir que
le cadastre indiquait comme faisant partie de la parcelle où
était édifiée la maison. Un trottoir privatif, par conséquent.
Un beau matin, quelques jours avant les élections, grand-père
sort de chez lui de bon matin et se trouve face à un mur haut
d'un bon mètre... qui bloquait l'entrée de son porche et, de
toute évidence, n'était pas là la veille. Des maçons, en
nombre et fort affairés, s'employaient à la construction.
Interrogés, ceux-ci se firent un plaisir de révéler qu'ils
construisaient une maison, à la demande du pharmacien et
adversaire électoral, qui les avait grassement payé pour
qu'ils commencent à la tombée de la nuit et en montent les
murs le plus rapidement possible et sans discontinuer.
L'affaire était grave. Même si cette construction était, de
toute évidence illégale, laisser faire c'était à coup sûr
perdre la face... et les élections.
Après avoir pris l'avis de quelques conseillers municipaux,
grand-père fit atteler une voiture, se rendit à la gare de
Malestroit d'où il prit le premier train pour Vannes, afin de
consulter la Préfecture sur la marche à suivre. Il était de
retour le soir même et ayant réunitd'urgence son conseil
municipal et prit un arrêté ordonnant la suspension de la
construction, édifiée sans permis et sur le terrain d'autrui.
Il était temps, le rez-de-chaussée était presque achevé. Il
parait que la démolition prit du temps et que, pendant toute
la période des élections, la fameuse "maison" fut le point de
mire des habitants amusés, qui réélurent grand-père avec un
pourcentage de voix digne d'une dictature. Il avait fait
preuve de compétence et d'autorité et pour cela, les habitants
de Ruffiac ont estimé qu'ils ferait un bon maire.
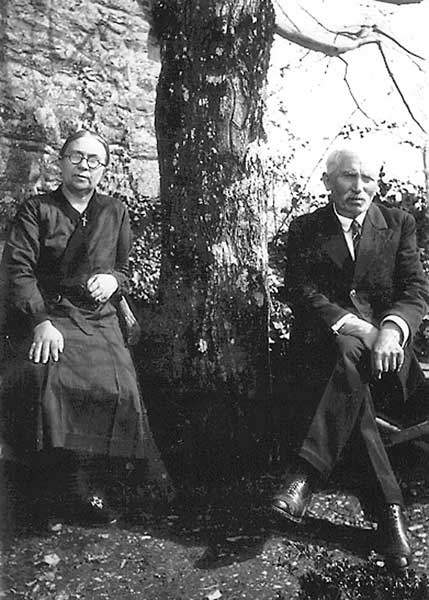
mes grands parents Lefranc en 1932
Retour à la table des matières
Victor Lefranc père, frère aîné
de mon grand-père, était médecin à Malestroit et fut,
paraît-il, le premier du canton à posséder une auto. Une auto
avec chauffeur, voyez-vous, quoique d'après les souvenirs de
papa le chauffeur n'était pas autoriser à conduire: son rôle
se cantonnait à la mécanique, qui demandait un entretien
continuel et à la longue préparation des phares à acétylène
(car à l'époque les automobiles n'avaient pas encore
l'éclairage électrique).
Bref, le docteur Lefranc et son auto faisaient la gloire et
l'admiration de tout Malestroit et le grand espoir de papa,
encore enfant, était précisément de faire un petit tour dans
ce splendide engin.

papa jeune
Un jour où il
faisait beau et où Victor Lefranc devait se rendre à Ruffiac
mais n'était pas trop pressé, il accéda à la demande de papa
et le fit monter à côté de lui sur le siège de la fameuse
voiture. Les routes en ce début de 20ème siècle n'étaient pas
ce quelles sont devenues, aucune n'était goudronnée mais, dans
chaque commune une cantonnier, voire plusieurs, en assurait
l'entretien et rebouchait soigneusement les "nids de poule".
On roulait encore au milieu de la chaussée car la conduite à
droite n'était qu'un vague usage, non obligatoire. Bref, la
liberté totale.
C'est pour cela qu'à mi chemin
entre Malestroit et Ruffiac, là où la route descend jusqu'à la
rivière qui forme la limite des deux communes, avant de
remonter ensuite, Victor laissa son véhicule prendre un peu de
vitesse, en profitant de la pente du terrain. Papa ébahi dit
alors "tonton, ça roule
vite; à quelle vitesse va t-on?". Et l'oncle,
redressant la tête avec fierté, répondit "on va très vite en effet, au
moins 30 km à l'heure". Beau le progrès.
Il y avait à Ruffiac,
comme dans n'importe quelle commune française du début du
20ème siècle, deux écoles: l'école publique et l'école libre
qui se faisaient une guerre acharnée. Tous les coups étaient
permis. On était bien pensant à Ruffiac et tous les enfants,
y compris ceux du maire, fréquentaient donc l'école libre, à
l'exception du fils du cantonnier qui, étant fonctionnaire,
se sentait moralement obligé de l'y envoyer. L'instituteur
public n'avait donc qu'un seul élève. Actuellement on
fermerait cette école mais à l'époque il n'était pas
question d'abandonner la place. La séparation de l'Église et
de l'État était encore récente et la querelle des crucifix
restait dans toutes les mémoires. Bref, les cinq enfants de
grand-père allaient à l'école libre. Jusqu'au jour ou pour
je ne sais quelle raison tenant sans doute plus de
Clochemerle que d'un réel problème, mon grand-père se fâcha
avec le curé. Du coup il retira ses enfants de l'école libre
et les mit à l'école publique. Non mais! Le pauvre
instituteur dont l'effectif était subitement passé de un à
six élèves eut bien du mal à s'en remettre. Ce ne fut
d'ailleurs que de courte durée car le maire et le curé
finirent par se rabibocher et les cinq enfants retournèrent
à l'école libre.
Est-ce pour se faire
pardonner que grand-père, revenant d'un pèlerinage à
Lisieux, fit installer à ses frais un autel sur le bas-côté
de l'église de Ruffiac, ainsi qu'un grand vitrail qui porte
encore le nom des Lefranc? On me l'avait dit étant petit et
je me demandais bien, à l'époque, quelle avait pu être la
raison pour laquelle mon grand-père avait fait construire un
"hôtel" à Lisieux...
Dans la première partie du
20ème siècle un restaurant s'est ouvert à Ruffiac.
Grand'mère Lefranc était sur la pas de la porte de sa maison
à regarder une équipe de peintre peignant le fond de
l'enseigne du restaurant. Le fond impeccablement fini, ils
s'arrêtent: un enseigne c'est bien mais quel nom donner à
cet établissement? Alors ils viennent, avec le patron du
restaurant, demander très respectueusement à grand'mère si
elle avait une idée sur la question: étant la femme du
maire, elle devait nécessairement avoir de bonnes idées.
Grand'mère prise de court
bafouille un peu puis finit par dire "le
restaurant se trouve sur la place, pourquoi pas Restaurant
de la Place? enfin..." Très bien, dit le patron, ne cherchez plus, c'est
parfait. Mais le patron était un peu dur d'oreille et voilà
pourquoi, pendant des années, Ruffiac a eu droit à ce
Restaurant de la Plage qui étonnait beaucoup les gens de
passage.
Lorsque papa a passé le
baccalauréat pour la première fois, en section littéraire, il
a été recalé. Ce sont des choses qui arrivent. Il y avait à
cette époque une seconde session en octobre et grand-père
décida d'envoyer papa passer l'été dans ce qu'on appelait
alors une "boîte à bac" où l'on révisait dur pendant deux ou
trois mois pour avoir une seconde chance à la session de
rattrapage.
On le mit donc dans un de ces établissements, qui se trouvait
à Vannes, non loin de l'École Normale de garçons.
La discipline y était très stricte et pour éviter qu'ils ne se
dissipassent, les pensionnaires étaient enfermés à clef dans
leur chambre chaque nuit. Il arriva ce qui devait arriver: une
bonne colique en pleine nuit. Impossible de sortir pour aller
aux toilettes. Il eut beau appeler, tambouriner la porte,
personne ne lui ouvrait. Un journal déplié sur le sol reçut
donc ce qu'il ne pouvait faire ailleurs. Encore fallait-il
s'en débarrasser, à cause de l'odeur. Or si la porte de la
chambre était fermée la fenêtre, en cette belle nuit d'août,
ne l'était pas. Le journal replié papa prit son élan, en
avant, en arrière et... le journal céda, repeignant la
tapisserie d'un délicat mouchetis brun.
À compter de ce jour et devant l'évidence de ses explications,
papa ne fut plus enfermé le soir dans sa chambre. Quoique, à
la place du directeur, je lui aurait fourni un pot de chambre.
Enfin, papa a eu son bac en octobre, avant de refaire une
autre terminale scientifique et passer à nouveau un deuxième
bac lui donnant accès à l'école d'ingénieur où il souhaitait
entrer.
Lorsque papa était encore
étudiant, à Toulouse, il s'était payé une grosse moto avec ses
économies. L'apprenant, grand-père Lefranc en fut très
contrarié. Les motos, tout le monde le sait, c'est des engins
à se tuer. Aussi, en échange de la moto, il offrit de lui
payer une auto: c'était plus sûr.
L'auto fut commandée. À cette époque, les constructeurs ne
livraient généralement pas, il fallait aller chercher l'auto
en usine. J'ignore la marque mais c'est dans la banlieue
parisienne que papa alla donc prendre livraison de sa première
auto. Ses parent avaient insisté pour qu'il se fasse
accompagner de sa plus jeune sœur Yvonne et c'est elle qui m'a
raconté comme cela s'est passé.
L'aller s'était fait en train et un taxi les avait amenés à
l'usine automobile où les attendait un employé, qui leur avait
présenté l'engin. Papa, à l'époque, n'avait pas de permis de
conduire, je le précise. L'employé de l'usine lui a donc
rapidement montré comment cette auto fonctionnait, où étaient
les vitesses, le frein etc... Papa l'ayant assuré qu'il avait
parfaitement compris, l'employé lui laissa le volant. Papa
passa une vitesse, qui se trouva être la marche arrière,
embraya un peu rapidement et alla emboutir le mur qui était
derrière lui.
Plus de peur que de mal, mais l'employé était consterné.
Visiblement, on ne pouvait confier une auto à des mains aussi
inexpérimentées. Il proposa donc de prendre lui-même le
volant, à ses frais et de conduire ses passagers hors de
l'agglomération, tout en donnant une petite leçon de conduite.
La fierté de papa en avait pris un bon coup mais il finit,
sous la pression de sa sœur, par accepter la proposition.
Le retour en Bretagne se fit sans problème majeur. La route
était étroite mais très peu encombrée. Ils firent escale au
Mans pour la nuit. Le lendemain papa avait pris un peu
d'assurance et ils purent rentrer sans encombre à Ruffiac.
Restait à passer le permis de conduire. Là c'est le récit de
papa.
Il avait été convoqué un matin à Vannes, sur le Champ de
Foire, où attendait l'examinateur. Chaque candidat (ils
étaient une demi douzaine) était, bien entendu, arrivé au
volant de sa propre voiture! L'examinateur compta les
candidats puis monta dans son véhicule personnel en disant
"suivez-moi". Ils firent le tour de Vannes pour se retrouver
sur le Champ de Foire. Après un nouveau décompte, constatant
qu'il ne manquait personne, l'examinateur signa les précieux
permis. Ce fut tout.

la photo sur le permis
Maman, qui a passé
son permis à peu près à la même époque, mais à Chalon sur
Saône, m'a dit que l'examen avait été pour elle beaucoup plus
sérieux: l'examinateur était à ses côtés, lui avait posé
quelques questions sur le code de la route pendant qu'elle
conduisait et lui avait même fait faire un démarrage en côte
(le créneau n'avait pas encore été inventé à l'époque). Deux
poids, deux mesures, par conséquent. Ce qui n'a pas empêché
mes parents de conduire toute leur vie et, à ma connaissance,
sans le moindre accrochage. Alors?
Du temps où papa était
étudiant à Paris on lui avait un jour confié pour
l'après-midi un petit cousin à garder. Si ma mémoire est
bonne c'était un petit Berhaut, sans doute Jacques dont il
était le parrain. Ils étaient allé ensemble au square où,
assis sur un banc, papa pouvait tranquillement réviser ses
cours, tandis que le petit jouait à proximité.
Soudain papa lève les yeux
et ne voit plus l'enfant. Il se lève, va jusqu'au coin de
l'allée et le retrouve là, planté bouche bée devant un vieux
monsieur à l'abondante barbe blanche, assis sur un banc et
qui, flatté de cette attention juvénile, lui souriait
gentiment. Parfaite illustration de "l'Art
d'être Grand-Père".
Apercevant papa le gamin
l'appelle: "viens voir parrain, viens voir le
monsieur... comme il est laid!". Tirant son petit cousin par
la main, papa rouge comme une pivoine, s'est prestement
dépêché de changer de lieu de promenade. Des années après,
même s'il en riait, il sentait la honte revenir.
Maman jeune fille allait
régulièrement à Paris pour rendre visite à ses grands-parents
Coudray. Elle appréciait d'autant plus qu'une amie à elle,
proche parente du Président de la République de l'époque - ne
me demandez pas qui... - lui obtenait facilement de l'Élysée
des places pour assister à des spectacles dans la loge
présidentielle. En ce temps, tous les théâtres parisiens,
toutes les salles de concert et même les stades avaient une
loge présidentielle, rarement occupées par le Président
lui-même mais qu'il pouvait mettre à la disposition des gens
qu'il voulait honorer ou remercier.
C'est ainsi que maman m'avait souvent raconté avoir assisté à
un récital de piano donné par Érik Satie, déjà âgé (il est mort en
1925: maman avait 21 ans), revêtu de son éternel costume de
velours gris dont on a, paraît-il retrouvé chez lui, à sa
mort, toute une collection. Maman avait conservé de ce concert
un souvenir horrifié. Il n'y avait dans cette musique,
disait-elle, ni mesure, ni mélodie; rien que des dissonances
déplaisantes. Et si elle n'avait pas été placée dans une loge
qui faisait d'elle le point de mire de l'assistance, nul doute
qu'elle serait partie avant la fin du récital.
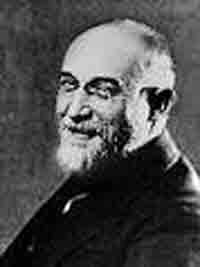
Erik Satie
Bien des années plus tard, alors
que jeune architecte j'habitais encore Rennes, maman vint
passer quelques jours chez moi. Un soir, à l'improviste et
pour voir sa réaction, je mets sans la prévenir un disque de
Satie. Dès le début de la première Gymnopédie maman me dit: "c'est agréable cette musique.
De qui est-ce?" Je lui avouai qu'elle était de ce
Satie qu'elle avait tant décrié. Mais le temps avait passé et
les oreilles de maman en avaient entendu d'autres...
Papa m'a raconté, à propos de loge présidentielle, qu'allant
assister avec son frère Émile, à peu près à la même époque, à
un match au Parc des Princes (l'ancien bien entendu, celui de
1897), les deux gars repèrent en arrivant que la loge du
Président était vide. Chiche! ils s'y rendent avec assurance.
Personne ne leur demande quoi que ce soit et ils assistent à
tout le match depuis ce point de vue privilégié, donnant même
le signal des applaudissements. Enfin, presque tout le match
car ils ont préféré s'éclipser discrètement un peu avant la
fin de la seconde mi-temps. On ne sait jamais...
Papa a toujours été un grand sportif, tout comme son frère aîné Émile dont le plus grand titre de gloire a été la traversée à la nage de la Gironde, à partir de Royan et qui a fait ensuite carrière comme professeur de gymnastique à St Quentin. Papa, lui, était surtout attiré au début par l'athlétisme. Bac en poche, il partit faire des études d'ingénieur à Paris dans ce qui est devenu, depuis, Sup d'Elec. Mais il consacrait la plupart de ses loisirs au sport et a fini par avoir un bon niveau. Il disait avoir été champion de France de saut en longueur (je n'ai pu retrouver en quelle année, mais ai vu à la maison la médaille qu'il avait reçue) et a été sélectionné pour le 110 mètres haies aux Jeux Olympique de Paris de 1924 (quoique éliminé dès les premières épreuves). Au moins cela lui a valu d'assister gratuitement à tous les jeux et d'être décoré de la médaille des sports.

compétition sportive
Papa faisait partie du PUC
(Paris Université Club) qui existe toujours. Il y a côtoyé
quelques personnalités, comme Roland Garros (à ce propos il se
fâchait souvent en entendant prononcer ce nom avec un O court,
comme "auto", alors que ce nom du sud-ouest se prononce avec
un O long comme "pomme"). Il a également connu au PUC un fils,
ou neveu, de l'empereur du Japon qui avait invité ses
condisciples à Tokyo, tous frais payés, pour son mariage. Mais
c'était un bien long voyage par bateau et papa y a renoncé.
Son diplôme d'ingénieur en poche, papa choisit d'en passer un
second à Toulouse (actuellement École Nationale Supérieure
d´Électrotechnique, d´Électronique, d´Informatique,
d´Hydraulique et des Télécommunications (ENSEEIHT). Et c'est
tout naturellement, une fois dans la patrie du ballon ovale,
qu'il a opté pour le rugby. Il faut croire qu'il était doué
car il a plusieurs fois été sélectionné pour des rencontres
internationales. J'ai entendu parler d'un match à Rome et d'un
autre à Varsovie. Mais à l'époque les sélections changeaient
souvent car il s'agissait d'amateurs, en général étudiants,
qui ne pouvaient trop s'absenter pour de longs voyages (en
train) à l'étranger.

papa, à gauche, en tenue de sports
Papa, lorsqu'il étudiait à
Toulouse, prenait pension dans un petit hôtel restaurant (les
cités universitaires n'existaient pas encore). Un jour le
patron lui dit "j'étais au
match dimanche et il y avait un joueur qui vous ressemblait
beaucoup". Papa lui répondit que c'était bien plus
qu'une ressemblance puisque c'était lui qui jouait. Le patron
de l'hôtel se déclara très honoré d'avoir chez lui un joueur
de rugby de ce niveau et qu'il n'était plus question qu'il
paye quoi que ce soit. Depuis ce jour et jusqu'à la fin de ses
études papa a été logé et nourri gratis. Bien entendu
grand-père n'en a jamais rien su et a continué à lui envoyer
régulièrement de quoi payer sa pension...
Le mariage de mes parents
Il arrive souvent que des
enfants interrogent leurs parents afin de savoir comment ils
se sont connus. Voici, du moins en ce qui me concerne, la
réponse à cette obsédante question, telle que maman me l'a
contée.
La famille Simon avait
toujours eu l'habitude, pour fuir les chaleurs estivales
bourguignonnes, de passer l'été en vacances au bord de la
mer. C'était également une tradition pour la famille
Lefranc, mais alors que les Simon variaient souvent leur
destination, les Lefranc louaient chaque été la même villa à
Port-Navalo.
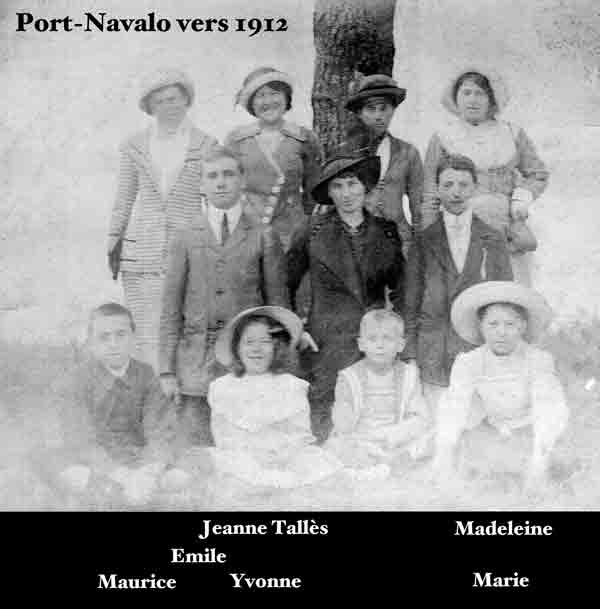
On m'a raconté: c'était toute
une expédition. Quelques jours avant le départ, on envoyait en
précurseur, par la route, un domestique avec un âne attelé à
une carriole, pour acheminer les bagages. Une fois sur place,
l'âne et la carriole étaient bien agréables pour les
promenades. Puis, le jour venu toute la famille se rendait, en
calèche, jusqu'à la gare de Malestroit, située en peu hors de
la commune pour que (disent les comptes-rendus des
délibérations du Conseil Municipal) "la vertu de jeunes filles de Malestroit s'en
trouve préservée". Le train arrivait à point nommé
pour un repas dans un restaurant du port de Vannes, toujours
le même restaurant bien entendu. Après le repas la famille
embarquait dans le "vapeur" qui desservait le Golfe du
Morbihan et débarquait tout son mode en fin d'après-midi à
Port-Navalo. C'était le bon temps!
La famille Simon, elle, avait toute la France à traverser et
le faisait en auto qui a été longtemps une énorme Rosengart
noire (fabriquée à Saint Brieuc) avec des strapontins vis à
vis du siège arrière et de porte-bouquets de chaque côté des
portières. Elle a ensuite été remplacée par une Berliet,
preque aussi monumentale, que j'ai bien connue pour avoir
plusieurs fois traversé la France à bord de cette voiture.

la Berliet en 1938
J'ai placé ailleurs sur ce site un petit album de
photos illustrant ces vacances. En 1928 les Simon choisirent
de passer l'été à Quiberon et se nouèrent d'amitié avec des
Lefranc, de la branche aînée ,qui y séjournaient également.
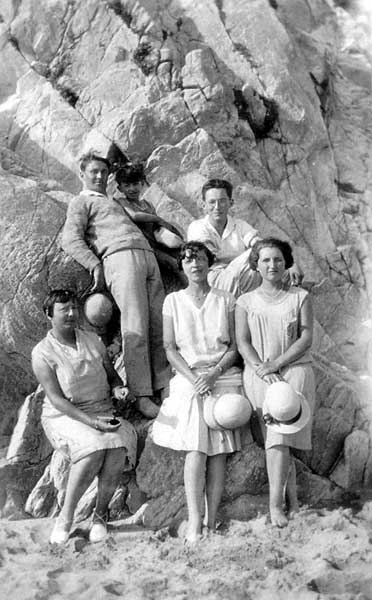
Il fut convenu que les deux familles se retrouveraient au même endroit l'année suivante.

Maddy Simon et Yves Lefranc à Quiberon en 1928
Albert Lefranc, bien qu'il ait quelques douze années de plus que maman, sympathisa avec elle et se dit qu'elle était tout à fait le type de jeune fille qui plairait à son cousin Maurice. Aussi persuada t-il Maurice de passer quelques jours à Quiberon avec eux. Il avait vu juste et on envisagea de les marier. Maman m'a un jour confié que papa l'avait tellement baratiné que toute résistance aurait été inimaginable...

les futurs époux,dûment chaperonnés
Une délégation de la famille Lefranc se rendit alors à Chalon, pour voir sur place si les Simon avaient le répondant qu'ils semblaient présenter en vacances. On n'est jamais trop prudent! Rassurés sur ce point ils acceptèrent les fiançailles, qui eurent lieu l'année suivante à Ruffiac, en 1930 par conséquent. Comme je le disais, à cette époque on prenait son temps.

Le mariage fut célébré encore un an après, cette fois-ci à Chalon. Il fut, m'a t-on dit, somptueux, avec un buffet le midi pour plusieurs centaines de personnes, au rez-de-chaussée de la maison qui était vaste et avait été spécialement conçu pour recevoir. Un second repas, le soir, ne réunit que la famille et les intimes. Si l'on en juge d'après la photo prise sur le fameux escalier, cela faisait tout de même pas mal de monde.

Les nouveaux mariés choisirent
de faire un voyage de noces original, non point par sa
destination: la Corse puis Florence, mais par le moyen de
transport. Car ils se rendirent en Corse en avion! tenez-vous
bien, c'était en 1931 et les voyages en avion n'étaient pas
monnaie courante. Bien plus, il s'agissait d'un hydravion. Ils
ont décollé de l'étang de Berre pour se poser, royalement, au
milieu de la baie d'Ajaccio: le rêve. Ils m'ont raconté qu'il
n'y avait pas de sièges fixes à l'intérieur mais des fauteuils
en osier que chacun disposait à son gré et qu'on leur avait
distribué des boules de coton pour se mettre dans les
oreilles, à cause du bruit et aussi parce que les avions
n'étaient pas encore pressurisés. Un passionné d'aéronautique
me confirme, par la copie de cet article:
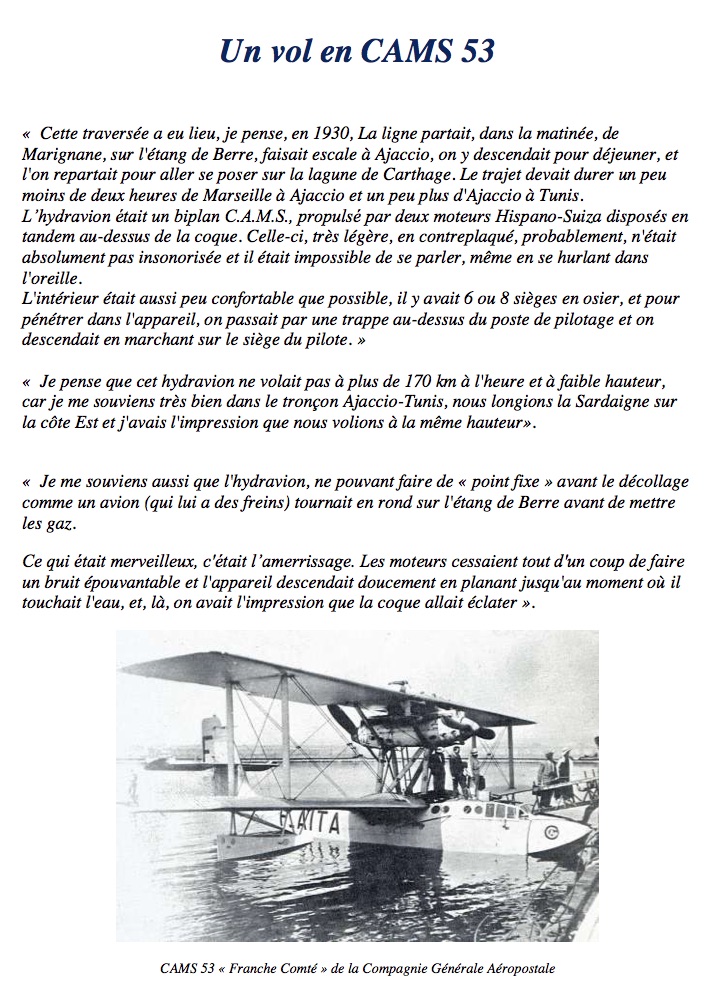
Avant de s'envoler pour la Corse, ils avaient tout de même pris le soin de visiter la Riviera et faire un petit séjour à Cannes.

La traversée vers l'Italie a eu lieu en bateau et le retour, de façon plus banale, en train.

Maman m'a raconté que, au bout
de quelques jours, papa lui avait dit "ça y est, j'ai compris comment
on parle italien, tu vas voir c'est facile". Ils
étaient dans un taxi entre Pise et Florence et papa souhaitait
s'arrêter pour satisfaire un petit besoin. Il lance alors au
chauffeur un sonore "cabinetto!".
Le taxi pile sur place et papa en descend pour faire ce qu'il
avait besoin de faire. Le chauffeur éclate alors de rire. Il a
réussi à expliquer ensuite qu'il pensait avoir compris que
papa lui signalait des carabiniers, d'où son empressement à
s'arrêter.
Ensuite, toujours pas pressés, mes parents ont attendu 9 ans
pour me mettre en chantier.
La suite est une autre histoire.
Au retour, les parents se sont installés à Paris, où Papa avait trouvé une place d'ingénieur dans un société qui allait devenir, plus tard EDF tandis que maman s'ennuyait ferme dans l'appartement.

Pour se distraire, elle
tricotait énormément, car elle a toujours eu du goût pour le
tricot et un talent certain pour créer des modèles
intéressants. Elle avait une amie qui connaissait une personne
chargée des achats au Galeries Lafayette. Maman avait réalisé
quelques ouvrages de tricot pour elle, qui avaient été montrés
à cette personne et qui avaient été appréciés. Maman finit par
se laisser convaincre de mettre en vente quelques unes de ses
créations, à titre d'essai, aux Galeries Lafayette. Cela
partit comme des petits pains. Elle en tricota donc d'autres,
puis de plus en plus. Quelques années plus tard, maman se
trouvait à la tête d'une petite entreprise de dizaines de
tricoteuses à domicile qui réalisaient ses modèles.. au grand
désespoir de papa qui avait des principes un peu anciens et
pour qui une femme, ça ne travaille pas. Leur déménagement en
Bretagne, en 1938, mit définitivement fin à ce petit commerce.
Occasion manquée
Lorsque mes parents
habitaient Paris, ils étaient amis avec une personne qui
avait une petite entreprise de mécanique de précision.
Celui-ci reçut un jour la visite d'un inventeur qui
cherchait à vendre le brevet d'une de ses inventions. Elle
n'existait encore que sur le papier. C'était un ingénieux
système de fermeture constitué de deux files de petites
pièces en forme de crochets pouvant s'assembler, ou se
désassembler, au passage d'un élément mobile: en deux mots
ils s'agissait de ce qui est devenu plus tard la "Fermeture
Éclair".
Le mécanicien perplexe se
demanda à quoi cela allait bien pouvoir servir.
Certainement, dans le domaine très conservateur de
l'habillement, une telle fermeture n'avait aucun avenir. Et
puis imaginez un peu l'outillage nécessaire à la production
en masse d'un objet aussi compliqué. Non, décidément, ce
projet n'avait pas le moindre intérêt et certtainement aucun
avenir. Il mit donc poliment l'inventeur et son brevet à la
porte.
Il l'a regretté toute sa
vie! Je dois ajouter, pour être exact, que l'invention de la
fermeture à crémaillère est officiellement attribuée à
l'américain Withcomb Judson en 1891. Mais je ne fais que
transcrire ici l'histoire que papa m'a souvent racontée. Il
est possible, comme le bon vin, qu'elle se soit améliorée
avec le temps...

Le malchanceux (à droite) avec mes parents et sa femme
Retour à la table des matières
Les noces de Jeannette
Après leur mariage, mes
parents ont habité Paris pendant 9 ans, sans enfants, un
appartement non loin du Parc Monceau. Ils avaient comme
voisine palier une jeune et jolie starlette dont le tairai
le nom et dont la vie, quelque peu agitée, faisait
paraît-il, jaser tout le quartier; mais on ne prête qu'aux
riches. Je l'ai souvent vue plus tard au cinéma, dans des
seconds rôles comiques de vieille domestique et j'ai du mal
à imaginer cette vieille dame fanée en femme fatale.
Est-ce cette présence qui
les avait incité? en tous cas, à cette époque, mes parents
pratiquaient le théâtre amateur avec assiduité.
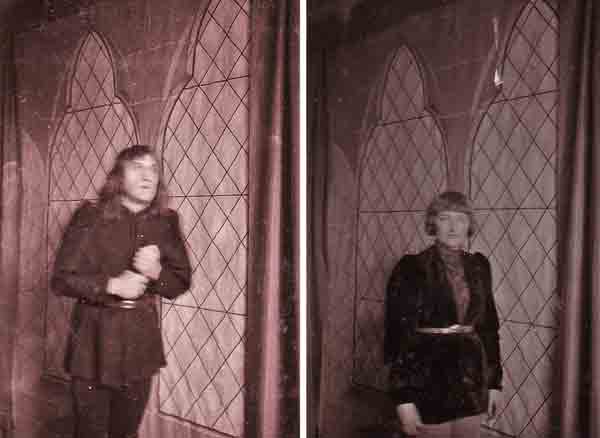
J'ai encore des photos de papa
dans Knock et dans Gringoire (d'après Notre-Dame de Paris),
ses deux plus grands succès. Mais la troupe montait également
des opérettes, dont papa (qui chantait comme une casserole)
était soigneusement exclu, ou alors dans des rôles muets. Il
m'a raconté le début d'une représentation des Noces de
Jeannette (1854 - Victor Massé). Le rideau s'ouvre sur
l'entrée, au pas de course, d'un jeune homme qui vient de
justesse d'échapper à un mariage non souhaité et dont la
première réplique est "Ouf,
je l'ai échappé belle!". Alors qu'il prononçait cette
phrase, le fond du décor qui représentait une lourde armoire
normande, mal fixé se détache et lui tombe dessus. Bien sûr
c'était une toile peinte, mais vu de loin... Les spectateurs
firent "Ooooh...".
L'acteur se retourne, rattrape l'armoire au vol et la remet
droite avant d'enchaîner "...
et l'armoire aussi!". Il se tailla un beau succès.
L'auto d'Yvonne
Pour les 20 ans de ma tante
Yvonne, troisième sœur de maman et ma marraine, ses parents
lui avaient offert une auto. C'était une petite décapotable
jaune vif avec une place à l'arrière dans une sorte de
baquet qui occupait son cul pointu. Yvonne n'a, hélas, guère
pu en profiter. C'est tout juste si la voiture avait
quelques kilomètres au compteur lorsque la guerre éclata.
Plus d'essence, réquisitionnée par les armées, française au
début puis allemandes. La belle petite auto fut bâchée et
mise sur cale sous un hangar au bout de la distillerie, où
je l'ai connue dans mon enfance. Mon frère et moi allions
parfois soulever la bâche avec curiosité et une grande envie
d'y jouer. Mais cela était strictement interdit. Un beau
jour mes grands-parents, fatigués de voir cette voiture
inutile l'ont revendue à un casseur. J'ose espérer que ce
modèle de collection, dans un état quasiment neuf, a connu
une fin plus glorieuse que la ferraille.

Yvonne est morte peu après.
Depuis des années elle souffrait de tuberculose, maladie qu'on
se savait guérir à l'époque et qui a fini par l'emporter, en
dépit de nombreuses cures en montagne, l'été, et dans le midi
l'hiver.
Quo non ascendem? (Jusqu'où ne
monterai-je point? c'était le devise de Fouquet; mal lui
en a pris)
Lorsqu'il était encore
jeune ingénieur, papa fut chargé du projet d'électrification
d'une région montagneuse des Hautes Alpes. Les travaux
faits, il restait encore à trouver des abonnés. Or, en dépit
d'informations et de publicité à haute dose, les candidats à
l'électricité étaient loin d'être légion. On enquêta et l'on
finit par apprendre que les habitants du lieu restaient
persuadés que le courant électrique ne pourrait jamais
escalader ces pentes escarpées. L'eau courante n'y avait
d'ailleurs jamais pu être acheminée; ce qui semblait
probant. La compagnie qui exploitait ce secteur (c'était
avant EDF) fit donc installer une grande quantité d'ampoules
électriques tout au long du circuit et le jour de
l'inauguration, à la tombée de la nuit, lorsque le préfet
enclencha la manette reliant ce circuit au réseau, la
montage s'illumina comme un gigantesque arbre de Noël.
Devant cette évidence, on refusa du monde le lendemain, au
bureau qui enregistrait les demandes d'abonnement.
Était-ce dans cette même
région que l'on édifia une centrale électrique recevant les
eaux d'altitude par le moyen d'une grosse conduite forcée?
Toujours est-il que les amoureux de la nature hurlèrent à la
vue de ce gros tuyau, en cours de pose, qui balafrait ainsi
le flanc de la montagne. Pour les calmer, la compagnie
demanda à une équipe de peintre de camoufler au mieux la
fameuse conduite. C'était au printemps et les peintres
abusèrent de couleur vert tendre constellée de petits points
jaune et bleu censés représenter des fleurs. Il paraît que
l'effet était admirable. Mais l'inauguration de la centrale
se fit à l'automne suivant et l'on dit que ce tuyau vert vif
serpentant au milieu des rouges et des ors de l'automne
obtint un beau succès. Il a fini par disparaître sous une
miséricordieuse végétation, quant à la peinture, ma foi,
elle n'est pas éternelle.
Toujours dans le domaine
du génie électrique: l'électricité n'étant pas du tout une
denrée que l'on peut stocker, on a toujours cherché à
exploiter au mieux son utilisation en fonction des heures et
des saisons. Diverses astuces ont été mises en œuvre dont la
suivante. La nuit, le courant produit et peu utilisé sert à
alimenter de puissantes pompes qui relèvent l'eau d'un
barrage jusqu'à un bassin en altitude, d'où elle s'écoule
dans la journée pour aider à faire tourner les turbines, la
retenue du bas étant trop fortement sollicitée. La première
mise en application de ce procédé se fit dans les Vosges,
avec ce qu'on appelé les lacs blancs et noirs. Papa
assistait au lancement de la centrale, au milieu d'une foule
importante et décorée. Au changement d'heure du soir, un
ministre fut chargé d'ouvrir la vanne du lac supérieur. Il
coupa le ruban tricolore, tourna le volant de la vanne et en
quelques secondes tout ce beau monde eut de l'eau jusqu'aux
genoux. Il était évident que l'installation était à revoir,
mais on en a bien ri dans les gazettes.
La bévue
Dans les années 30, la compagnie électrique qui employait
papa se trouva en pourparlers avec une compagnie suisse avec
laquelle une proposition de contrat fut établie. C'était
paraît-il un contrat très important. Papa assista à la
réception des deux émissaires suisses qui arrivèrent tout de
noir habillés, raides comme des passe-lacets et la visage
obstinément fermé. Le contrat fut signé et les deux suisses
quittèrent la pièce, en oubliant sur une table leur
exemplaire du fameux contrat. Ils firent rapidement
demi-tour, juste à temps pour entendre le directeur de papa,
qui tournait le dos à la porte, éclater de rire et dire "mais ce
sont des vrais croque-morts ces gens là!". On eut, m'a t-on dit, le plus
grand mal à empêcher les deux honorables clients suisses de
déchirer le document qu'ils venaient de signer.
Dans le même genre on
raconte qu'un collègue de papa salua un jour un fidèle
client, qui s'appelait Chandelier d'un jovial "Bonjour
Monsieur Candélabre", qui fut fort mal interprété. On ne vit plus ce
client, vexé au plus haut point.
Et pan!
Papa aimait chasser, en un
temps où le gibier était loin d'être aussi rare qu'il ne
l'est de nos jours.

papa est sa meute en 1939.
Kettie à droite
Dans ses bras Pat, le loulou de mes grands parents
Il avait donc, juste avant la guerre, un chien ou plus exactement une chienne nommée Kettie. Cette chienne battit sans doute un record en mettant au monde 11 chiots d'un coup, qu'on lui laissa. Elle faillit bien en mourir d'épuisement.

Lorsque vint la guerre, puis
l'occupation, tous les fusils furent réquisitionnés par les
allemands mais papa décida de conserver le sien, qu'il
dissimula dans le grenier entre deux solives. Il n'eut qu'un
seul tort, c'est de me le montrer et moi, petit con, je n'ai
rien eu de plus pressé que d'aller raconter ça au facteur qui,
heureusement pour nous, était un brave homme et un patriote.
On ne se méfie jamais assez des enfants. C'est encore une
chance que papa ne m'ait pas montré également son pistolet et
ses cartouches...
Ils n'avaient pas inventé l'eau chaude
Retour à la table des matières
C'est la guerre, puis l'occupation
Je laisse la plume à ma
cousine Thérèse Wang-Vinant, qui saura bien mieux que moi
nous narrer ces épisodes de son existence de jeune fille.
Le 10 mai 1940, l'armée allemande envahissait les Pays-Bas
et la Belgique; d'où afflux de réfugiés vers la France. Les
troupes de Rommel avancent vers l'embouchure de la Somme,
enfermant sur Dunkerque les troupes françaises montées vers
la Belgique. L'avance allemande se poursuivant vers le
sud-ouest, toujours par des manœuvres d'encerclement, en
direction des ports: Rouen, Brest, Nantes, Bordeaux, elle
aboutit à la conquête d'un immense triangle, délimité lors
de l'armistice.
En ce qui me concerne (c'est toujours Thérèse qui parle)
l'équipée commence le 7 juin 1940, un vendredi. Mon père
nous avertit, ma mère et moi, que nous devions quitter Arras
et fuir en direction de Gros-Theil où vivaient nos parents
Loisy. Il nous y retrouverait dès qu'il le pourrait, avec
une grande partie du personnel de la banque (Il s'agit de la
Banque de France, où le père de Thérèse travaillait).
Titulaire du permis de conduire dès l'âge de 15 ans (réforme
instaurée par le gouvernement français en septembre 1939,
afin de permettre au plus grand nombre de remplacer les
hommes adultes partis combattre), je conduisis notre 202
Peugeot jusqu'à Rouen, puis Gros-Theil où nous fumes
accueillis par mon oncle Auguste et ma tante Marthe, très
tôt le matin du samedi 8.
Le même après-midi arriva un camion venu d'Arras, qui avait
roulé toute la nuit, où étaient entassés une douzaine
d'employés et leur proche famille, vautrés sur des sacs de
billets de banque et de lingots. La Banque à Paris,
informée, nous envoya d'abord vers Laval, puis à Quimper où
chacun put trouver un logement de fortune, financé par la
banque. Excellent accueil!
Ayant passé mon bachot en juillet 1939, j'avais entamé des
études universitaires à Lille, en vue d'une licence
d'allemand. Le cursus comportait en premier lieu un
«certificat d'études littéraires classique», échelon
incontournable pour préparer, en deuxième et troisième
années, trois autres certificats.
J'avais appris que l'Université de Lille (ainsi que toute la
population du Nord-Pas de Calais en cas d'évacuation)
s'était repliée à Rennes. La date prévue pour les examens
universitaires approchait. J'ai donc pris contact avec le
service des examens et je me suis rendue, un jour avant la
date indiquée, à Rennes par le train, munie d'un très mince
linge de rechange, mais alourdie par un pesant dictionnaire,
pour la version latine.
Le lundi matin, début des épreuves: la dissertation. Vers 10
heures 30, alerte: violente attaque aérienne sur la gare.
Nous descendons aux abris, puis on nous annonce qu'il
suffira de remettre la dissertation partiellement rédigée,
ou le brouillon, que le latin sera supprimé et que nous
aurions à dénicher d'urgence un professeur qui nous fera
passer l'oral.
J'arrive à repérer où loge, dans la cité universitaire, le
recteur de l'Académie de Lille et vais le trouver. Il est
d'accord pour m'interroger, puis me congédie après un quart
d'heure. Il doit être environ 12 heures 30 / 13 heures. Que
faire? aucune hésitation: regagner Quimper. Pas question
d'utiliser le train, cible des avions. Je récupère mon
bagage, mange n'importe quoi et gagne l'ouest de la ville,
le mail, dans l'attente d'un quelconque moyen de transport;
un bus par exemple.
Or, au bout de ce mail, on distingue une route nationale; et
voilà qu'un grondement annonce le passage des troupes. Nous
nous approchons... pour voir un bataillon britannique en
retraite.
Las, trois fois hélas, horrible chute: c'est un long convoi
de l'envahisseur allemand en route vers la côte. Après le
dernier camion, chacun reprend ses esprits et pense à
rentrer chez soi. Le bus annoncé vers Plélan, Ploërmel, se
décide à partir.
En route, pas d'allemands: ils ont pris la direction de
Brest pour verrouiller le chemin des troupes française, en
retraite de la Normandie. Avec d'autres moyens de transport,
un tramway, un taxi, je parviens vers 19 heures à Vannes où
m'accueille ma cousine Odette Lefranc, accompagné d'un
mignon petit cousin Gérard, qui se traîne encore à terre:
juste quelques mois (un peu plus d'un an en fait).

Le papa est mobilisé. Odette
n'a pas de nouvelles. Elle téléphone à mes parents, m'incite
à rester chez elle le temps qu'il faudra.
Mais le lendemain matin, malgré son insistance, je reprends
la route vers Quimper: qui sait si la banque ne va pas
expédier mes parents vers Nantes ou Toulouse? eux et moi
serions séparés par une ligne de front.
En utilisant divers moyens de locomotion je parviens, en fin
de journée, à Lorient, cherche dans cette ville de matelots,
peu sûre pour une fille de 16 ans, un gîte sûr: le lycée (ou
collège) de filles, sur une des collines. J'y suis
accueillie chaleureusement par la directrice. La nuit,
attaque du port en contrebas; spectacle imposant et tragique
à la fois.
Le lendemain, en route par un taxi collectif (d'où prix
modéré). Vers 12 heures il me dépose sur le quai de
Concarneau où, horreur, s'est installé tout un régiment
allemand: ceux qui sont arrivés la veille à Brest se
dispersent donc, en éventail, pour bloquer les ports l'un
après l'autre. Vers 13 heures, je trouve encore un taxi qui
veut bien me conduire à Quimper. En route, pas la moindre
trace de militaires allemands. C'est une tactique de guerre
de mouvement et non une dense occupation.
Vers 15 heures j'arrive en vue du quartier, un peu extérieur
(Locmaria?) où nous logeons et arrive chez mes parents,
alors que ma mère sert un rapide dessert à mon père, juste
avant qu'il ne prenne la route en direction de Concarneau, à
ma recherche. Quelle chance inouïe nous avons eue; nous nous
serions manqués!
Nous avons encore séjourné à Quimper quelques semaines avant
d'être renvoyés sur Paris, en attendant le retour à Arras
rendu difficile à cause de la ligne de la Somme: au nord de
la Somme, une région destinée à être annexée comme
«Westmark» et dirigée depuis Bruxelles; au sud de la Somme,
la France occupée.
Un autre évènement se produisit pendant notre séjour à
Quimper. Quelque jours après mon retour de Rennes, mon père
reçut une mission et je l'accompagnai à Concarneau. Sur le
port nous rencontrâmes l'équipage d'un petit thonier qui
nous raconta l'histoire suivante: peu avant, ils avaient été
contactés pour charger de gros sacs apportés par des gens de
la Banque de France et pour les transporter vers un des
ports de l'Atlantique, là où il n'y avait point de troupes
allemandes. Ils partent donc vers Saint-Nazaire, mais
aperçoivent depuis le large des signes de violents combats.
Ils descendent donc alors vers La Rochelle: idem. Bordeaux,
Arcachon, Biarritz: même chose. Les allemands allaient plus
vite qu'eux. «Nous n'allions tout de même pas aller à
Casablanca ou à Dakar: nous avons notre famille ici».Ils
sont donc remontés à Concarneau, ont prévenu la Banque à
Quimper, c'est pourquoi mon père, juste venu s'informer, a
fait venir une camionnette qui a tout rapporté à Quimper.
«Ben vrai!» ont dit les marins «on ne se doutait pas de ce
qu'on transportait. On aurait pu découper un sac et sortir
peu à peu l'argent pour mener grande vie!»
Quelques semaines plus tard, la Banque de France centrale à
Paris émit un ordre, certainement sur injonction de Vichy et
du gouvernement allemand. Les importants fonds provenant des
coffres d'Arras et transportés en camion vers Quimper
étaient la propriété de la Grande-Bretagne. Ils avaient été
déposés, dans les premiers mois de la guerre, dans les
coffres de la Banque à Arras. Pourquoi Arras? Arras était le
siège principal de l'état-major britannique en France,
dirigé par Lord John Gort, séjournant au château d'Habarcq,
commune proche. La Banque de France dut donc livrer aux
allemands les fonds (espèces et or) qui avaient transité par
Arras, Quimper, le thonier, de nouveau Quimper puis Paris.

Thérèse sur sa carte d'étudiant
Retour à la table des matières
Souvenirs du passage de Thérèse
au cours Montalembert.
Le texte qui suit m'a été
confié par ma cousine Thérèse Wang-Vinant et j'ai pensé
qu'il avait largement sa place sur cette page.
Mon professeur de piano
à Arras, largement connu dans le milieu des Mines de
Noeux-Béthune, avait parlé de moi à Mademoiselle Collet,
directrice du cours Montalembert, comme d'une étudiante
préparant le dernier certificat de licence d'allemand. Je
fus donc admise à la rentrée de 1942.
Je venais deux fois par
semaine par train omnibus Arras - Lens - Bully-Grenay. A
l'époque de l'occupation allemande, un ou deux wagons
étaient réservés à l'armée allemande. Dans les autres
wagons s'entassaient les voyageurs français dans un
inconfort inimaginable aujourd'hui. L'accès aux toilettes
était presque impossible, tant on était serré. Parfois des
attentats de la résistance par explosifs sur les voies
rendaient les parcours aléatoires. Au début de 1944
commencèrent les attaques aériennes des Anglais sur tous
les nœuds de communication. Quand le train passait au
ralenti à Avion, Lens et Loos-en-Gohelle, on pouvait voir
les ravages. La situation empirant, je fis en mai -juin 44
les trajets à vélo, avec les côtes de Sainte Catherine au
sortir d'Arras, puis de Souchez. Les routes étaient
pratiquement vides, c'était moins risqué que le train.
Côté professeurs le
cours Montalembert formait une véritable communauté sous
la direction de Mademoiselle Collet, remarquable pédagogue
et administratrice. Elle avait auparavant dirigé à Arras
le « Cours Mahaut d'Artois », sis rue du Marché au Filé et
y avait regroupé une petite équipe pédagogique qui dut en
mai 1940 se réfugier à Berck. Ce sont les mêmes fidèles
qu'elle a emmenées en partie à Bully-Grenay. Au cours des
conversations de table, j'ai compris que la direction des
Mines de Noeux-Béthune avait décidé de créer une
école primaire et
secondaire, mise à la disposition des familles
d'ingénieurs, afin que les enfants soient scolarisés sur
place et n'aient pas à être internes à Lille, Lens ou
Béthune. Cela épargnait à ces jeunes des déplacement très
difficiles, le séjour dans des internats mal chauffés et
des repas spartiates à base de rutabagas dans les
cantines. Les familles préféraient de beaucoup se
débrouiller avec les cartes de rationnement officielles,
heureusement complétées par les moyens du bord.
Le personnel enseignant
logeait en partie aux étages du cours Montalembert, en
partie dans une maison de l'autre côté du passage à niveau
menant à Mazingarbe. Il se composait de: Mademoiselle
Collet (français et philo), Melle Selosse (math et
physique), Melle Robillard (une des classes primaires),
Melle France Emerat (anglais), Melle Marcel (anglais),
Melle Bernadette Sagot (français, latin, grec) succédant à
sa sœur Solange pendant l'année 42-43, Melle Mathey qui
remplaça Melle Sagot en 43-44. Les repas des professeurs
étaient pris en commun; Aifréda la cuisinière officiait
sous l'égide de Mme Selosse qui faisait fonction
d'intendante. Elle se débrouillait fort bien en cette
période de pénurie. Y avait-il là un soutien en
ravitaillement de la part des Grands Bureaux ? Quant à
moi, quand je travaillais deux jours consécutifs, je
disposais d'une chambre à l'étage de l'école de la Cité
des Brebis, non loin de l'église. J'avais parfois quelques
loisirs. Je me souviens avoir aidé Alfréda à cueillir au
jardin les fraises du dessert. Le temps de ramasser une
bonne livre de fruits, le bord de l'assiette était tout
gris de la poussière dense émise par l'usine de
Mazingarbe. A l'époque on n'appelait pas encore cela:
pollution.
Très vite j'ai pu
observer la structure d'une société très hiérarchisée
disposant d'institutions sociales : logement, écoles,
églises, salles de réunion, etc. avec les grands, moyens
et petits chefs. Les grandes villas dans des parcs, les
villas moyennes dans des jardins assez grands, des maisons
mitoyennes avec jardinet reflétaient exactement cette
hiérarchie.
Notons que la classe des
porions et ouvriers mineurs échappait à mon champ de
vision je ne voyais les corons que dans la cité des Brebis
et lors de mes trajets de la gare au cours Montalembert.
Les Grands Bureaux évoqués lors des conversations de table
m'apparaissaient comme une entité mythique et
bienveillante régnant sur un empire. Des noms revenaient
de ci de là, qu'il fallait invoquer en cas de besoin. Les
collègues qui logeaient sur place étaient très souvent
accueillies par les familles et des relations confiantes
et amicales s'étaient nouées.
Un détail concernant les
trajet de la gare au cours Montalembert: un jour, au lieu
du parcours interminable à pied dans les rues au cour de
Bully, puis au delà du pont ou du passage à niveau vers
Grenay dans un décor de halls d'usines, j'ai eu la chance
de profiter d'une voiture à cheval (il n'y avait alors pas
de taxi) mise à la disposition d'un ingénieur allant à
Mazingarbe. Assise à côté du cocher, j'étais aux premières
loges pour humer les effluves du crottin et des pets du
coursier.
L'essentiel de mes
occupations au cours Montalembert, c'était bien sûr
l'enseignement de l'allemand. Je n'avais aucune expérience
pédagogique. La première année j'avais une classe de 5ème
une de 3ème et un regroupement de 2de et 1ère J'ai
conservé un très bon
souvenir de ces élèves
qui étaient bien élevés et très ouverts. J'ai parfois été
invitée dans les familles. Je me rappelle surtout
l'accueil de Madame Fourt qui avait préparé un goûter avec
des gâteaux, un luxe à l'époque. Elle m'avait donné sa
recette, je l'ai oubliée, elle était sans
doute à base de farine
de haricot ou de pomme de terre, à défaut de beurre et de
farine de froment.
L'année suivante, ces
5èmes sont devenus des 4èmes. Outre l'allemand j'ai dû
leur enseigner l'histoire, ce pour quoi je n'avais d'autre
qualification que mes souvenirs scolaires et l'aide d'un
manuel et un tout petit rien de culture générale. Le
sujet, c'était le Moyen Age.
Entre autres sujets il y
avait les démêlés du Saint Empire Romain Germanique avec
le Saint- Siège, période particulièrement complexe. Tout
ceci a dû passer par dessus la tête des pauvres mignons.
L'un d'eux, interrogé, a déclaré que le pape était assisté
de sous-papes; un autre a écrit que le pape faisait des
bulles avec des canons. Mine de rien, ces deux jeunes
manifestaient déjà un goût prononcé pour la technique, ce
dont leurs pères auraient pu être fiers.
Au printemps 44, les
alertes aériennes nous forcèrent à descendre souvent dans
l'abri souterrain aménagé dans le jardin, un plan incliné
avec escalier, une galerie. La situation devint si
dangereuse que je renonçai à venir d'Arras pour assurer
mes cours. C'est ainsi que cessèrent mes fonctions au
cours Montalembert. A la rentrée suivante, j'enseignai à
temps complet au Collège de Filles d'Arras. Mais je suis
restée en relation très amicales et suivies avec plusieurs
collègues. J'avais tiré un grand bénéfice de mes premiers
contacts avec des scolaires sous la tutelle bienveillante
et avisée de Mademoiselle Collet.
France-Allemagne
La période allant de 1939
à 1945 n'a pas toujours été facile, même si dans mon
souvenir je n'ai jamais manqué de rien. Juste avant le
début de la guerre, mes parents avaient acheté un petit
chat siamois et comme les siamois se nourrissent de riz,
c'est bien connu, le vendeur leur avait également refilé
20 kilos de brisures de riz. Le chat n'en a jamais vu la
couleur (et d'ailleurs il n'aimait pas trop ça), mais à la
maison nous n'avons pas manqué de riz pendant toute la
durée de la guerre: ça faisait des envieux.
Pour le reste on se
débrouillait. On avait un grand jardin. On y avait planté
quelques topinambours et rutabagas, sans doute pour faire
comme tout le monde car on aurait aussi bien pu cultiver
autre chose de meilleur. Il y avait également un
poulailler qui assurait les œufs et un minimum de viande.
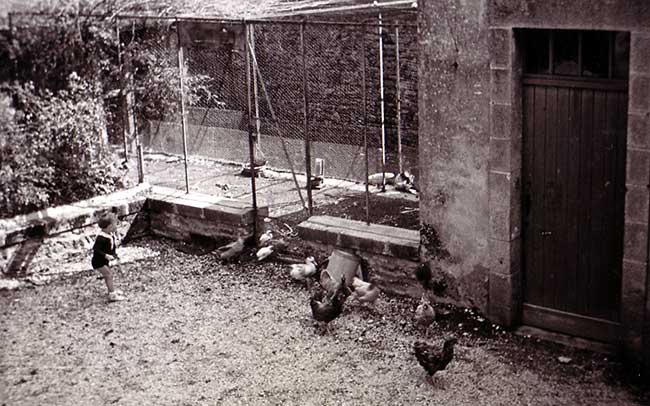
J'ai souvenir d'avoir aidé à couper du lierre dans le jardin pour, une fois réduit en cendres, faire de la lessive. Je me souviens également de plans de tabac au fond du jardin, dont les feuilles amoureusement séchées et roulées, avaient donné naissance à de magnifiques cigares, tellement rudes qu'ils étaient infumables.
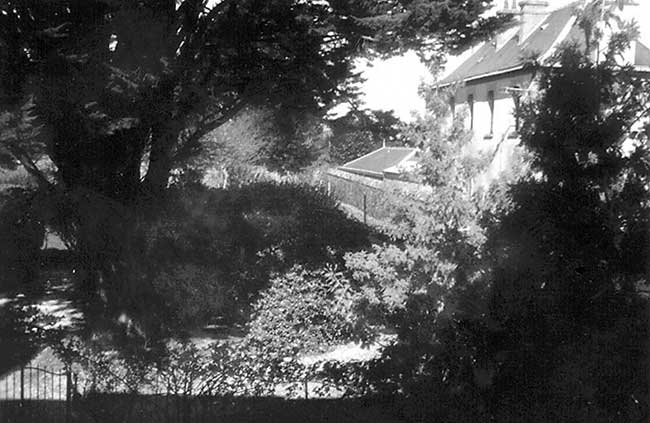
Rationnement donc et surtout des queues interminables. Le lait, par exemple, ne pouvait être acheté à Vannes qu'en un seul endroit dit "la goutte de lait". Comme c'était à peu près en face de l'école maternelle où j'allais, on m'y laissait garder la place dans la queue, avant l'école, pendant que Mathurine faisait la queue ailleurs.
On m'a raconté également que, le bruit courant qu'on trouvait de tout à Belle-Ile et en particulier du tabac (car les îliens ne faisaient guère usage des tickets de rationnement, préférant chiquer), papa et un ami à lui ont décidé de faire la traversée. Papa s'était construit un petit dériveur, un Sharpy de 9 mètres carrés, avec lequel il avait même participé à des régates qui avaient eu un grand succès à Arradon, dans le Golfe du Morbihan et dont l'arrivée, au vent arrière, avait vu passer en tête un spi bleu, un spi blanc et un spi rouge, à la grande joie des spectateurs (les allemands présents avaient préféré ne rien remarquer).
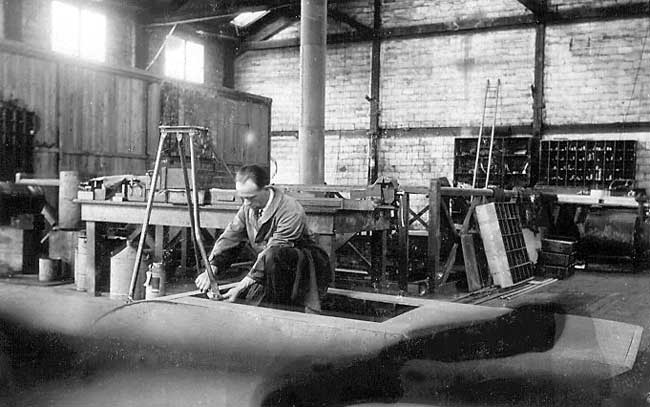
La construction du bateau: le "Simplet" en 1937
Donc les voici partis un beau matin, avec la marée, en direction de Belle-Ile. Or, il était interdit de sortir du Golfe sans autorisation. À peine franchi le goulet de Port-Navalo, le petit bateau est intercepté par une vedette allemande. "Papiers! Où allez vous? " - "nous nous rendons à Belle-Île". Dans quel but? L'ami de papa était horticulteur à Vannes, cela figurait sur ses papiers. Il répondait donc sans se démonter: "nous allons y exterminer le doryphore". Alors passez. Sans doute ces allemands là ne savaient-ils pas que les français les surnommaient "doryphores" car ils consommaient toute leur production de pommes de terre...

Le simplet dans le Golfe
Retour à la table des matières
Masque de cuisine
Instruit par les tristes
épisodes de la Grande Guerre le gouvernement français,
toujours en retard d'un guerre, avait envisagé en 1939 la
possibilité d'attaques au moyen de gaz asphyxiants. Il
avait donc fait faire des masques à gaz, en grand nombre,
destinés à la population civile.
Chacun devait aller
retirer son masque à la mairie et mes parents sont donc
revenus un jour à la maison avec des masques pour toute la
famille, enfin, presque toute la famille car on n'en avait
prévu que pour les adultes. On n'avait sans doute pas eu
le temps d'en faire de petites tailles: d'avance nous, les
enfants, étions sacrifiés! Quoique je me souvienne avoir
vu un voisin en adapter un pour son gros labrador.
Nous n'avons
heureusement jamais eu l'occasion de les utiliser et, à ma
connaissance, les gaz de combat n'ont pas été employés
lors de la seconde guerre mondiale. Les masques sont donc
restés longtemps à la maison, jusqu'à ce qu'il nous soit
demandé de les rendre. Mais Mathurine, notre bonne, en
avait trouvé une bonne utilisation: elle mettait son
masque pour éplucher les oignons...
Le locataire allemand
Nous habitions un grande
maison, à l'entrée de Vannes; aussi la Kommandantur y
réquisitionnait-elle une chambre pour un de ses officiers.

la maison de vannes (Alain et moi y sommes nés)
et la fameuse auto (Peugeot 402 B légère)
Les rapports avec notre
locataire restaient en général distants, on le comprend,
même si certains faisaient de réels efforts pour se faire
accepter. L'un d'eux en particulier, ingénieur chimiste à
Cologne, s'était montré particulièrement aimable. Rentrant
d'une permission en Allemagne, juste après la naissance de
mon frère, il nous avait ramené une bouteille d'eau de
Cologne pour maman et un gâteau fait par sa femme. On ne
vit tout de même pas dans un monde de brutes.
Mais ce retour de
permission avait aussi été l'occasion d'une grande
surprise pour lui. L'École Normale voisine de la maison,
qui avait été transformée en caserne allemande et où
logeait son unité, était totalement vide. On pouvait nous
même le constater depuis nos fenêtres: plus un homme, plus
un véhicule. Papa lui dit qu'il étaient partis la veille,
après avoir repeint de blanc tout le matériel; ce qui
manifestement voulait dire qu'ils étaient en route pour le
front de l'Est.
L'officier nous déclara
qu'il fallait absolument qu'il rejoigne ses hommes. Mes
parents se dirent qu'à sa place ils n'auraient pas été si
pressés; mais à chacun sa façon de voir. Une armée en
marche ne se déplace pas rapidement. Papa avait une auto,
immobilisée faute d'essence depuis le début de la guerre
et, par chance, qui n'avait pas été réquisitionnée. Il
accepta de conduire son locataire, si on lui fournissait
de l'essence. Pour les allemands ce n'était pas un
problème. L'auto eut un plein d'essence et ils
retrouvèrent l'unité de l'officier allemand du côté de
Pontivy.
Lorsque les deux hommes
se quittèrent, sachant la probable destination de
l'allemand, papa se dit qu'il n'y avait guère de chance
qu'ils se revoient un jour.
Mais un jour cependant,
je crois que c'était dans les années 70, on sonna à la
porte de l'appartement de mes parents. C'était notre
ingénieur (depuis en retraite) et son épouse. Ils étaient
passés à notre ancienne maison, avaient interrogé les gens
et fini par nous retrouver. L'affaire s'est achevée par un
bon repas et des libations telles qu'une fois encore cet
allemand, et sa femme, ont du dormir chez nous...
Les allemands ont mis papa en prison
Mais tout n'a pas été aussi
idyllique pendant cette sombre période de notre histoire.
Dénoncé on ne sait par qui, papa soupçonné de résistance fut
un jour arrêté. Il passa six mois en prison, d'abord à
Vannes, puis à Fresnes, où il mourut littéralement de faim.
Il a toujours été peu disert sur cette époque de sa vie. On
conserve dans la famille un petit jeu de cartes qu'il
s'était confectionné avec les marges d'un bible, donnée par
une église évangélique (le reste de la bible, hélas, dut
servir de papier hygiénique). Les symboles noirs étaient
dessinés avec de la suie mélangée d'eau et les rouges ont
été tracés avec son propre sang. Au bout de six mois
d'angoisse, se demandant chaque jour si on ne venait pas le
chercher pour l'exécuter, papa a eu droit à un procès, avec
avocat s'il vous plait, et acquitté au bénéfice du doute.
Certainement, un peu plus tard dans le cours de la guerre,
il n'aurait pas eu cette chance: la justice allemande était
devenue plus expéditive.
Papa avait été arrêté tôt le
matin et on n'avait pas voulu me réveiller pour que je
puisse lui dire au revoir. À mon réveil je l'ai donc appris
et aussi constaté que la maison avait été fouillée et que le
tiroir de la salle à manger qui m'était réservé pour mes
petites affaires personnelles avait été retourné et que tout
son contenu se trouvait au sol. Il ne manquait rien mais
j'ai un peu vécu cela comme un viol. Je n'avais pas encore
quatre ans.
Papa n'aimait pas trop évoquer ses souvenirs de la période où il a été emprisonné à Fresnes: cela lui faisait par trop revivre une période de sa vie qu'il aurait préféré oublier. Mais il lui arrivait tout de même parfois d'en conter.

Retour à la table des matières
La dernière puce
Avec sa peau fine de
blond, papa était un gibier de choix pour tout ce qui est
petit et qui pique. Moustiques, taons mais surtout les
puces semblaient faire un détour pour venir le piquer. Je
me souviens qu'il suffisait d'une seule puce dans la
maison pour qu'elle soit pour lui. Or de puces, à Fresnes,
ce n'était pas ce qui manquait et il en a beaucoup
souffert. Le plus gros de son temps - et ce n'est pas le
temps qui lui a manqué - passait donc dans la chasse à la
puce.
Il nous racontait aussi
que chaque matin, aux aurores, on entendait un ronde
allemande passant, au pas cadencé, dans les couloirs de la
prison. De temps à autre le bruit des bottes s'arrêtait à
la porte d'une cellule, qui était ouverte. Et l'on
n'entendait plus jamais la voix du prisonnier qui en était
extrait. Aussi lorsque ce terrible martèlement des bottes
passait devant sa cellule, chacun se recroquevillait sous
sa couverture, priant pour qu'il ne s'arrête pas chez lui.
Or, un matin, elles
s'arrêtèrent devant la porte de la cellule de papa, qui
fut ouverte. On le pria de prendre ses affaires
personnelles (cela se résumait à bien peu de choses) et de
sortir. Plus d'espoir. C'était la fin. On dit que lorsque
la dernière heure est arrivée, chacun se remémore toute sa
vie passé, comme dans un film. Papa assure que ce n'est
pas vrai, au moins en ce qui le concerne, car à cet
instant qu'il pensait être sans lendemain toute sa pensée
est restée focalisée sur une seule idée: "et dire que
j'avais attrapé hier soir la dernière puce qui restait
dans ma cellule... tout cela pour rien!". On le transféra
dans une autre cellule (celle là bien pleine de puces)
mais il eut la vie sauve.
Le téléphone
Une prison, derrière ses
grands murs, c'est un petit monde qui vit en vase clos;
mais qui vit bel et bien. Par les fenêtres des cellules,
les prisonniers arrivent à se parler, quitte à hurler et
même à se faire passer de petits objets. Les nouvelles y
circulent donc, de proche en proche, beaucoup plus
rapidement que l'on ne l'imagine. Pour améliorer la
communication, papa m'a dit qu'à Fresnes on utilisait
aussi le morse, frappé à petits coups dans les cloisons.
Comme presque personne ne connaissait l'alphabet morse on
l'avait toutefois remplacé par un code différent: les
lettres étaient numérotées par ordre alphabétique et
frappées en deux fois, une première série de coups pour la
dizaine, une seconde pour l'unité. C'était laborieux mais
ça permettait d'aller loin.
Un autre mode de
communication verbale était l'utilisation des
canalisations; chaque cellule ayant des toilettes. C'est
le vieux principe du téléphone dans un tuyau, auquel je
pense tout le monde a joué dans son enfance.
Un jour le bruit court
donc que la section des hommes venait d'accueillir une
prisonnière; sans doute le quartier des femmes était-il au
complet. Et chacun de fantasmer: une femme, alors qu'ils
n'en avaient pas vues depuis si longtemps! Les plus
proches voisins de la malheureuse, qui était complètement
affolée, réussissent à communiquer avec elle, par la
fenêtre et confirmer sa présence. Tout le monde alors
voulait lui parler. Il était un peu tôt pour lui enseigner
le pseudo-morse que les prisonniers maîtrisaient
parfaitement et on lui suggéra la communication par les
canalisations. Mais on eut beau lui expliquer le
fonctionnement, rien ne passait. Peut-être avait-elle la
voix trop faible, ou bien les voix féminines, plus aiguës,
se transmettaient-elles mal. Ses voisins lui ont donc
suggéré de placer sa tête jusque dans la cuvette des
waters, mettre sa couverture par dessus et crier le plus
fort possible. J'imagine la pauvre femme, encore toute
secouée par sa proche arrestation, dans cette position
ridicule mais pleine d'espoir. Espoir vain, car rien ne
passait.
Elle ne resta pas plus
de 24 heures dans sa cellule du quartier des hommes mais
on apprit par celui qui lui succéda que les toilettes
étant bouchées, elles avaient purement été simplement été
provisoirement condamnées et que la malheureuse, trop
troublée pour s'en rendre compte, s'était égosillée en
vain dans une cuvette non raccordée. Cela ne me fait même
pas rire.
On mourrait presque de faim
dans la prison de Fresnes, pendant la guerre. Un bol
journalier d'eau grasse baptisée soupe, un gros quignon de
pain noir et c'était tout. Un jour l'intendant de la prison
a reçu un tonneau de sardines en saumure qui étaient trop
avancées pour pouvoir être mises en vente, même par ces
temps de privation. Chaque prisonnier reçut alors, en plus
de la ration journalière, une sardine dont la puanteur
effraya tant papa, le premier jour que, se pinçant le nez,
il lui fit prendre illico le chemin des toilettes. Mais la
fameuse sardine revenant chaque jour au menu il eut vite
faite de se dire que, après tout, en y mettant les formes,
cette chose infâme était peut-être mangeable.
Après avoir soigneusement lavé et rincé la sardine sous le
robinet de son lavabo, il se tenta à en absorber un
minuscule morceau, dans un gros bout de pain. Et ma foi, ça
passait. Les autres prisonniers s'y étaient mis également et
chaque jour que dura le tonneau de sardines, le même rituel
de lavage-dégustation se poursuivit. Mais tout a une fin,
même un tonneau de sardines avariées. Lorsqu'il fallu
revenir au régime ordinaire, tout Fresne se mutina et on eu
parait-il bien du mal à calmer les prisonniers, en manque.
Revenu à la maison, une des premières choses que papa
réclama, ce fut de manger des sardines salées. Difficile à
trouver en ces temps où l'on manquait de tout. La guerre
achevée,maman finit par en dénicher un jour, dans une
poissonnerie et les ramena triomphalement à la maison. Papa
cria de bonheur et entrepris le rituel du lavage de la
sardine. Il faillit s'étrangler à la première bouchée:
depuis tout ce temps il avait complètement oublié que, à
moins de mourir de faim, la sardine salée ce n'est pas
vraiment un met de roi.
La pesée
Lorsque papa, avec un
autre petit groupe de prisonniers, fut relâché comme je
l'ai dit plus haut, leur première réaction fut d'aller
boire un café (ou ce qui, en ces temps de privations,
prétendait être du café). Puis la petit troupe se rendit
dans une pharmacie, pour se peser (car il y avait encore
des bascules dans toutes les pharmacies de France). L'un
avait perdu 12 kilos, une autre pas plus de 7, une
troisième atteignait presque les 20 kilos et soudain l'un
des hommes pousse un cri de stupeur: pendant son séjour à
Fresnes, il avait pris plusieurs kilos! On le regarda
bizarrement. Comme quoi il convient de toujours se méfier
des régimes amaigrissants.
Les baltes
De cette aventure, papa a
longtemps gardé beaucoup de méfiance vis à vis des
allemands et sursautait à chaque fois qu'il entendait
parler allemand. Mais, et c'est heureux, les temps
changent. J'avais fait connaissance, au cours d'un séjour
à Kiel, de deux étudiants de Lübeck avec qui j'avais même
fait du bateau sur la Trave, la rivière qui servait de
frontière à l'époque entre les deux Allemagne. Navigation
sur-réaliste où nous virions de bord à quelques mètres du
rideau de fer, sous les jumelles des "vopos" postés dans
leurs miradors. L'été suivant, nous avons reçu à Vannes la
visite de ces deux étudiants, qui faisaient du camping
dans la région et avaient conservé mon adresse. Papa, au
début, fit quelques efforts pour être aimable mais ils
parlèrent bateau ensemble et l'atmosphère se détendit
rapidement, au point que, les deux allemands n'ayant pu
trouver de place au camping de Vannes, qui était plein,
papa leur donna la clef de son bateau pour qu'ils puissent
y dormir confortablement, dans de bonnes couchettes.

le Biniou
Ils repartirent le lendemain,
enchantés de l'accueil mais je ne pus m'empêcher
d'interroger papa: "je croyais que tu n'aimais guère les
allemands?". Alors papa eut ce mot magnifique: "ce ne sont pas vraiment des
allemands, ce sont des baltes".
La belle équipée en ballon
Papa avait fait son
service dans l'aviation, à Angers et, par une
extraordinaire coïncidence, j'ai fait mes classes non
seulement dans la même caserne, mais aussi dans la même
chambrée que lui.
Il avait reçu une
formation d'observateur en ballon captif et était officier
de réserve; ce qui lui a valu de faire plusieurs périodes
militaires après son service.
Quelques photos sont sur mon site.
Au cours d'une de ces
périodes, à Toulouse, les réservistes avaient déniché au
fond d'un hangar un train de cerfs-volants qui avaient,
parait-il, été utilisés par l'armée lors de la guerre de
1870. Tout était en parfait état et l'envie de faire un
essai les a aussitôt tenaillés. On sort donc les
cerfs-volants, on les assemble, on les relie à un treuil
et les voici lancés dans le vent l'un après l'autre.
C'était très beau mais ça semblait terriblement instable.
Au dernier cerf-volant il ne restait plus qu'à fixer une
légère nacelle en osier et à désigner un volontaire. Tout
le monde se dégonfla et ce n'est sans doute pas plus mal.
Lors de la même période
militaire, je crois bien, papa fut retenu pour tenter de
battre un record de distance en ballon libre. On amène le
ballon dans la cour de la caserne, on l'équipe, on le
monte (c'était tout un cirque, avec des manœuvres et des
commandements bien précis). Les deux aérostiers prennent
place dans la nacelle et le ballon s'élève
majestueusement.
La météo était on ne
peut plus favorable et poussé par une légère brise le
ballon prend la direction du centre de Toulouse. Arrivé au
dessus de la place du Capitole, soudain le vent tombe. Ce
n'était pas prévu. Pendant toute la journée nos deux
aérostiers ont joué à saute-moutons avec les cheminées de
Toulouse avant que, vers le soir, le vent ne se
rétablisse, mais dans l'autre sens.
Ils ont posé le ballon
au milieu de la cour de la caserne, à l'endroit exact d'où
ils avaient décollé le matin même. Ce n'était certes pas
le record de distance attendu mais, dans son genre,
c'était un autre record: la plus courte distance parcourue
en une journée par un ballon libre!

Une "saucisse" dirigeable d'observation. Papa doit être sur
la photo
Lorsque la guerre est arrivée,
il est devenu évident que dans le domaine de l'aérostation,
nous n'étions plus dans le coup. Les quelques ballons qui
ont osé prendre l'air se sont fait descendre en quelques
minutes par la DCA allemande et l'on a renoncé, sauf à
utiliser des "saucisses" pour tendre des câbles et faire
ainsi barrage à l'aviation autour des villes. Je me souviens
en avoir vues dans la banlieue de Paris au cours d'un voyage
que j'avais fait avec maman dans l'espoir de visiter papa à
la prison de Fresnes. Maman n'avait pas été autorisée à
pénétrer dans l'enceinte de la prison mais sa cousine
Henriette a pu m'accompagner. Nous avons attendu plus d'une
heure, Henriette et moi, avant de devoir rebrousser chemin
sans avoir pu voir papa, même avec toutes les autorisations
officielles.
Aussitôt après la libération, papa qui avait été promu
capitaine s'est vu confier le commandement du terrain
d'aviation militaire de Saint Jacques de la Lande, à
proximité de Rennes, en attendant d'être démobilisé.

Il m'a raconté qu'un jour on
voit s'y poser un avion de chasse anglais, qui revenait
d'Allemagne et avait perdu son groupe (car seul le chef de
groupe était équipé pour la navigation; les autres
suivaient). Il avait pris plein ouest et s'était posé sur le
premier terrain d'aviation trouvé. On l'entoure, on le
félicite et l'accueil se termine par un pot au mess des
officiers. Là, l'aviateur anglais déclare: "au moins vous en Belgique
vous avez le sens de l'hospitalité". Il fallu le
détromper. Comme quoi avec un avion rapide, une erreur de
cap de quelques degrés a vite fait de vous amener dans un
autre pays.
Lorsque maman s'est trouvée
enceinte de mon frère, mes parents ont estimé que j'étais
assez grand, à quatre ans, pour être un peu informé des
choses de la vie et oublier les choux et autres cigognes. On
m'a donc expliqué qu'il y avait un petit bébé en train de
grandir dans le ventre de maman, bien au chaud, tout près de
son cœur, là où l'amour était le plus fort.
Je n'en ai pas demandé plus: à quatre ans on ne se pose pas
trop de questions et l'on est prêt à croire les adultes sur
parole. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de répandre la
nouvelle à l'école. En ces temps là, les gens étaient
nettement plus prudes que de nos jours et mes parents
avaient fait preuve d'audace novatrice dans leur
enseignement. La nouvelle fit le tour de l'école et une
délégation de parents est venue se plaindre que je racontais
des choses "dégoûtantes" à leurs enfants. Le directeur a eu
du mal, paraît-il, à les calmer et ramener les choses à leur
juste proportion.

maman attend un bébé
Pendant ce temps, la grossesse
avançait. Maman avait une amie qui attendait un bébé
pratiquement pour la même date qu'elle. Un jour où elle
était en visite chez nous je lui ai demandé d'ouvrir grand
la bouche. "Pourquoi
veux-tu que j'ouvre grand la bouche?" me dit elle.
Et moi "Je voudrais
regarder si on voit ton petit bébé à l'intérieur, près de
ton cœur". Mignon, non?
Maman a accouché à la maison, dans le grand lit où j'étais
né quatre ans avant et dont je donne la photographie une peu
plus haut. Lorsque les premières douleurs se firent sentir,
on m'envoya passer la journée chez une voisine, sous je ne
sais quel prétexte, et à mon retour on me dit que j'avais un
petit frère.
Tout excité j'ai demandé à voir le bébé, n'ayant pas trop
réalisé que c'était un garçon car on m'avait plutôt promis
un petit sœur. Il était là, dans son berceau (un berceau
familial où des générations de petits Lefranc se sont
succédés) et complètement emmailloté, comme on faisait
alors. Très étonné devant ce paquet blanc d'où seule une
petite tête émergeait, je me serais exclamé "il n'a pas de pattes, mon
petite sœur!".
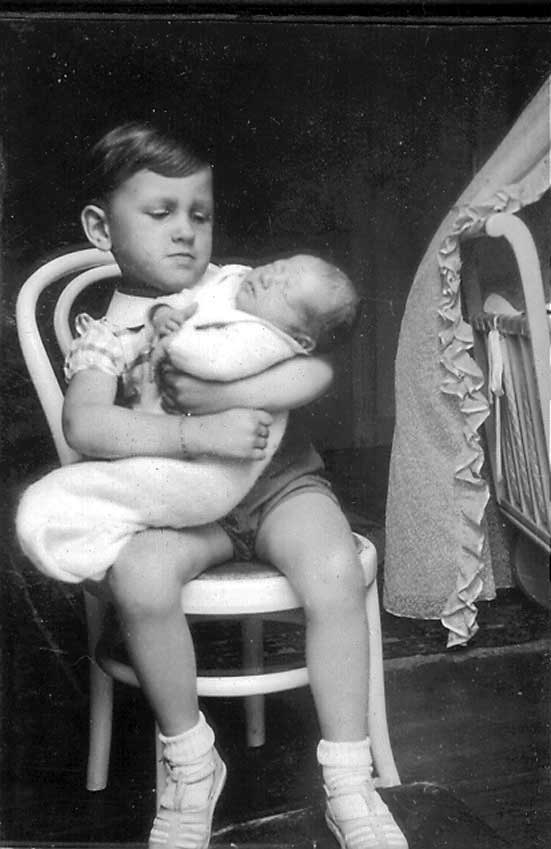
le petite sœur sans pattes
Retour à la table des matières
Le chemin de fer
Lorsque nous étions
petits maman nous chantait, comme le font toutes les
mères, des comptines du répertoire traditionnel. Mais il y
en avait une qui nous plaisait énormément et que je n'ai
jamais entendue ailleurs; peut-être l'avait-elle inventée,
à moins que ce ne soit une création de sa mère ou d'un
grand'mère (en fait je sais à présent, grâce à
l'obligeance d'un des lecteurs de cette page, qu'elle est
extraite du recueil "Chansons d'enfants" par Émile Jacques
Dalcroze). Elle disait (j'étais loin de me rappeler de
toutes les paroles, mais à présent j'ai la partition
originale...)
"Si nous jouions au chemin de fer. Ce
fauteuil serait la locomotive.
Ces quatre chaises seraient les wagons et nous les voyageurs
qui arrivent.
Achetons tous nos billets Tic, tic, tic
Cherchons un coin bien seulet Youp, youp; youp
Entendez vous le sifflet Sch, sch, sch
Nous voilà partis, nous quittons la ville. La campagne file,
file, devant nos regards ravis.
Nous prenons la fuite, vite, vite, vite. Et passons comme un
éclair, en chemin de fer.
Puis on prendrait dans notre panier de
la confiture, du gâteau aux pommes
Un petit verre de sirop de cassis. Ensuite on ferait son
petit somme.
Montrez-moi vos billets Tic, tic, tic
Et vous aussi s'il vous plait Tic, tic, tic
Voici l'tunnel c'est parfait Sch, sch, sch
Nous voilà partis, nous quittons la ville. La campagne file,
file, devant nos regards ravis.
Nous prenons la fuite, vite, vite, vite. Et passons comme un
éclair, en chemin de fer.
On descendrait notre sac du filet et mettrait son manteau par prudence
Tout le monde descend Vit' vit' vit
Et bonjour chère maman Mbf, mbf, mbf
Le train reprend son élan Sch, sch, sch
Le voilà parti, il quitte la ville. Comme il file, comme il file, mais peut-on filer ainsi?
Le train prend la fuite, vite, vite vite. Il passe comme un éclair le chemin de fer"
Cette petite chanson a été le prétexte de nombreux jeux et nous avons, mon frère et moi, beaucoup voyagé sur les chaises de la salle à manger...

Alain et moi en 1948
Une lectrice de ce site me signale que cette chanson du chemin de fer n'a pas été inventée par maman car elle la connaissait déjà pour avoir été utilisée au spectacle de fin d'année à l'école du Vieux Château, à la Chapelle en Serval (Oise), pour toute une classe de très jeunes enfants; sans doute en 1972. Mais elle n'a jamais su comment son institutrice l'avait connue. Comment voyagent les chansons...
Un autre lecteur (Claude
Razanajao) m'a contacté car lui aussi connaissait
cette chanson, et même les couplets suivants. Vous les
trouverez sur son blog
et je le remercie de m'en avoir fait part.
Cette passion pour les trains serait-elle familiale? On m'a raconté que mon grand-oncle Pierre Simon était un passionné du chemin de fer et qu'il passait des journées entières à la gare de Chalon, pour laquelle on avait fini par lui délivrer un laissez-passer permanent (il fallait encore des billets de quai, à l'époque, pour pénétrer sur les quais). Il avait appris et connaissait par cœur les horaires des trains de voyageur pour toute la France et pouvait vous renseigner de tête sur n'importe quel trajet, même le plus compliqué, donnant en prime le type de locomotive et d'autres renseignements de cet ordre. Comme cela ne suffisait pas à occuper sa mémoire, il était également incollable sur les hauteurs de tous les sommets montagneux du Monde ainsi que sur les longueurs de presque tous les grands fleuves.

L'oncle Pierre, lors de son mariage
Retour à la table des matières
Les vêpres
Je devais avoir dans les
deux ans et parlais déjà assez bien. Nous avions une jeune
bonne qui s'occupait de moi (c'était avant l'arrivée de
Mathurine) et qui me promenait tous les dimanches. Elle
rendait compte au retour: "nous sommes allés le long
du port puis j'ai amené le petit aux vêpres". C'était ainsi chaque
dimanche. Papa et maman se disaient bien que les vêpres ce
n'était pas trop pour un jeune enfant, mais enfin... quand
on a la chance d'avoir une bonne pieuse...
Un certain dimanche, de
retour de promenade, papa posa la question rituelle puis
il m'interrogea: "c'était beau les vêpres?" et moi "oh oui:
il y avait de la belle musique" mais j'ajoutai le détail qui
tue "... et puis je voyais tout parce que j'étais sur
les épaules d'un militaire". On cuisina un peu la bonne
qui avoua qu'elle m'emmenait chaque dimanche au bal en me
disant "viens, on va aller aux vêpres". Elle ne fit pas long feu
dans la maison et j'ai été privé de vêpres. Voilà comment
on sabote une bonne éducation religieuse.
Bouillies
Lorsque papa était petit,
on observait encore en Bretagne certains rites culinaires.
Le vendredi on mangeait de galettes de blé noir, très
épaisses, à la mode de la Haute Bretagne, que l'on
trempait dans du lait, souvent du lait ribot (ou babeurre:
un liquide au goût aigrelet qui se sépare de la crème lors
de la fabrication du beurre). Mais on consommait également
très souvent des bouillies, soit de blé noir que dans la
région de Malestroit on appelait "poux" soit, les jours de
fêtes, de blé alors dénommés "noces" (il existe dans le
pays gallo de nombreuses appellations assez semblables
pour ces bouillies).
Lorsque j'allais passer
les vacances à Chalon, chez les grands parents Simon je
découvrais un autre type de bouillies: les gaudes, à base
de farine de maïs grillé et à l'odeur particulièrement
appétissante. C'est un plat typique du Jura et de Bresse,
dont mon grand-père Simon était originaire; aussi y
tenait-il beaucoup, au grand désespoir de ma grand'mère
pour qui les gaudes n'étaient rien d'autre qu'un met de
paysans (pour ne pas dire de cochons). Grand-père et lui
seul, avait donc droit une fois par semaine à une grande
ration de gaudes, qu'il dégustait mélangées avec du lait
frais. Nous autres, les enfants, n'avions pas droit d'y
goûter et, bien entendu, nous en mourrions d'envie et
allions en cachette lécher la casserole à la cuisine dès
que le repas était achevé. Grand'mère désapprouvait mais
fermait les yeux. Tiens, savez-vous que les petites
galettes à base de gaudes se nomment "gaudrioles"?
À propos du maïs,
lorsque j'étais encore à l'école primaire, au cours privé
des demoiselles Le Pahun à Vannes (loué soit leur sens de
la pédagogie), la maîtresse nous a fait un jour un cours
sur le maïs, plante qui n'avait pas encore été introduite
en Bretagne, où elle est si courante aujourd'hui. Elle
conclu en nous disant "bien entendu personne
d'entre-vous n'a jamais vu de maïs.". Je levai le doigt et dit "si, moi
j'en ai vu". La
maîtresse pensa, voilà encore Gérard-qui-sait-tout qui
cherche à se faire valoir. Elle me demanda tout de même où
j'en avais vu et moi je dis "en
Bresse, dans la famille de mes grands-parents. Là bas il y
en a beaucoup et les maisons anciennes ont de grands toits
débordants en dessous desquels ils font sécher les épis de
maïs".
La maîtresse, estimant que
pour une fois mes connaissances sur le maïs excédaient les
siennes, me félicita et mit rapidement fin au cours.
Les têtes coupées
Pour les besoins d'une
kermesse organisée par l'Aéro-club de Vannes dont il était
le président, papa avait fait venir une table truquée sur
laquelle, par un ingénieux dispositif de miroir, on
pouvait voir une tête humaine vivante, dans un plat à
tarte, sans que le reste du corps ne soit visible. La mise
en scène avait été soignée. La tête se présentait le cou
entouré de coton hydrophile, avec des taches de (faux)
sang tandis qu'un un soupçon d'éther diffusé dans la salle
augmentait encore le réalisme. Je dois dire que même moi,
qui avais assisté aux préparatifs et connaissais donc le
subterfuge, avais été assez médusé du résultat.
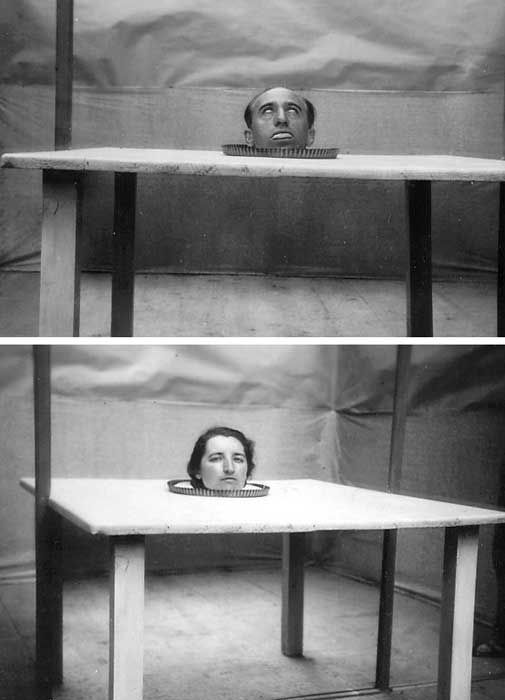
papa (qui en rajoute un peu) et maman
Nous avions réussi à traîner à
la kermesse notre bonne Mathurine (eh oui, nous avons eu
pendant plus de 20 ans, Mathurine à la maison, qui nous a
élevés mon frère et moi et faisait vraiment partie de la
famille). Elle en fut si impressionnée que, voyant la tête
de papa sur la table, et bien que sachant comme cela était
obtenu, elle fit un malaise et ne voulut plus jamais revoir
cette fameuse table.
Le trésor
Je devais avoir dans les
cinq ou six ans lorsqu'un jour, à l'issue d'une promenade,
papa me dit "avant de rentrer, il faut que je passe au
trésor". Au trésor? ainsi il y avait un trésor à Vannes?
et je n'en avais jamais entendu parler. J'étais excité
comme ce n'est pas possible lorsque nous sommes arrivés
devant un bâtiment austère sur lequel était écrit, en
lettre hautes comme ça TRÉSOR PUBLIC. Je savais lire. Il
n'y avait aucun doute. C'était écrit.
Nous avons pénétré dans
le bâtiment. Mon cœur battait très fort. Je m'attendais à
y trouver la caverne d'Ali Baba. Mais rien. Au lieu de
coffres débordants d'orfèvrerie, de perles et de diamants,
je n'ai eu droit qu'à de vieux bureau poussiéreux. Est-ce
donc à cela que ressemble un trésor? C'était pourtant bien
écrit. Le trésor de Vannes a été ma première grande
désillusion.
Mais allez donc savoir
ce qui se cache dans la tête des gosses! Le père d'un de
mes petits camarades était avocat et sur la porte de sa
maison se trouvait une plaque portant son nom avec, en
dessous, "Docteur en Droit". Pour moi c'était entendu, le
père de mon ami était un médecin, qui n'exerçait pas mais
qui en avait le droit et tenait à le faire savoir. Ce
n'est que beaucoup plus tard que j'ai appris où était
l'erreur.
Élise
J'ai passé tous mes étés,
jusqu'à l'âge de 13 ans, chez mes grands-parents à Chalon.
Vous dirai-je que moi, petit breton, j'ai appris à nager
dans la Saône? (à cette époque elle n'était pas encore
polluée et on pouvait encore s'y tremper sans en ressortir
malade). Il y avait deux baignades publiques, une assez
modeste avec un petit ponton et des cabines en tôle, non
loin du port fluvial qui grignotait du terrain chaque
année vers le sud, et un peu plus bas une autre plus
luxueuse avec des bâtiments en béton, où nous n'allions
jamais, pour faire des économies.
Un peu désœuvré, comme
tous les enfants en vacances, j'avais déniché dans la
bibliothèque de la maison un grand nombre d'anciennes
revues dont je me délectais (car j'adorais lire). Beaucoup
de ces revues dataient de la première guerre mondiale et
je vous laisse imaginer ce qu'on pouvait y lire, ou voir,
concernant les allemands! La propagande de l'époque ne
faisait pas dans la dentelle. Elle était beaucoup moins
subtile que celle de nos jours (quoique...) et, à
cet âge, on prend tout au premier degré. Je me faisais
donc, au fil de mes lectures, une idée de l'Allemagne et
des allemands qui tenait de la caricature la plus
grossière.
Or, habitait à une
centaine de mètres de la maison une ancienne domestique de
mes grands-parents, qui ne travaillait plus mais venait
encore donner un coup de main de temps à autre et qui
s'appelait Élise. C'était une Lorraine de Moselle, qui
avait fui sa région pour ne pas rester allemande. Mais
elle était née allemande, avait été à l'école allemande,
écrivait encore en gothique et parlait français avec un
accent germanique très prononcé.

Élise en septembre 1930
Cet exotisme à portée de main
fascinait l'enfant que j'étais et je n'eus de cesse
d'entreprendre Élise sur l'Allemagne et les allemands. Or
Élise n'était pas très bavarde mais, si elle n'avait guère
de sympathie pour les allemands, c'était une femme de tête
et pleine de bon sens. Elle eut tôt fait de remettre les
choses en place et de me faire comprendre ce qu'était une
mauvaise propagande. Ce dont je lui saurai éternellement
gré, car c'est ainsi qu'on apprend à se forger des idées
saines.
Le copain Pierre
Lors des vacances d'été à
Chalon nous allions régulièrement visiter deux sœurs de
grand-père qui louaient, pour partie, une vaste maison à
Givry, à une quinzaine de kilomètres de là. L'endroit
était agréable, paisible petit coin de Bourgogne niché au
pied de la Côte Chalonnaise. On accédait à la maison par
un grand porche surmonté d'un bâtiment à la toiture en
forme de dôme.
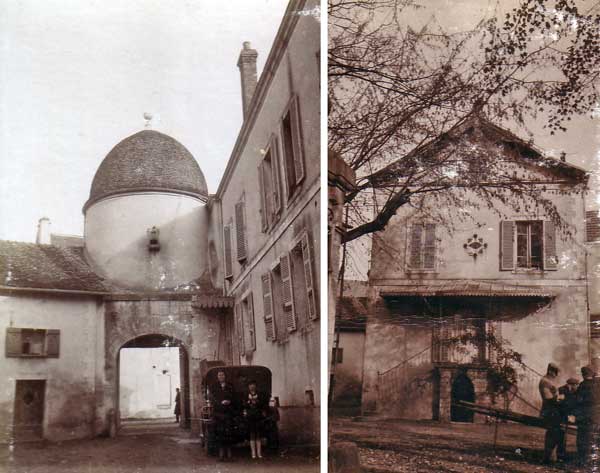
Derrière les bâtiments et la cour débutait une longue allée plantée de platanes, au milieu des vignes (les vins blancs de Givry sont réputés). Sur la gauche de l'allée il y avait une fontaine, petit édicule en pierres blanches, sans doute du 17 ou 18ème siècle, où un escalier en colimaçon descendait vers une source. C'était un endroit idéal pour jouer.

devant la fontaine en 1948: moi le plus grand et Alain en
barboteuse
L'allée débouchait, passé un
beau portail, sur une rangée de collines d'accès facile qui
constituaient un but de promenade très prisé. Du haut de ces
collines, lorsque le ciel était pur, ne pouvait-on pas
apercevoir le mythique Mont Blanc?
Un jour où nous étions à Givry, il y avait une foire sur la
place devant la maison. On fait un petit tour et je tombe en
arrêt devant un petit baigneur en papier mâché. Il me le
faut. Je le veux. Consternation des grands parents: les
poupées ce n'est pas pour le garçons. Je me suis montré très
obstiné et convainquant: "ce
n'est pas une poupée, les poupées ce sont des filles; lui
c'est mon copain Pierre". Va pour le copain Pierre
qui m'a accompagné et servi de confident pendant une ou deux
saisons, jusqu'à ce qu'il tombe en pièces et perde son
intérêt.
Grand'mère et ses écus
À la fin de leur
existence, mes grands-parents Lefranc s'étaient retirés à
Malestroit, ou ils avaient fait édifier une maison le long
du canal, sur des plans dessinés par papa. La maison était
surélevée par rapport aux constructions environnantes, de
façon à ne pas être inondée lors des crues régulières de
l'Oust et un petit jardin-terrasse avait été construit
devant la maison. C'est à présent devenu un hôtel.

Malestroit inondé et la maison des grands-parents
Face à cette maison, un bras de l'Oust non canalisé rejoint le canal de Nantes à Brest par un long déversoir sur lequel nous adorions aller jouer, étant enfants. Le bruit de l'eau s'écoulant sur le déversoir est assez fort. Il nous empêchait de dormir lorsque nous allions passer quelques jours chez les grands-parents, mais eux ils s'y étaient si bien accoutumés qu'ils disaient ne plus l'entendre.

c'est moi sur la terrasse, devant le déversoir, en 1952
Grand'mère est restée veuve en 1950, quelque temps après avoir emménagé, mais elle a encore vécu 10 années de plus dans cette maison.

les noces d'or, dans la maison de Malestroit, en 1945
Chaque début d'année, toute la
famille s'y rendait pour lui présenter ses vœux. Et
grand'mère se faisait une joie de distribuer ses étrennes à
chacun de ses 14 petits enfants. C'était rituel. Chacun
d'entre nous recevait un belle pièce de 5 francs, assorti du
conseil de la mettre à la Caisse d'Épargne, pour plus tard.
Au départ cet écu en argent représentait une jolie petite
somme, mais grand'mère n'avait pas vu passer l'inflation et
vers la fin de sa vie cette pièce, qui s'était muée en une
banale pièce de 100 sous en aluminium massif, ne nous
permettait guère plus que l'achat d'un caramel mou. Malgré
tout nous, les petits enfants, on jouait le jeu et l'on
remerciait bien grand'mère, heureux de la voir sourire.
Guignol
Pour nous distraire, papa
nous avait construit un vrai guignol, avec ses décors et
ses marionnettes dont les têtes, en papier mâché peint
étaient des petites merveilles. J'ai passé des journées
entières à imaginer des représentations, puis les infliger
à une famille résignée mais souriante. Rassurez-vous, cela
n'a nullement été le début d'une vocation de comédien ou
d'auteur dramatique. Mais de bons souvenirs tout de même.
Je regrette parfois que tout cela n'ait pas été conservé
et, probablement, pris le chemin de la décharge. Voici ce
guignol en 1945.

Retour à la table des matières
Le miracle
Peu après le décès de
grand-père une jambe de grand'mère était devenue
douloureuse, rouge et enflée au point qu'elle ne pouvait
plus marcher. Notre cousin Victor Lefranc, qui était
chirurgien à Roscoff et spécialiste des maladies osseuses,
mais qui venait souvent à Malestroit car il possédait une
propriété aux environs, diagnostiqua une affection
incurable des os, contre laquelle il ne pouvait rien
faire, sinon plâtrer la jambe de grand'mère pour qu'elle
ne souffre pas.
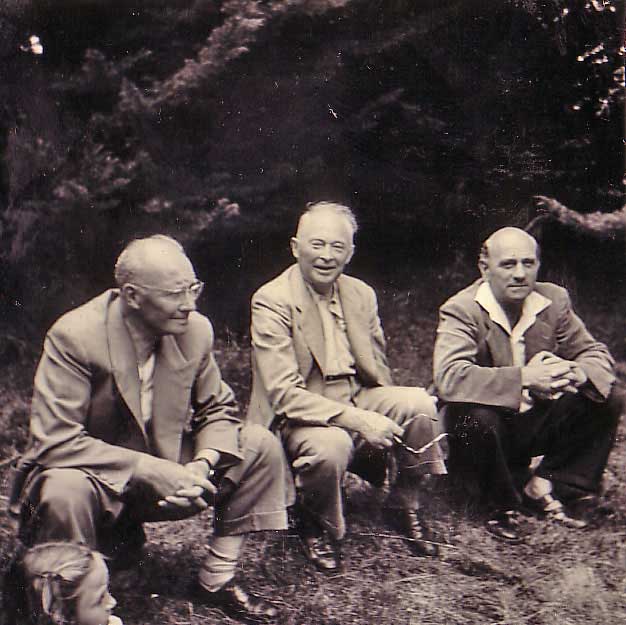
Albert - Victor - Émile Lefranc
À intervalles réguliers,
Victor venait remplacer le plâtre et ausculter la jambe
malade. Quelques années passèrent. Grand'mère aidée par sa
fille Madeleine, elle aussi restée veuve, se débrouillait
tant bien que mal mais ne quittait guère son fauteuil. Or un
jour, Victor ôtant son plâtre trouva une jambe parfaitement
saine, dégonflée et bien rose: plus aucune trace de la
maladie. Les réflexes étaient revenus et moins d'une heure
plus tard grand'mère, bien appuyée sur sa cane, pouvait se
déplacer seule et sans son plâtre.
Cette guérison subite et spontanée est restée inexpliquée.
Si cela s'était produit à Lourdes, nous aurions une
miraculée dans la famille, à coup sûr.
Histoire de coiffes
Grand'mère, dans de rares
occasions, portait la coiffe de Beignon. Le reste du temps
elle n'avait qu'un sous-coiffe, sorte de résille retenant
les cheveux, bordé d'un galon de velours noir. Elle
m'avait dit que la coiffe de Beignon avait été, une siècle
plus tôt, assez imposante, retenue sous le cou par un
minuscule nœud. Mais au fil des ans, le bonnet n'avait
cessé de rétrécir tandis que le nœud prenait de l'ampleur
et se portait de plus en plus bas. Comme quoi ce que nous
considérons aujourd'hui comme des costumes folkloriques
n'était pas figé un fois pour toutes: nos ancêtres étaient
coquettes et suivaient la mode. Il n'y a d'ailleurs qu'à
comparer, sur les photographies de cette page, les coiffes
de mon arrière-grand-mère Anne-Marie (née Desbois -
1829-1888) et celle de sa mère Marie-Françoise (née
Grellier - 1793-1867) pour voir que du côté de Langon la
coiffe avait également pas mal évolué.

Une des rares photos de
grand-mère Lefranc en coiffe, à mon baptême en 1939
Retour
à la table des matières
Après
m’avoir fait faire des débuts en primaire à l’école
publique, mes parents se sont saignés des quatre veines pour
m’envoyer dans le meilleur cours privé de Vannes. Cette
école particulièrement réputée, située non loin du port,
était tenue par deux sœurs, les demoiselles Le Pahun, qui y
appliquaient des méthodes pédagogiques originales et qui
feraient probablement bondir nos théoriciens actuels.
D’abord, c’était une école mixte: une incongruité à
l’époque. Il m’a fallu attendre d’être en terminale pour
retrouver une mixité, encore presque expérimentale et qui
avait beaucoup fait jaser.

ma première classe mixte, en 1957 (je suis le 3ème à partir
de la droite)
C’était
également la seule école libre de Vannes qui ne soit pas
confessionnelle. Même si les deux demoiselles ne cachaient
pas leur piété ni des opinions politiques assez à droite.
elles n’ont jamais tenté d’imposer quoi que ce soit en ce
sens à leurs élèves, estimant que ce n’était pas leur rôle.
Deux classes seulement, d’une douzaine d’élèves: les petits
et les grands. On dirait de nos jours CP et CM. C’était donc
presque des cours particuliers, ce qui explique en partie
l’excellence des résultats obtenus. Mais il n’y avait pas
que cela. Je ne me souviens plus si les élèves étaient notés
- je pense que si - mais ce système notation avait pour nous
tellement peu d’importance que je l’ai oublié. Par contre,
nous étions menés par tout un jeu de récompenses, auxquelles
nous attachions un grand prix.
D’abord des « bons points », de diverses valeurs,
qui étaient soigneusement conservés sur un trimestre car, le
dernier après-midi de chaque trimestre, avant les vacances,
était consacré à « la boutique ». Sur les tables
des classes, les deux demoiselles disposaient diverses
bricoles bon marché (jeu de billes, plumiers, buvards,
images pieuses, que sais-je encore?) avec leur prix en
« bons points ». L’offre était assez variée pour
que même les plus mauvais élèves puissent rentrer chez eux
ravis, avec au moins un de ces objets. Je me souviens que
nous attendions ces boutiques avec impatience, supputant ce
qui pourrait s’y trouver de nouveau et repartions avec nos
trésors le cœur gonflé d’orgueil. C’était très motivant.
À la fin de chaque trimestre avait également lieu une remise
de distinctions: des rosettes en tissu à coudre sur ses
vêtements: une rose pour le meilleur élève de chaque classe,
une bleue pour le second. Les heureux bénéficiaires les
arboraient avec beaucoup de fierté pendant trois mois,
persuadés que toute la ville en connaissait l’importance et
la signification.
Et pour couronner ce cycle de ces distinctions honorifiques,
à la fin de l’année scolaire étaient distribuées des croix:
de véritables décorations pendant au bout de leur ruban,
comme des vraies. Il n’y en avait qu’une par classe et elle
était attribuée en fonction du nombre et de la couleur des
rosettes acquises dans l’année: en principe, il fallait
trois roses pour avoir une chance de décrocher la croix.
J’ai oublié ce qu’il advenait s’il y avait plusieurs
candidats; peut-être les demoiselles avaient elles plusieurs
croix en réserve.

En 1945 ou 46, j'ai eu moi
aussi la fameuse croix
Les
programmes d’enseignement étaient très traditionnels et
particulièrement stricts. Ainsi les cours de français ne
portaient guère sur la littérature mais sur la langue,
orthographe et grammaire: dictées journalières, analyse
grammaticale, analyse logique, rédactions où la rigueur du
plan comptait autant que la richesse des idées… C’est ainsi
qu’on apprend sa langue maternelle et, vous pouvez me
croire, cela ne s’oublie plus. Pour les maths c’était la
même chose: exercices, exercices, encore des exercices. Il
importait d’abord de parfaitement maîtriser la technique, le
plaisir viendrait plus tard. Mais tout cela était fait avec
gentillesse et de façon tellement personnalisée que
personne, j’en suis certain, ne s’est jamais senti brimé ni
martyrisé. Lorsqu’il m’arrive encore de rencontrer d’anciens
élèves du cours Le Pahun, tous en conservent un souvenir
attendri.
Et puis il y avait toujours de petites excursions hors des
programmes, pas tant dans le but d’instruire que d’exciter
notre curiosité. Ainsi les plus âgés ont eu droit à une très
brève initiation au latin. Rien de bien poussé, mais de quoi
donner envie de s’intéresser à ce monde antique que nous
allions découvrir en 6ème, l’année suivante. Ça marche,
croyez moi. Quand je me suis retrouvé en secondaire, je
brûlais d’envie d’apprendre le latin et l’histoire ancienne.
Bon, ensuite…
Derrière la petite école se trouvait un petit jardin en
pente, qui servait de cour de récréation. Chaque élève qui
en faisait la demande se voyait attribué une minuscule
parcelle du jardin où il pouvait cultiver lui-même ce qu’il
voulait, en général des radis ou quelques fleurs à bulbe. Le
jardin devait être parfaitement entretenu. Toute négligence
d’entretien valait un premier avertissement, puis retrait de
la concession. Nous apprenions ainsi dès l’enfance à nous
responsabiliser; ce n’était pas une mauvaise chose.
Existe-t-il encore de telles écoles et un enseignement de ce
type? Je n’en suis pas certain. Les modes ont passé. Je
reste toutefois très reconnaissant à mes parents de m’en
avoir fait profiter. C’est avec tristesse que j’ai quitté
les demoiselles Le Pahun pour accomplir mon dernier
trimestre primaire au Lycée Jules-Simon; mes parents avaient
pensé que la transition avec le secondaire serait ainsi
moins rude.
Communiants
On a bien oublié de nos
jours à quoi ressemblaient les premiers communiants de mon
enfance. L'aube blanche, sans fioriture, a remplacé tout
le luxe vestimentaire de l'époque. Les filles étaient
habillées comme des mariées, en blanc, tout en voiles et
dentelles (comme ma tante Maddy ci-dessous en 1935; et il
y avait pire). Les garçons n'étaient guère plus modestes;
en costume "Eton" avec gilet et veste courte, noirs sur
pantalon gris perle, cravate assortie et un large brassard
blanc (moi en 1952, pour ma confirmation). Gants blancs,
missel à la main et chapelet étaient de rigueur. Des
images pieuses étaient distribuées pour l'occasion mais
dans les familles les plus aisées elles s'accompagnaient
d'une sorte de faire-part avec la photo officielle du
communiant, en grande tenue, pieusement agenouillé sur un
prie-Dieu. On est heureusement revenu à plus de modestie
car la compétition entre les familles étaient féroce et
lors d'une communion la fortune des uns s'étalait sans
vergogne face à la pauvreté des autres. On a, par contre,
perdu le coup d'œil.

Retour à la table des matières
En 1952, mes
parents m'ont envoyé passer deux mois en Angleterre chez des
amis de Molly, la fidèle correspondante anglaise de ma tante
Paulette avec qui nous sommes très longtemps restés en
relations, qui avaient un fils de mon âge, Roger, pour
lequel il était prévu qu'il passerait l'été suivant à Vannes
(en fait il n'a pas voulu venir). J'ai sur conservé les
lettres écrites à mes parents, pendant ce séjour en
Angleterre.

Molly (à gauche) en vacances en Bretagne en 1950
Je n'avais que 13
ans à peine et c'est la première fois que je voyageais à
l'étranger. Ce fut un choc. Mes parents m'avaient conduit à
Saint Malo pour prendre le ferry et ils m'ont raconté qu'à
la vue de ce bateau, qui m'avait semblé gigantesque, je m'y
étais engouffré sans même prendre le temps de leur dire
au-revoir. Arrivé à Southampton je pris tout seul le train
pour Londres ou Molly m'attendait. Elle me fit visiter la
ville pendant quelques jours puis me conduisit chez ses
amis.
Mes hôtes ne parlaient pas français. J'étais donc "dans le
bain" et cela s'avéra un excellent apprentissage de la
langue. Ils habitaient Sunburry, dans la banlieue ouest de
Londres, dans une maison exactement semblable à toutes les
autres maisons de la rue, et même des rues voisines, si bien
qu'à moins de retenir son numéro il était presque impossible
de la retrouver. Cela me surprit beaucoup. Tout comme je fus
surpris par la persistance, sept ans après la fin de la
guerre, d'avoir à utiliser des tickets de rationnements,
disparus en France depuis belle lurette. Nous avions droit
chaque semaine à un peu de viande et un œuf par personne qui
servait à faire l'omelette du samedi. Autant dire que ce fut
pour moi une période quasi végétarienne. Mais en tant que
touriste étranger j'avais eu droit à un supplément de
tickets de sucre et de savon, qui ont été très appréciés par
la famille qui me logeait. Ce fut également là que je vis la
télévision non pas la première fois (j'en avais eu un avant
goût l'été précédent, dans la vitrine d'un magasin du
boulevard de Port-Royal à Paris, non loin de chez la cousine
Henriette) mais chez des particuliers, en l'occurrence des
voisins dont il fallait m'arracher car je restais scotché
devant ce petit écran, presque rond, à l'image floue.
Le père s'occupait d'une troupe de scouts et un camp devait
avoir lieu, à Brighton, pendant mon séjour. On me fit
enfiler une tenue scoute (j'avais été louveteau quelques
années plus tôt, mais n'avais pas trop mordu au scoutisme)
et en route pour le camp.

louveteau en 1948...

... avant de devenir scout d'Angleterre
C'est un bon souvenir mais il m'est arrivé là une étrange aventure que, je crois bien n'avoir jamais osé raconter ensuite. Nous dormions sous la tente, par groupe de 7 ou 8. Une nuit je suis réveillé par quelque chose derrière mon dos. Je jette un œil prudent et découvre une personne, adulte, couchée tout contre moi. Apeuré, je me soulève et lui demande ce qu'il voulait, à voix haute (et sans doute avec un accent très français). L'individu prend peur, se lève d'un bond et s'enfuit, en réveillant toute la tente. On n'a pas trouvé trace de lui, sinon une paire de ciseaux juste derrière mon sac de couchage. L'encadrement s'est montré très gêné, à l'époque je ne comprenais pas pourquoi et on m'a prié de ne plus évoquer cet incident. Les jours suivants, un chef scout a partagé notre tente. Si cela s'était passé de nos jours, avec les psychoses actuelles, il est probable que ça aurait fait la une des journaux.
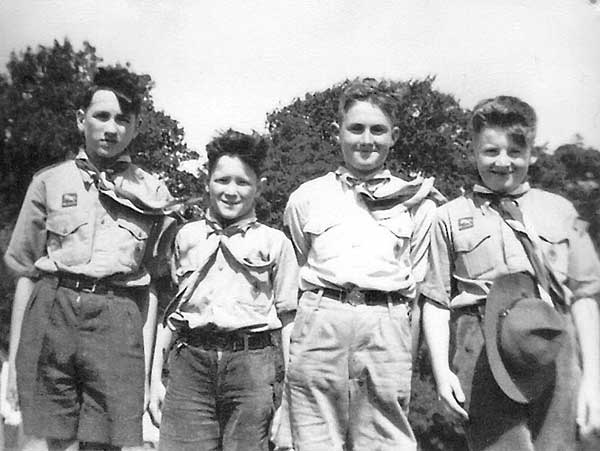
moi à gauche, Roger est les troisième
Retour à la table des matières
J'avais dans les 14 ans
et les gendarmes téléphonent à la maison pour signaler à
papa, en tant que président de l'aéro-club de Vannes,
qu'un petit avion de tourisme avec à bord un espagnol de
parlant pas un mot de français, venait de se poser sur la
plage de Damgan. Papa me prend avec lui pour servir
d'interprète car j'apprenais l'espagnol à l'école. Le
pilote était effectivement espagnol. Il venait
d'Angleterre où il s'était rendu pour acheter cet avion et
en revenant chez lui, à Bilbao, il s'était égaré et posé
sur la première plage trouvée, heureusement à marée basse.
Il a passé la nuit à la
maison et on l'a remis dans le droit chemin le lendemain.
Cet homme avait un fils, Jesús, à peu près du même âge que
moi et a proposé un échange linguistique à mes parents,
qui ont tout de suite accepté.
C'est ainsi que j'ai
passé deux étés à Bilbao ou, pour être plus précis, sur
l'aéroport de Bilbao où le père de mon correspondant
tenait un restaurant. Je dois dire que je m'y suis
copieusement ennuyé, surtout la première année car,
l'année suivante, j'avais la compagnie d'un cousin qui
avait profité du filon.

toute l'équipe du restaurant
Un soir la police téléphone à
l'aéroport pour signaler qu'un petit avion tournait à basse
altitude au dessus de Bilbao et qu'il avait même cherché à
se poser en pleine ville, sur un pont bien éclairé par deux
rangées de lampadaires! Quelques fusées éclairantes furent
lancées et le petit avion put repérer l'aéroport, qui
n'était pas bien loin, et s'y poser sain et sauf. C'était un
couple de français, d'un certain âge, qui venaient de Nice
et se rendaient à Bordeaux où ils étaient persuadés être
arrivés mais dont ils ne trouvaient pas l'aéroport. Juste un
petite erreur de cap: trois fois rien.
Quelques années plus tard, mon hôte a du fuir l'Espagne en
catastrophe, la police franquiste aux trousses. Il paraît
que ce brave homme, avait comploté contre Franco qu'il
estimait ne pas être encore assez de droite!! Il s'est
établi à Nantes où un cousin lui avait procuré du travail et
nous avons perdu sa trace.
Ma tante Maddy avait fait ses
études de pharmacie je crois bien à Dijon, puis à Lyon.
Alors qu'elle était encore étudiante et que ses parents
passaient quelques semaines en vacances chez nous, à Vannes.
Maddy se mit en tête de les rejoindre à l'issue de l'année
universitaire. Elle ne trouva rien de mieux que de venir
avec son vélo Solex. Elle prit son temps, elle pédala dans
les côtes, le brave vélo Solex fit ce qu'il put et se garda
bien de rendre l'âme avant d'être arrivé à Vannes. Mais
alors là c'était sans espoir. Maddy regagna la Bourgogne en
train. À mettre sans doute dans le Guiness de records.
C'était au mariage de ma tante Maddy. Mais auparavant il y avait eu les fiançailles, à Chalon, qui sont pour moi l'occasion de vous montrer une photo où l'on voit rassemblés mon grand-père Simon (un peu en retrait à l'extrême droite), son frère Pierre (devant lui) et à gauche du premier rang deux de ses sœurs.

Mais revenons au mariage. La cérémonie religieuse, qui avait eu lieu à la cathédrale de Vannes, avait été un peu écourtée par un enterrement qui suivait. La messe de mariage n'était pas achevée que déjà les pompes funèbres accrochaient leurs tentures noires autour du portail. La musique de l'orgue arrivait à peine à masquer leurs coups de marteaux. Il fallu sortir par un porche latéral, dans un grand va-et-viens de gerbes et de couronnes...

Ça vaut toujours mieux que
pour l'enterrement de papa où en sortant de Saint Paterne,
nous avons eu le plaisir de retrouver tous les pare-brise
des autos de la famille, restés garées le long de l'église
pendant la cérémonie, ornés de papillons que nous nous
sommes empressés, Alain et moi, de faire disparaître avant
que les cousins ne les découvrent. Nous avons payé un peu
plus tard. Je ne l'ai jamais raconté mais, à présent, il y a
prescription.
Le repas qui suivit le mariage de Maddy fut pris à la pointe
d'Arradon, dans un hôtel-restaurant dont tout le monde à
Vannes appelait la patronne "Marie Patate". On ne sait plus
très bien pourquoi mais on murmure que cela ne serait pas
sans rapport avec sa clientèle pendant l'occupation; les
affaires sont les affaires... Cela la mettait en rage car
son établissement avait quelques prétentions à être plutôt
sélect.
Je me souviens qu'entre la poire et le fromage, au moment où
les bons vins aidant (c'était ceux de la cave du grand-père
Simon), les langues se déliaient au fur et à mesure que la
conversation perdait de sa tenue, nous en arrivions à la
série des contrepèteries. Un cousin en sortit une difficile
mais dont je pense qu'elle était assez salée, comme toute
bonne contrepèterie qui se respecte. Personne n'en voyait la
solution... ou n'osait la prononcer à voie haute. Soudain,
au milieu du silence qui s'éternisait, grand'mère Simon se
penche vers le frère du marié, qui était à ses côtés et lui
donne la réponse à l'oreille. Le pauvre devient cramoisi,
manque de s'étrangler avant de lâcher un discret "voyons, voyons...". Et
ma grand'mère se redresse, l'œil coquin et dit "eh bien quoi, j'ai été jeune
moi aussi".

Retour à la table des matières
Souffler n'est pas jouer
J'avais dans les 15 ans
et faisais partie de la manécanterie de la cathédrale de
Vannes, tout comme mon frère. C'était assez contraignant
car nous devions assurer les vêpres, chaque dimanche
après-midi, avec les chanoines de la cathédrale (je pense
que tout cela appartient au passé à présent). Mais, se
disaient les parents, quand ils sont à l'église au moins
ils ne traînent pas dehors. Et puis je dois dire que même
si je trouvais cela un peu pesant, j'aimais assez ce
rythme de vie et l'ambiance de la mané.

Il y avait parmi les plus
grands un certain Yves Peigné qui prenait des leçons
d'orgue, d'harmonie et d'improvisation avec mon professeur
de piano. Ces leçons ayant lieu juste avant les miennes, je
m'arrangeais parfois pour y arriver en avance et en
profiter, fasciné par la rigueur avec lequel le professeur
imposait à Yves d'harmoniser à quatre voix, au piano et en
temps réel, les mélodies qu'il lui soumettait.
C'est alors que la place de titulaire de l'orgue de l'église
Saint Paterne devint vacante et Yves assura un temps la
succession. J'adorais monter avec lui à la tribune pour le
regarder et l'écouter jouer. Un grand orgue, vu et entendu
de près, ça a un côté fascinant et très physique: toute
cette mécanique précise et compliquée à portée de main, ces
sons puissants qui vous entourent et vous font vibrer tout
le corps, beaucoup plus que lors d'une écoute en bas, dans
la nef, l'impression de piloter une grosse machine, cela ne
s'oublie pas quand on a eu l'occasion d'y goûter.
Malheureusement, dans ces temps là, les services d'EDF
n'étaient pas aussi rigoureux qu'ils le sont devenus depuis
et les coupures de courant étaient encore assez fréquentes.
Alors c'était la corvée de soufflerie; et j'ai connu cela
plusieurs fois.
Les orgues, depuis le début de 20ème siècle environ, ont des
souffleries alimentées par un moteur électrique, mais par
précaution nombre d'entre elles ont conservé les anciens
leviers ou pédales permettant de pomper l'air à la force des
bras, ou des jambes. À Saint Paterne c'était les jambes. On
se tenait au dessus de deux soufflets de taille moyenne, les
mains posées sur une barre en bois et en faisant porter tout
son poids alternativement d'un côté puis de l'autre, on
pompait l'air nécessaire aux soufflets principaux et à
l'alimentation des tuyaux. Je n'étais pas bien lourd à
l'époque (je me suis rattrapé depuis) et avais du mal à
assurer un débit d'air important. Lorsque Yves se laissait
aller, pour une sortie triomphale, à tirer plus de jeux que
je ne pouvais alimenter, j'avais à portée de main une
clochette au bout d'une corde, pour l'implorer de se modérer
un peu. De toutes façons, si c'est l'organiste qui joue,
c'est bien le souffleur qui commande.
Musique
Il y a eu pas mal de
musiciens dans la famille. Mon grand-père Lefranc,
lorsqu'il accomplissait son service militaire, avait été
affecté à la musique de son régiment. Il ne connaissait
pas une seule note et avait dû se mettre au solfège et
apprendre la flûte. Cela lui avait plu et il a continué à
en jouer toute sa vie. J'ai encore chez moi sa flûte et
ses méthodes et partitions, qui m'ont été confiées par ma
tante Yvonne lorsqu'elle a su que j'étais moi aussi
flûtiste. C'est une très belle flûte en bois, avec un
système de clef Tulou, qui doit avoir un âge canonique car
depuis le milieu du 19ème siècle au moins, les flûtes
traversière sont en métal (maillechort, argent, parfois en
or) et ont adopté le mécanisme Boehm. Je ne pense pas
qu'elle soit en très bon état de marche, le bois
commençant à se fendre.
Mon grand-père Simon était également musicien: il jouait du basson et, je pense, avec une certaine virtuosité car il tenait sa place avec assiduité dans l'orchestre du théâtre de Chalon, ce qui lui valait de connaître par cœur tout le répertoire classique d'opéras et opérettes, dont il aimait bien entonner un air à l'occasion. Cela ne l'empêchait nullement d'être par ailleurs président du Tribunal de Commerce de Chalon.

Maman, comme toute jeune fille de bonne famille au début du 20ème siècle, avait été mise très jeune au piano, sous la férule d'une dame dont la sévérité ne lui avait pas laissé, ainsi qu'à ses sœurs, de très bons souvenirs. Mais sans doute cette dame était-elle une professeur compétent car maman avait acquis un bon niveau. Il y avait deux pianos dans le salon de la maison de Chalon: un droit et un petit piano à queue qui se trouve actuellement à l'abbaye bénédictine de Kergonan.

Yvonne au piano - juin 1918
Je n'ai guère entendu maman
jouer car lorsque j'étais jeune nous n'avions pas de piano à
la maison et qu'elle ne pratiquait plus depuis longtemps,
mais elle m'a dit avoir donné en public à Chalon le sonate
pour piano et violon de Franck, ce qui suppose déjà une
grande virtuosité. Sur le tard maman a eu des velléités de
se remettre à la musique et je lui ai offert une flûte à
bec. Elle s'y est mise avec assiduité pendant quelques mois
mais le cœur n'y était plus et l'entreprise est restée sans
suite.
L'oie à l'ammoniac
Et a propos de Mathurine:
c'était Noël, dans les années 50 et nous avions réussi à
persuader Mathurine à prendre quelques jours de congés
(cela n'avait pas été facile). Nous avions quelques amis
pour le réveillon et maman avait préparé une magnifique
oie comme plat de résistance. L'oie était au four, on l'en
sort: c'était une splendeur, dodue, dorée, embaumante...
Le plat et l'oie sont posés au centre de la table, papa
saisit un grand couteau à découper et, d'un geste précis
et très professionnel, entame la découpe. Il se produit un
beau "plop" et l'oie s'affaisse, ne laissant que de la
peau et des os baignant dans au moins deux litres de
graisse fondue... Comme quoi, même en ce milieu de 20ème
siècle, l'élevage industriel commençait déjà à faire des
ravages.
Il fallu se résoudre à
ramener l'oie (ou ce qu'il en restait) à la cuisine. Elle
a fini dans la chaudière du chauffage central! Mais lors
de son retour en cuisine, maman fit un faux pas et un bon
litre de graisse finit sur la moquette.
On lava, on frotta, on
dégraissa, rien n'y fit et lorsque Mathurine revint de
vacances, la tache de graisse sur la moquette fut la
première chose qu'elle remarqua. Mathurine reçut des
explications embarrassées, auxquelles elle ne crut qu'à
moitié et dit "vous n'y connaissez rien, je m'en
occupe". On
préféra lui laisser le champ libre et lorsque la famille
regagna la maison, en soirée, il n'y avait plus la moindre
trace de graisse sur la moquette et une agréable odeur
embaumait la maison.
Papa demanda à Mathurine
comment elle s'y était prise et Mathurine répondit "avec de
l'ammoniac".
Cela nous laissa septique car la recette était connue et
nous n'en avions rien obtenu. Alors Mathurine ajouta "oh mais
pas de l'ammoniac ordinaire, je me suis servi du vieil
ammoniac que Monsieur garde dans la cave". Et là tout fut clair
lorsque papa s'écria "mon vieil Armagnac!!".

Mathurine
Retour à la table des matières
Par dessus bordJe devais avoir dans les 16 ans et comme bien des gamins de âge, me sentais tout puissant. Mes parents, peu contraignants et qui avaient confiance en moi, commençaient à me laisser sortir seul le soir, sans trop poser de questions, à conditions que je sois rentré avant 23 heures.
C’était une chaude soirée d’été, qui invitait à la flânerie. Les remparts de Vannes illuminés attiraient pas mal de monde. Mais après avoir marché un peu, me voici sur le port, pratiquement désert à cette heure, les cafés ayant déjà fermé. Et là je trouve une joyeuse bande de militaires américains en goguette (il y avait des manœuvres américaines dans la région), mais qui commençaient à ne plus trop savoir quoi faire. Belle occasion pour tester mon anglais. J’y vais franchement.
Les GIs un peu surpris mais amusés m’entourent et me laissent entamer la conversation. Et là ça dérape. Mon accent plus anglais qu’américain les interloquent. Et me voici traité de quelque chose comme « espèce de bâtard d’anglais ». Je proteste vivement, d’un « No! » très appuyé et probablement si britannique pour leurs oreilles, qu’il les conforte dans leur position. L’un d’eux propose de me balancer dans le port. On m’empoigne et j’allais passer un mauvais moment. Les quais faisant plusieurs mètres de haut et la marée étant basse je pouvais être tué en tombant dans la vase sèche, ou du moins sérieusement blessé.
Je me débats. Je hurle. En vain. Que pouvais-je faire contre une poignée de grands gaillards passablement éméchés dont un seul tentait, sans trop de conviction, de convaincre ses collègues de me laisser filer? C’est tout de même lui qui a laissé le temps d’arriver à la police militaire américaine, qui patrouillait dans le coin et avait entendu mes cris.
La MP ne plaisantait pas avec ce genre de choses. Tout ce beau monde s’est retrouvé menotté et prestement embarqué, puis on m’a conseillé de rentrer chez moi. Je ne me le suis pas fait dire deux fois, mais me suis promis d’être un peu plus prudent dorénavant avec les gens que je ne connaitrais pas.

C'était
en 1966, ma chambre en cité universitaire
Bien équipé pour l'époque (avec même la radio en
modulation de fréquence; ce qui était nouveau)
j'avais bricolé un réseau audio courant sur la façade de
la cité, grâce auquel les chambres voisines
une fois branchées pouvaient bénéficier de ma musique:
c'était très apprécié.
J'étais étudiant quand la Maison de la Culture de Rennes (actuellement TNB) a présenté un concert intégralement consacré à Olivier Messiaen. J'y assistais. Dans le rang devant moi se trouvait une personne fort désagréable qui, pendant toute la durée du concert n'a cessé de s'agiter et de maugréer. La musique qui était jouée, de tout apparence, ne lui convenait pas et aucun de ses voisins ne pouvait l'ignorer. J'ai été à deux doigts de lui dire que si cette musique le gênait tant, rien ne le retenait.
J'ai bien été avisé de me retenir moi aussi car à la fin du concert, cet homme grognon s'est levé, est monté sur la scène et a salué l'assistance: c'était Messiaen en personne, que je n'avais pas reconnu.

Olivier Messiaen
Dans le même genre, une amie
de mes parents, assez snob mais pas trop fine, s'était
rendue à Nantes pour une concert auquel devait assister
Francis Poulenc, dont on donnait une œuvre. Après le
concert, conviée au vin d'honneur, cette dame se fraie un
chemin jusqu'au compositeur pour le féliciter.
- Poulenc, aimable: "le
concert vous a t-il plu, madame?"
- la dame: "énormément et
pourtant, d'ordinaire, je n'aime pas beaucoup ce que vous
composez"
- Poulenc sur le ton de la confidence théâtrale: "entre nous, chère madame, moi
non plus"
Voyant que les gens qui se trouvaient autour d'eux se
mettaient à rire, la dame s'est éclipsée; mais n'a pu
s'empêcher de raconter ensuite la chose tout le monde.
Autre anecdote à caractère
musical (il ne s'agit pas de la famille mais je ne puis la
passer, tant elle est savoureuse). Un de mes amis, autrefois
organiste à Saint Brieuc m'a raconté qu'étant jeune et
faisant partie d'une chorale d'enfants, il avait participé à
la première d'une œuvre de Stravinski. Le maître, déjà âgé
(il est mort en 1971) avait fait tout exprès le déplacement
de New-York, où il s'était établi, pour assister à
l'événement. À l'issue du concert, mon ami se dit que
Stravinski était bien vieux, qu'il vivait bien loin et que
c'était sans doute pour lui la dernière chance de le voir
vivant. Aussi, accompagné d'un petit camarade de son âge,
est-il allé bravement frapper à la porte du compositeur.
Entrez! Les deux gamins (ils devaient avoir dans les 12 - 13
ans puisque mon ami avait encore sa voix de soprano) se
retrouvent, morts de trac, devant ce personnage illustre qui
attendait de connaître la raison de leur visite.
Mon ami, un peu plus âgé et plus hardi que son camarade se
décide. Il dit "Maître,
j'ai beaucoup aimé votre Sacre du Printemps".
Stravinski les toise derrière ses épaisses lunettes et
lâche, avec un accent russe très accentué et en roulant les
R "le sacrrre: oh,
errrrreur de jeunesse!". Mes deux compères
complètement décontenancés ont coupé court et tourné les
talons.

Igor Stravinski
Des années plus tard nous avons découvert, mon ami et moi, au hasard d'une conversation que bien des années auparavant et sans nous connaître, nous avions assisté à Paris au même concert, à l'église Saint Séverin: par Helmut Walcha, la première mondiale à l'orgue de l'Art de la fugue (J.S. Bach), œuvre majeure qui plus de 200 ans après la mort du compositeur n'avait encore jamais été donnée dans sa totalité (du moins à l'orgue). Je suis très fier d'avoir pu entendre la première exécution publique intégrale de ce chef d'œuvre et vous avoue avoir été fort ému lorsque j'ai pu visiter, à Leipzig, la discrète tombe de ce grand compositeur.

Ma tante Paulette, quatrième fille de mes grands-parents Simon, restée célibataire et toujours prête à aider les autres, eut une carrière compliquée. Cherchant à s'occuper, elle avait d'abord appris la sténotypie dans l'espoir de dénicher une place dans un secrétariat; sans succès (la sténotypie était un mode de notation quasi phonétique, jouant sur la similitude entre des lettres se prononçant presque pareil, comme B et P par exemple, ce qui permettait de concevoir des machines à écrire équipées de 10 touches uniquement et, par conséquent, de taper à la même vitesse que la parole. Ces machines furent très longtemps utilisée à l'Assemblée Nationale, pour retranscrire au vol les débats). Paulette a finalement trouvé une place d'assistante auprès de son ancien professeur d'anglais, Mademoiselle Hugon, qui était aveugle et enseignait encore au lycée de Chalon. L'Éducation Nationale était plus ouverte, en ces temps là, qu'elle ne l'est devenue car je ne suis pas du tout certain que cela serait encore possible de nos jours.

Après quelques années passée au Lycée elle du le quitter
lorsque la demoiselle prit sa retraite. Paulette trouva
alors à s'embaucher comme secrétaire dans un cabinet médical
de radiologie. Elle aimait bien ce travail, sans se douter
qu'il serait sans doute la cause de sa mort, car on prenait
peu de précautions à l'époque contre les rayonnements des
appareils de radiologie et que, très probablement, cela lui
vaudra le cancer du sang dont elle est décédée des années
plus tard. Mais qui sait?
Ma grand'mère étant restée veuve, Paulette et elle
quittèrent Chalon pour aller vivre à Nancy, à côté de sa
sœur Maddy qui avait une pharmacie à Laxou, dans la banlieue
de cette ville. Cherchant à nouveau du travail, Paulette se
décida à devenir préparatrice en pharmacie, de façon à
pouvoir être employée par sa sœur. Il lui fallu beaucoup de
courage car elle devait passer un CAP qui se préparait, si
je me souviens bien, en quatre ans (il a été remplacé par un
BP dont la formation n'est plus que de deux années).
Paulette s'inscrivit à la fac de Nancy, travailla dur au
milieu d'étudiants plus jeunes qu'elle d'au moins 20 ans,
mais arracha son diplôme à la force des poignets.
Elle n'arrêta de travailler que lorsque la maladie la
rattrapa. Hospitalisée à Villejuif elle subit une longue et
pénible chimiothérapie, encore au stade expérimental, mais
finit par s'en sortir et connut une rémission de plusieurs
années. Tout cela au prix d'un lourd traitement qui a fini
par l'achever. Hospitalisée à nouveau, on ne trouva pas
trace de cancer mais les médicaments qu'elle devait prendre
l'avaient épuisée. Il paraît que ses derniers mots ont été:
"je connaissais
l'expression mourir de fatigue; maintenant je sais ce que
cela veut dire".
En matière de
langues, le bricolage a parfois du bon, mais il peut
s'avérer catastrophique. Je me souviens d'un séjour à
Amsterdam (j'étais alors jeune architecte) où, au bout de
quelques jours, je me suis avisé que le hollandais, après
tout, ce n'était pas le Zuiderzee à boire. Prenez une bonne
dose d'allemand, ajoutez une soupçon d'anglais, quelques
petites délicatesses françaises, saupoudrez largement de
jotas espagnoles et le tour est joué.
M'estimant suffisamment batave pour tenter le coup, j'entre
dans un bar, m'assois au comptoir et commande une bière. On
me l'apporte aussitôt: ça marche! Vient le moment de régler.
Je demande le prix et le garçon me répond... en allemand.
Mon accent m'avait presque trahi!
J'ai payé la consommation et ai quitté le bar tête basse. On
ne m'y reprendra plus à jouer à l'indigène.

Quelques années
plus tôt j'avais fait une virée à Budapest, en auto-stop.
Mon chauffeur m'avait lâché quelque part en ville et,
m'indiquant une vague direction m'avait expliqué que je
devais me rendre à l'équivalent hongrois d'un syndicat
d'initiative: Ibusz (ou quelque chose comme ça). J'avise un
tram qui semblait suivre le bon cap et y monte (sans repérer
comment on payait, mais ce n'était pas trop grave). Quelques
stations plus loin je dis à mon voisin "Ibusz". Il me sort un
tas de phrases parfaitement hermétiques puis, voyant mon
incompréhension, me fait signe d'attendre. Deux minute plus
tard, il me conduit vers la portière: j'étais en face de ma
destination. Là j'ai trouvé un hôtesse parlant couramment
français, qui m'a procuré une chambre chez l'habitant et un
petit plan de la ville. J'étais presque sauvé. Ma logeuse
était une dame d'un certain âge, parlant un bon allemand que
moi je baragouinais. Mais ça suffisait. Elle m'a raconté
que, avant le rideau de fer, elle allait régulièrement faire
des courses à Vienne, qui n'est pas très loin et que, hélas
tout ça c'était fini. J'espère qu'elle a vécu assez
longtemps pour pouvoir flâner à nouveau à Vienne.
Une fois installé et après avoir satisfait aux formalités
d'enregistrement, au commissariat du coin (on badinait pas
avec la liberté, dans les républiques socialistes!), me
voici libre de faire une petit tour en ville.
Je quitte Buda, passe de Danube, déjà majestueux, et me
retrouve à Pest sur des grands boulevards, fort animés en ce
début de soirée.

les grands boulevards de
Pest... à l'époque
un ami hongrois m'a dit que ça avait bien changé depuis
Toutes ces
émotions m'avaient donné soif. j'entre dans une grande
brasserie arborant l'enseigne "Bisztró". Facile. Jusque là
tout va bien. Un garçon se présente. Je dis "bierre".
Incompréhension totale. "beer"? pas mieux. "bier"? nouvel
échec. Je tente le seul mot de russe que je connaisse
"pivo". Le garçon, qui avait certainement compris mais ne
voulait pas avouer qu'il parlait russe (obligatoire à
l'école), reste là à attendre.
De guerre lasse je dis "café" et ça marche. Je connaissais
donc au moins un mot de hongrois. Café avalé, je descend
vers ce que je pense être les toilettes et me trouve face à
deux portes, l'une marquée "Nök" et l'autre "Ferfiak";
certainement "Hommes " et "Femmes". Je ne voulais pas
commettre un impair et décide d'attendre qu'un utilisateur
se présente. Personne ne vient. Lassé d'attendre et pressé
par le besoin j'allais me résoudre à ouvrit la porte "Nök",
dont la consonance me semblait plus virile, lorsqu'un
monsieur descend d'un pas pressé et s'engouffre du côté
"Ferfiak". Je l'avais échappé belle. Le même jour je suis
retourné au syndicat d'initiative pour faire l'emplette d'un
petit lexique...
Je ne suis pas le seul de la famille à avoir exercé la profession d'architecte. Mon cousin Jean Florent avait également été architecte avant moi et Éric a pris la relève. Lorsque j'ai connu Jean Florent, il était en retraite depuis longtemps mais il a pris un réel plaisir à m'accompagner, à plusieurs reprises, à l'École des Beaux Arts de Paris où je venais régulièrement visiter des expositions de travaux d'élèves (dont les miens; cela faisait partie de l'enseignement). Nous avons longuement bavardé de nos études respectives, avec une grande complicité. Il m'a montré des projets qu'il avait faits lorsqu'il était étudiant, au début du siècle, surchargés de sculptures, volutes, guirlandes; et encore, me disait-il, je passais pour être un des plus sobres de l'atelier. Mais c'était la mode à cette époque. Les temps ont changé mais ce qui n'avait apparemment pas changé c'est l'ambiance des ateliers d'architecture aux Beaux-Arts et les méthodes d'enseignement. À plus de soixante ans d'intervalle, je retrouvais en discutant avec lui exactement le même atelier que celui où j'étudiais à Rennes. Rien n'avait changé et nous pouvions encore entonner à tue tête le fameux "pompier" comme aux bons vieux temps. Mai 68 est passé depuis et les bouleversements dans les écoles d'architecture ont été grands.
Tiens, et pourquoi le pompier? on dit que les peintres du 19ème siècle, très portés sur les sujets allégoriques, coiffaient leurs modèles de casques de pompier en cuivre, assez faciles à trouver. D'où l'expression "style pompier" et la chanson, devenue l'hymne des Beaux Arts.

la fanfare de l'école... et les casques (en carton-pâte)
J'aurais bien aimé, lors des quelques séjours que j'ai faits à Paris chez mes cousins Florent faire un peu de musique avec Madeleine, qui avait été une excellente pianiste. J'avais même une fois pris ma flûte avec moi. Malheureusement, elle avait cessé de jouer car, sa vue baissant, elle ne pouvait plus lire les partitions.

A Gros Theil en 1929-Marthe, Pierre et Madeleine Florent (au
centre), mes grands parents Simon et maman
Madeleine m'a raconté qu'étant un peu plus jeune elle faisait partie d'une petit ensemble de chambre d'assez bon niveau dont le jeune violoncelliste est plus connu comme humoriste que comme musicien: il s'agit de Maurice Baquet. Les répétitions ne devaient pas être tristes!
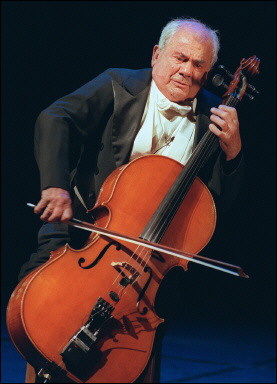
Retour à la table des matières
... quand tu nous tiens!
Lors de mon bizutage à l'École de d'architecture de Rennes
(eh oui, on bizutait encore au Beaux Arts à l'époque et
avec avec une certaine férocité) le "chef cochon"
(étudiant de 3 ou 4ème année, n'ayant pas encore acquis la
dignité d'ancien - dont l'obtention par cooptation à
l'unanimité nécessitait de longues années - et qui était
responsable des festivités) me laissa une petit moment
pour préparer un exposé sur le thème "Amour et
Électricité".
Sorti de mes réflexions,
me voici quelques instant plus tard, devant un aréopage
d'anciens goguenards prêts à m'entendre. Ils n'allaient
pas tarder à changer de mine. Nu comme un ver et
peinturluré comme un iroquois sur le sentier de la guerre
(résultats des prémices du bizutage) je me vois encore
débutant ainsi, face à mes anciens médusés:
"Nobles et vénérables anciens, fils du soleil et de la
lune (c'était l'injonction rituelle que tout un premier
trimestre de vexations diverses m'avait solidement
inculquée), lorsque vous m'avez proposés, dans votre
infinie sagesse de discourir sur les rapports entre
l'amour et l'électricité, je vous avoue que j'ai eu un
bref moment de doute. Certes, ayant un père qui a fait
carrière dans les sciences électrique, j'ai le privilège
d'avoir quelques connaissances dans le domaine de
l'électricité. Mais que dois-je entendre sous le vocable
amour? Considérant les évidentes implications avec
l'électricité de termes tels que courant, barrages,
retenues, flux etc... j'ai rapidement été amené à écarter
toute autre acception du terme et vais donc vous
entretenir de la production d'électricité sur le fleuve
Amour qui, vous ne l'ignorez certainement pas, fait
frontière entre l'URSS et la Chine." Et ainsi de suite...
Passé les premiers
instants de stupeur, mes anciens apprécièrent la
plaisanterie; ce qui me valu d'être exempté de la suite du
bizutage. Mais il me fallu encore près de six années pour
accéder à la dignité d'ancien, car je ne comptais pas que
des partisans dans leurs rangs.

la célébration du "Rougevin" en 1958, la fanfare de l'école
(moi aux cymbales)
Retour à la table des matières
Saut du pontUn soir de "piste" avec des copains, mon frère Alain rentrait à Vannes en passant par le Bono. Il y a là un ancien pont suspendu qui franchit la rivière d'Auray, que le conducteur de la 2 CV pris sans doute un peu vite, ce qui lui fit perdre le contrôle du véhicule. La malheureuse deudeuche franchit le parapet et fit un plongeon pour se retrouver, quelques mètres plus bas, dans la rivière. La mer, heureusement, était basse et c'est dans la vase molle que la voiture et ses occupant atterrirent. Sous le choc, Alain et ses copains furent éjectés à travers la capote (la ceinture de sécurité n'existait pas encore à cette époque) et ils se retrouvèrent, crottés et boueux, mais intacts dans la vase fraîche. On peut dire qu'ils ont eu une sacrée chance ce soir là!
La tante Nini
J'étais alors étudiant à
Rennes et venais de passer un dimanche à Malestroit pour
rendre visite à la famille. Plutôt que de rentrer prendre
le train à Vannes, papa me conduisit à Guer où un autocar
desservait Rennes directement. Tout alla bien jusqu'à ce
que le car tombe en panne en pleine campagne. Le temps que
le chauffeur trouve un téléphone (il n'y avait pas de
portables à cette époque) et que la compagnie nous envoie
un car de rechange depuis Rennes, deux bonnes heures se
sont écoulées, que chacun a occupé au mieux, l'un allant
aux champignons, l'autre en piquant un petit somme et moi
en faisant connaissance d'une jeune fille, à peu près de
mon âge, qui partageait le même siège que moi. On parlait
de choses et d'autres lorsqu'elle prononça une phrase qui
fut un déclic dans mon esprit: "comme me disait la tante Nini...".
Tiens donc, mais moi aussi j'avais une tante Nini. On
s'expliqua et voilà comment nous nous sommes découverts
cousins. Lorsque j'ai raconté cette rencontre à mes
parents ils m'ont dit: "ah
oui, ça doit être la petite Deron, une cousine un peu
éloignée, du côté de grand-mère. On s'est un peu perdu
de vue". Nous avons donc renoué et nous voyons
encore de temps en temps. Le Monde est petit.

tante
Nini en 1940
Retour
à la table des matières
Mes parents
m'avaient dit un jour que nous avions des cousins, que je
ne connaissais pas, mais qui habitaient Rennes. Ils
m'avaient encouragé à leur rendre visite. Je leur passe
donc un coup de fil et suis invité à dîner. Le jour dit,
m'étant mis sur mon trente-et-un pour faire bonne
impression, je passe chez un fleuriste et craque pour une
belle gerbe de glaieuls, beaucoup trop grande pour ce
genre de choses, mais comme disent les marins du Morbihan
"trop fort n'a jamais manqué". J'arrive donc chez ces
cousins, avec ma très encombrante gerbe, pour laquelle on
ne trouve aucun vase assez grand et qui finit exposée sur
un buffet, comme sur une tombe. Ils avaient également bien
fait les choses et je crois que, le vin aidant, je me suis
laissé allé à proférer quelques anneries et confidences un
peu déplacées qui ont fait que je n'ai jamais plus été
invité chez eux. Mais leur fille m'a toutefois confié,
bien longtemps après ce repas, que la gigantesque gerbe de
glaïeuls avait tellement frappé ses parents que des
dizaines d'année plus tard ils en parlaient encore avec
amusement.
Pour le bal costumé des Beaux-Arts, j'avais choisi cette année là d'être un créole: en blanc des pieds à la tête, chemise largement ouverte, coiffé d'un large chapeau de paille et un petit foulard écossais autour du cou, j'estimais être dans crédible. Mais il manquait quelque chose: un beau bronzage, ne serait-ce que pour bien trancher avec les habits blancs. Nous étions en février. Qu'à cela ne tienne: un petit tour chez le pharmacien et pendant la semaine précédant le bal je me suis consciencieusement appliqué une lotion auto-bronzante, qui a vite fait son effet et m'a doté d'une belle couleur, quoique une peu orangée. J'ai eu mon petit succès, je crois mais passé le bal il a bien fallu attendre que je dé-bronze. Ça a pris pas mal de temps. Or je travaillais sur un projet qui ne m'inspirait guère et lors de la visite hebdomadaire du chef d'atelier, cela ne lui a pas échappé. J'ai donc eu droit à un très sec "si au lieu d'aller aux sports d'hiver vous aviez travaillé un peu plus, votre projet ne serait pas aussi désolant". Je n'ai rien dit et préféré ne pas affronter le jury avec ce projet lamentable. Mais en moi-même je me suis trouvé ravi de constater que mon bronzage ait pu paraître aussi naturel. J'aurais probablement été moins ravi si j'avais su - mais je l'ignorais alors - que pour un vrai créole, bronzer est considéré comme étant de la dernière indécence.
Je n'ai pas de
photos mais j'en ai retrouvé une, de 1959, pour un autre bal
des Beaux-Arts. N'étions nous pas mignons?

Cette année là c'est l'École d'architecture qui était organisatrice et nous avions fait une telle recette que nous avons décidé de l'utiliser pour une virée de deux jours dans l'île de Jersey. Et pas n'importe quelle virée puisque, pour l'occasion, nous avions tout simplement loué un avion, pour nous seuls! Mais nous avions vu un peu grand et le fameux avion risquant fort de décoller à moitié vide, je me vois encore le matin du départ, draguant les filles dans les rues de Rennes pour leur proposer un voyage gratuit en avion, aller-retour, pour Jersey. C'était tellement gros à avaler (même si c'était parfaitement vrai) qu'aucune n'est tombée dans le piège.
Si le
voyage ne nous avait rien coûté, il avait par contre fallu
payer l'hôtel. Nous étions dans des chambres à deux et je
me souviens que le partage des frais avait été un vrai
casse tête. C'était poutant simple: à l'époque la livre
anglaise valait 20 shillings (il y avait aussi la guinée,
qui en valait 21, mais c'était réservé aux loyers et
objets de luxe). Le shilling valait 12 pence et le penny 4
farthings (pratiquement disparus, heureusement, à cette
époque mais que j'avais connus plus jeune). Les
britanniques, certainement des champions des fractions,
paraissaient s'accommoder fort bien du système. Mais quel
instituteur de nos jours serait assez sadique pour faire
faire à ses élèves des exercices dans cette monnaie?
Avec un
copain, dont le père avait un chantier naval dans les
environs de Vannes, mon frère s'était rendu à Amsterdam
pour une compétition de dériveurs. En émargeant la feuille
d'inscription, un nom leur saute aux yeux "Heineken".
Voilà qui est intéressant, donc. Probablement rien à voir
avec les bierres du même nom, mais qui sait? La
compétition achevée, lors de la distributions des
récompenses, les deux compères s'arrangent donc pour faire
la connaissance de ce fameux Heineken. Ils sympathisent
et, coup de chance, il était bien de la famille. De fil en
aiguille, mon frère s'étant très opportunément souvenu
qu'il était lui aussi d'une famille de distillateurs, les
voici invités à visiter la brasserie. Je ne vous raconte
pas la suite, d'ailleurs lui-même n'a plus les idées très
claires là dessus...
C'était à
l'occasion d'une régate dans la baie de Quiberon. Papa,
membre très actif de la Société des Régates du Morbihan et
son président, que tout le monde appelait "Amiral" étaient
du jury. Au moment de donner le coup d'envoi, voilà
qu'arrive un énorme yacht anglais, en travers de la ligne
de départ. L'amiral prend son porte voix et en termes
choisis, mais néanmoins vigoureux, ordonne à l'intrus de
déguerpir au plus vite, ajoutant que s'il n'avait rien de
mieux à faire, il n'y avait justement personne pour
contrôler le passage de la bouée la plus éloignée du
parcours. Immédiatement l'anglais vire, fait demi tour et
se dirige droit vers la fameuse bouée, qu'il n'a pas
quittée de toute la régate. Mais en virant il dévoile
aussi son pavillon: blanc frappé de l'Union Jack.
Autrement dit le pavillon réservé à la famille royale et
quelques happy few de la gentry. Catastrophe! Régate
achevée et tout le monde au port, papa dit à l'amiral "maintenant tu sais ce qu'il
te restes à faire: aller t'excuser". L'amiral se
met sur son trente-et-un, blazzer impeccable et casquette
blanche, et prend son annexe pour se rendre à bord de
l'anglais, que sa grande taille empêchait de mouiller à
quai. Tard dans la nuit il a été très dignement reconduit
par deux marins anglais, qui l'on déposé dans sa
couchette. Il n'a jamais voulu dire ce qui s'était passé,
ni qui il avait vu. De toutes façons, il était patent que
ses excuses avaient été acceptées.
Dans le
même genre et avec les mêmes acteurs, nous étions au
mouillage dans le port de Palais, à Belle-Ile-en-mer, à
couple avec un bateau que nous pensions italien. Et
manifestement ces gens avait un problème avec leur moteur
et commençaient à s'énerver. L'amiral était un bon
mécanicien. "Va donc
voir ce qui leur arrive" dit papa, "ils ont besoin d'un
spécialiste". Sitôt dit, sitôt fait et quelques
minutes plus tard on pouvait entendre le fameux moteur
tourner rond. Mais l'amiral ne revenait pas. Il est tout
de même rentré tard dans la soirée et nous a dit:
- Ce ne sont pas des
italiens, mais des irlandais (rien n'est plus facile que de confondre les
deux drapeaux, surtout un peu délavés par les embrunts
et au crépuscule)
- C'est le
plus gros fabricant de whiskey du pays.
- Et ce n'est pas un
bateau, c'est une cave flottante!
Étonnez-vous qu'il se soit un peu attardé.
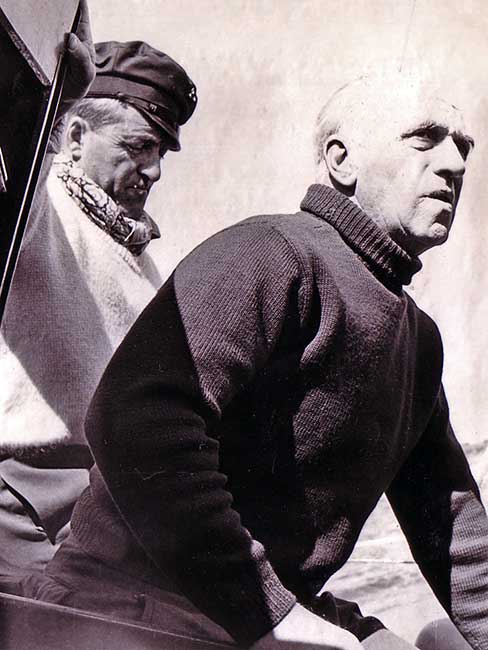
papa
et l'amiral en 1960
Retour
à la table des matières
J'ai donc accompli mon service militaire à Angers, et mes classes dans la même caserne que papa. Mais je pense que depuis son passage, le caserne s'était passablement dégradée.

nos sanitaires
J'ai conservé de cette période
de ma vie un sentiment assez mitigé. Dans un sens, très
immature lorsque je suis parti, ça a été une pause dans ma
vie, pendant laquelle j'ai eu tout le temps de sortir la
tête de ma coquille et réfléchir un peu sur moi-même et sur
les autres. Une occasion aussi de côtoyer des gens, pas
nécessairement négligeables, venant de tous les horizons. Ce
grand brassage du service militaire était certainement son
plus grand intérêt et ce qui pourrait le faire un peu
regretter. Bien peu à vrai dire, mais tout de même...
J'ai le souvenir d'avoir bu, pendant mes classes, dans un
quart en aluminium, des vins d'Anjou comme je n'en ai jamais
trouvés depuis, que nous amenait un camarade camarade fils
de viticulteur, qui devait vider en cachette la cave de son
père. Près de 50 ans plus tard il me suffit d'évoquer ce
souvenir pour sentir à nouveau l'odeur de ce Bonnezeaux: un
vrai nectar. Et les fondues du fils de l'agriculteur du
Jura, avec kirch maison et vin d'Arbois n'étaient pas mal
non plus.

la chambrée: moi, le dernier droite
L'éléphant du
professeur Coppens
J'ai connu pendant mon service un garçon qui a
bien fait son chemin depuis. Il s'agit d'Yves Coppens.
Nous étions vannetais tous les deux et au Lycée de Vannes
j'avais eu son père comme professeur, mais ne le
connaissais pas vraiment jusque là. J'ai le souvenir d'un
conteur extraordinaire, avec un humour décapant. Lorsqu'il
ouvrait la bouche chacun retenait son souffle. Il nous
racontait par exemple qu'il avait envisagé dans un premier
temps, de se consacrer à l'étude des dinosaures. Son
maître de thèse lui avait dit que pour vraiment comprendre
ces gros animaux, il était absolument indispensable de
déjà bien les connaître. Va au zoo, lui avait-il dit,
observe les éléphants et si l'un d'entre-eux vient à
mourir, je ferai en sorte qu'on te le réserve, pour que tu
puisses le disséquer.
Un matin, c'était la
veille de Pâques et Yves était en vacances. Le facteur
arrive, hilare, avec un télégramme dont les termes étaient
"éléphant mort, prière venir immédiatement". Le jour même
Yves Coppens était dans une salle du jardin de plantes,
devant une éléphante morte, quatre grands bacs de formol
et un pont roulant. Il nous a raconté qu'il avait passé le
week-end pascal, scie en mains, à découper l'animal en
gros morceau qu'il déposait ensuite, grâce au pont
roulant, dans le formol. Ensuite il a fallu passer aux
choses sérieuses.
Au début, nous a t-il
dit, j'avais beaucoup de visite. Puis on est encore venu
me voir, mais depuis le pas de la porte. Et quand je suis
vraiment rentré dans les détails l'odeur était si forte,
malgré le formol, qu'à chaque fois que je prenais
l'autobus, tout le monde refluait sur la plate-forme...
Tout cela pour finir par découvrir la minuscule Lucy.

période militaire à Pau, en 1965
J'ai tout de même achevé ma carrière militaire comme officier interprète de réserve et, après avoir accompli quelques périodes militaires assez réjouissantes, tous comptes faits, et avoir fait passer pendant des années des examens d'espagnol à Saint-Cyr Coëtquidan (j'étais alors le seul officier interprète en espagnol de la IIIème Région Militaire!) j'ai été admis à la retraite avec le grade de commandant, malgré quelques faux pas comme celui d'avoir recalé à l'écrit d'un examen un agrégé en espagnol, certainement brillant dans cette langue mais nullissime en vocabulaire militaire (qui était le sujet de l'examen). Je dois dire que j'étais handicapé par le mode de notation dégressif qui m'était imposé, permettant d'enlever des points, mais pas d'en ajouter. Il a été repêché et je lui ai donné une très bonne note à l'oral. Mais ça avait fait du bruit.

À l'École Militaire en
1971 - saurez-vous me trouver?
Retour à la table des matières
Coffrages soignés
Je me souviens d'un jeune
corse, qui avait été incorporé à peu près à la même époque
de moi, et qui sur le questionnaire que l'on avait à
remplir en arrivant à l'armée avait mentionné, en face de
"profession?" qu'il était coffreur. Ou bien il écrivait
comme un cochon, ou bien sa fiche avait t-elle été lue un
peu rapidement, toujours est-il qu'il s'est retrouvé
coiffeur. Il s'est bien gardé de se plaindre. Ses
camarades lui ont enseigné le métier et comme il était
doué et appliqué, après avoir massacré quelques tignasses
il est devenu le meilleur coiffeur du régiment; très
apprécié par les officiers et se faisant de beaux
pourboires. Je suppose qu'un fois libéré il n'est jamais
retourné à ses coffrages. Moralité: ne prenez pas la peine
d'écrire correctement.
Et à propos de coiffeur,
lorsque j'ai été appelé pour faire mon service je portais
un petit collier de barbe dont je pensais, assez
naïvement, qu'il me vieillissait un peu et me donnait de
l'assurance. On m'avait déconseillé de le garder car cela
n'était pas bien vu. Je ne tenais pas particulièrement à
cet ornement mais je voulais tenter le coup.

À peine arrivé à la caserne on
me met de côté et on m'envoie, avec deux autres barbus, voir
le colonel qui pointe un doigt vers moi.
- Oui mon colonel.
Profond soupir.
- Bien mon colonel.
Et en route pour le salon du
barbier.
Sans doute peu d'entre
vous de nos jours savent à quoi peut servir ce récipient
sans fond; tout comme je l'ignorais lorsque je l'ai acheté
dans une brocante. Il a fallu que mes parents me rendent
un jour visite pour qu'ils s'exclament d'une seule voix
"oh, un gobe-mouches! Voilà bien longtemps qu'on n'en
avait pas vus".
Car autrefois, il y en
avait dans toutes les maisons. Mode d'emploi: on verse un
peu de vinaigre dans l'anneau qui se trouve à la base du
récipient, autour du trou et on pose le tout sur un
morceau de sucre. Les mouches, attirées par le sucre,
finissent par monter par le trou et sont étourdies par les
vapeurs du vinaigre, dans lequel elles finissent pas se
noyer.
D'où l'expression bien
connue: on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre (il
faut surtout le morceau de sucre).
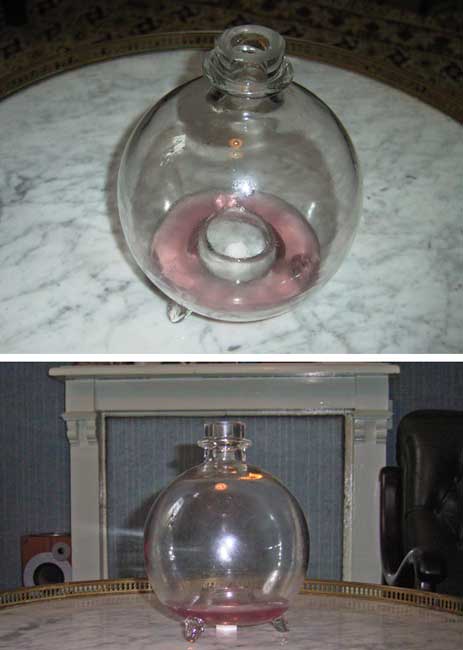
Le gobe-mouches (manque son bouchon)
Retour à la table des matières
Question de valeurs
L'été 1958, au grand
désespoir de mes parents, je me suis laissé tenter par un
stage en Algérie, organisé par le gouvernement français
qui cherchait encore à susciter des vocations parmi les
étudiants, l'Algérie manquant cruellement de cadres. Tout
s'est bien passé, j'ai vu du pays, je me suis ouvert à pas
mal de choses et suis revenu vivant.
J'avais sympathisé avec
un futur ingénieur des Ponts, stagiaire comme moi et
excellent pianiste. Nous avons fait ensemble une virée à
Alger (j'étais basé à Orléansville, actuellement El
Asnam).
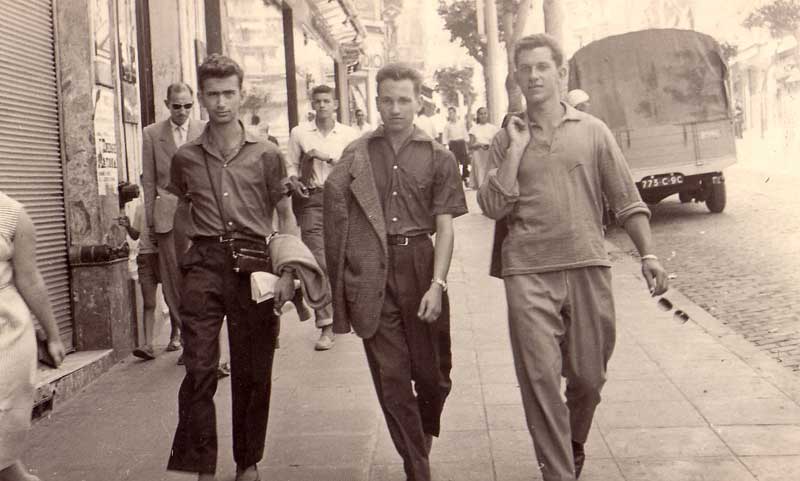
Dans les rue d'Alger, entre deux autre stagiaires
Je savais que des amis de mes
parents, les L. s'y étaient installés et me dis que ce
serait une bonne occasion de leur rendre visite. Mais je ne
connaissais pas leur adresse. Une rapide recherche dans
l'annuaire me permit de constater qu'il n'y avait à Alger
qu'une seule personne portant ce nom. Nous nous rendîmes
donc à l'adresse indiquée.
On sonne et une femme européenne, opulente et qui avait
certainement l'âge d'être notre mère, vient nous ouvrir,
couverte (si l'on peut dire) d'une légère combinaison qui ne
laissait rien ignorer de son anatomie. Je demande madame L.
et elle me répond "c'est
moi-même". Il y avait manifestement erreur sur la
personne. Je m'explique et la prie de nous excuser. Ce n'est
pas grave dit la dame, mais puisque vous êtes là, puis-je
vous offrir le café? Il était parfaitement visible que cette
personne avait manifestement bien plus que son café à offrir
à deux jeunes étudiants providentiellement arrivés chez elle
par cette chaude matinée d'août. Mais la différence d'âge,
un reste de fierté et le fait que mon camarade était fiancé
et sur le point de se marier nous a retenu. Café prestement
avalé nous nous sommes esquivés comme des voleurs, en dépit
des protestations de notre hôtesse.
Quelques mois plus tard et mon ami s'étant marié, il m'a
invité à venir le voir à Versailles où il habitait avec sa
jeune épouse un magnifique appartement du 18ème siècle dont
les hautes fenêtres donnaient sur le parc du château. "Excuse-nous de te recevoir
ainsi", me dirent-ils, "mais tout ce que nous avions épargné est parti
dans l'achat de cet appartement, que nous n'avons pu
meubler, sinon de l'essentiel." En l'occurrence,
j'ai pu constater que l'essentiel consistait en un matelas
et sa literie, à même le sol (un splendide parquet "à la
française" tout de même) et un somptueux tapis persan avec,
posé dessus, un grand piano à queue de concert.
Voilà un sens des valeurs admirable et que j'avoue partager
pleinement.
Le cromain
Dans les années 60 le
Ministère de la Culture avait eu l'idée de procéder à un
inventaire complet de toutes les richesses
architecturales, mobilières et artistiques de France, sur
le modèle de celui qui existait déjà en Alsace et en
Moselle depuis le temps où ces provinces étaient
allemandes. Il fut décidé que le coup d'envoi serait donné
en Bretagne et, plus précisément, qu'il concernerait le
canton de Carhaix.
Vivement encouragé par
mon professeur d'Histoire de l'Art, André Mussat, je me
proposai de participer à la première campagne
d'inventaire, au cours de l'été, pour faire le relevé et
dresser les plans des bâtiments inventoriés, avec un
collègue.
Nous débarquons donc à
Carhaix, munis de toutes les autorisations, civiles et et
religieuses et sommes reçus au Syndicat d'Initiative. On
parle un peu de la ville et de ses richesses puis,
d'emblée, quelqu'un nous interroge, avec un très fort
accent breton écrasant lourdement les avant-dernières
syllabes des mots "avez-vous
EU le temps de viSIter un peu? et avez vous VU l'aQUEduC
ROmain?". Incompréhension totale. La queue du
quoi? Que pouvait bien être ce cromain dont la queue avait
autant d'intérêt.
On s'expliqua mais toute
la campagne de Carhaix resta marquée par ce fameux
"cromain", animal mythique que l'on imaginait, tel le
marsupilami, affublé d'une queue interminable et que l'on
cherchait partout et vainement, tel le dahut à pattes
dissymétriques.
C'est un bon souvenir
que je conserve de cet été et d'un travail émaillé par de
nombreuses anecdotes, comme celle par exemple de cette
documentaliste, de bonne famille, qui ayant à décrire une
sculpture sur une sablière en bois, nota qu'il s'agissait
d'un chien rongeant un os alors que, lorsque nous en avons
vu les photos, il s'agissait manifestement d'une scène de
fellation (nos ancêtres avaient un goût prononcé pour la
gaudriole, même dans les édifices religieux). Éclat de
rire général: la malheureuse n'a pas fini d'entendre
parler du fameux chien.

Tiens, c'est comme à Saint-Brieuc. La vessie de ne sais quel évêque, déjà bien âgé, avait du mal à se contenir pendant toute la durée des cérémonies. Aussi Monseigneur se fit il édifier, entre deux contreforts de la cathédrale un petit édicule où il pouvait rapidement se soulager en cas de besoin pressant. Ces toilettes existent toujours. Le tailleur de pierre facétieux les a surmontées d'un petit personnage accroupi dont l'activité évidente signale l'usage de l'endroit. Le "saint-chiot" de Saint-Brieuc, déjà signalé par Alfred Jarry, fait le bonheur des marchands de cartes postales.

Autre souvenir amusant: comme je viens de le dire, je dressais des plans de chapelles et manoirs et, les instruments modernes de métré à infra-rouge n'existant encore, nous devions faire avec les moyens du bord. Ce n'était pas toujours facile, en particulier pour les mesures des hauteurs. Heureusement que nous avions vite repéré que chaque église ou chapelle était nécessairement équipée d'un éteignoir emmanché sur une longue perche, généralement planqué derrière la porte de la sacristie et que nous avons abondamment utilisé. Mais cela ne suffisait pas toujours. Ils nous est alors venu, avec mon collègue, une idée lumineuse. Pourquoi ne pas nous servir d'un ballon de baudruche gonflé au gaz? Il n'y aurait plus qu'à mesurer la longueur de sa ficelle. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le soir même nous avions fait l'emplette de quelques ballons et d'une bouteille de gaz pour le camping. Le lendemain, tout excités, on gonfle un ballon, on le lâche... et il retombe piteusement à terre. Voilà comment j'ai appris, à mes dépends, que le gaz butane est plus lourd que l'air.

avec Denise, par la face nord
La campagne de Carhaix étant la première de ce genre, nous avons évidemment reçu pas mal de visites, dont celle d'une délégation du Ministère de la Culture menée par le propre directeur de cabinet du ministre. Tout ce beau monde s'est montré enthousiasmé par notre travail et les gros efforts que nous avions accomplis pour tenter en particulier d'établir des normes de description et de dessin applicables par la suite à tout l'Inventaire, au point qu'à l'issue du repas qui suivit, le directeur nous félicita et nous promit à tous de nous faire attribuer la médaille des Arts et des Lettres. J'attends toujours....

J'ai fait enduite plusieurs autres campagnes d'inventaire: Gourin, Mael-Carhaix, Pontivy (où je n'ai jamais mangé autant de pommes de terre de ma vie: à tous les repas; à tel point que nous avions fabriqué une statue représentant "Intron Varia avalou dour" - ND des patates en breton), puis en périodes scolaires Caulnes, le vieux Rennes et des recherches aux archives de Rennes ce qui m'a valu l'insigne honneur d'avoir en mains les plans originaux de l'architecte Gabriel (place du Parlement de Bretagne et mairie), ainsi que ceux du musée et de l'ancienne fac des sciences, par Martenot.
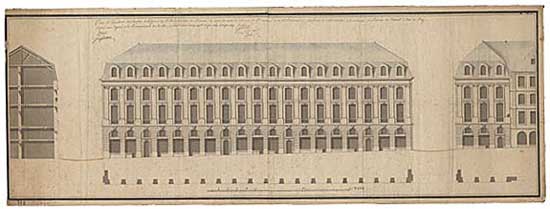
J'ai découvert,
en examinant ces plans, magnifiquement tracés à la plume
d'oie sur un carton assez épais, la réponse à une question
que je me suis longtemps posée. Comment s'y prenait-on,
avant l'invention du calque, pour reproduire et reporter
d'un plan à l'autre des cotes précises? Il suffit de
soulever ces plans et de les regarder face à la lumière pour
obtenir une réponse évidente: chaque angle du dessin
apparaît percé d'un minuscule trou d'aiguille: vieux procédé
des couturières pour reproduire leurs patrons.
J'ai aussi pu consulter le dossier entier du chantier de
transformation du couvent des Carmes, qui avait été acquis
au 18ème siècle par l'archevêque, qui souhaitait s'y
installer. C'est assez émouvant de constater que le travail
d'un architecte, il y a quelques trois siècles, était
pratiquement le même que celui des architectes actuels. Ce
dossier est d'une étonnante actualité. On y retrouve les
mêmes croquis, plans, détails, devis quantitatifs et
estimatifs, permis de construire (savez-vous que cette
formalité a été instituée par Henri IV, sur les conseils de
Sully?), dossier d'appel d'offres, marchés, comptes-rendus
de chantier, mémoires d'entreprises vérifiés et annotés en
rouge par l'architecte, procès-verbal de réception des
travaux (et savez-vous aussi que la garantie décennale
remonte aux anciens grecs puis reprise dans le droit
romain?). Rien qui ne soit familier à un architecte
contemporain. Si ma cousine Claire Étienne, qui dirigea
longtemps les services de l'Inventaire à Cæn, me lit, cela
doit lui rappeler bien des souvenirs.
Le mont Athos
Mon travail à
l'Inventaire m'ayant permis de me constituer un petit
pécule, j'avais décidé de l'investir illico dans un voyage
en Grèce, en septembre. À vrai dire, cette idée me
travaillait depuis un certain temps, au point que j'avais
passé toute une année à bûcher la méthode Assimil de grec
moderne et me sentais fin prêt pour l'expédition.
Bon je ne roulais tout
de même pas sur l'or, alors j'ai choisi d'y aller en
train. Départ de Paris en matinée, traversée de la Suisse,
puis du nord de l'Italie et nous étions à Trieste à la
nuit. La Slovénie puis la Croatie dans le noir et nous
étions vers midi à Belgrade. Quelle expédition! On parlait
huit langues différente dans le même compartiment. Plus le
train descendait vers le sud et plus la pauvreté du pays
devenait visible. Aux petits chalets coquets de Slovénie
(on se croirait en Suisse) et aux routes encore correctes
de Croatie, succédaient des chemins de terre défoncés,
avec des mules, des charrettes... Dépaysement des
premières inscriptions en alphabet cyrillique. À Belgrade
une partie du train, vestige du fameux Orient Express,
partait vers la Bulgarie et la Turquie. Je commençais à
avoir faim; à vrai dire je n'avais rien prévu pour un si
long voyage. On me fit comprendre qu'il y avait un wagon
restaurant. Encore fallait-il y arriver, en enjambant les
paquets qui obstruaient un couloir, de plus en plus
encombré à mesure que le voyage se poursuivait. Et
soudain, je pousse une porte et c'est un autre monde, de
luxe et de calme. Un wagon restaurant comme on n'en voit
que dans les vieux films, aux sièges de velours, aux
nappes damassées, aux couverts en argent, avec des murs
recouverts de délicates marqueteries de bois précieux. Le
service était assuré par un personnel pléthorique et
stylé, dans des tenues d'un autre âge et la nourriture...
allez ne boudons pas plaisir, peut être pas aussi raffinée
que le décor, mais copieuse et variée. Et tout ce luxe m'a
coûté moins cher qu'un mauvais sandwich dans un train
français. Voilà qui fait réfléchir un gamin d'une
vingtaine d'année qui n'est guère sorti de chez lui.
La nuit est tombé sur le
Kosovo et mes premiers minarets. Je crois bien que, mort
de fatigue, je n'ai pas vu grand chose de la Macédoine.Au
matin suivant nous étions à Salonique. J'avais prévu de
rejoindre Athènes d'une seule traite mais le courage m'a
manqué et j'ai quitté le train. En fait, c'était une
excellent idée car Salonique vaut le déplacement, avec ses
très vieilles églises (certaines étaient déjà des
antiquités lorsque Charlemagne régnait sur l'Europe), ses
quartiers turcs aux rues étroite et aux vénérables
mosquées, impitoyablement transformées, laquelle en
cinéma, l'autre en entrepôt et un front de mer, ma fois,
fort sympathique et vivant.

cette grande basilique remonterait au 5ème siècle
De Salonique, le mont Athos
n'est pas bien loin et je me suis dit que cela devait valoir
le détour. Et comment! Mais le mont Athos n'était pas d'un
accès facile (je ne sais ce qu'il en est aujourd'hui).
Petite république autonome au sein de l'état grec, elle
filtre et contingente soigneusement ses visiteurs. Je ne
parle pas des femmes car jamais personne de sexe féminin, ni
même les chiennes ou chattes, n'a été admise à fouler le sol
du mont. Il fallait donc un visa spécial, délivré par
l'archevêché de Salonique à l'issue de longues démarches et
de justifications tatillonnes, pour avoir le droit de
pénétrer dans cet endroit. Mon statut d'étudiant en
architecture a semblé satisfaisant aux fonctionnaires de
l'archevêché.
Muni du précieux document, je me suis retrouvé, après
quelques heures de car, dans un petit port au pied de la
presqu'île qui constitue le territoire du mont Athos et
après une nuit dans une auberge au confort spartiate, j'ai
pu prendre au petit matin, dans une aurore délicatement
rose, le caïque menant au mont. Car ce territoire ne
comporte aucune route carrossable reliée au reste de la
Grèce.

Tout de suite c'est
l'enchantement d'une nature très belle, très verte et
totalement vierge. Je pense que c'est exceptionnel en Europe
où, depuis des siècles, la main de l'homme a tout modifié.
Nous longeons quelques petits monastères avec des églises à
coupoles, parfaitement calmes; on ne voit âme qui vive. Puis
débarquement dans un port minuscule où deux moines barbus se
chargent des opérations de douane. À l'aller c'est rapide,
au retour ça l'est moins car les moines, à juste titre,
craignent les vols dans cet inestimable musée qu'est le mont
Athos.
Un minibus brinquebalant conduit ensuite notre petit groupe
(une demi douzaine d'étudiants allemands, quelques pèlerins
et moi) à la "capitale" du mont, par l'unique route à peu
près carrossable du pays, pour une seconde vérification des
visas et passeports et nous voilà laissés à nous même. Carte
en main, les allemands et moi nous nous engageons à pied
dans un sentier de montagne en direction du plus proche
monastère. Nature vierge dominée par la masse imposante du
mont Athos; pas vraiment une montagne, mais pas loin.
Cahutes de pécheurs. Petits ponts de pierre en dos d'âne.

Nous arrivons au monastère en début d'après midi. On sonne à la porte et un moine nous ouvre. Sans un mot il nous conduit à dans une pièce meublée de quelques lits de camp et nous abandonne à notre sort. Nous visitons, sans croiser personne. Une grande cour bordée de bâtiments austères, des loggias, des colonnades et au centre, une belle église à coupole couverte de feuilles de plomb, manifestement très ancienne avec, sur le côté, une délicate fontaine avec des colonnes supportant le même type de coupole que l'église.Tout cela est très simple, dépouillé et d'une réelle beauté.

Le même moine sort dans la
cour et nous fait signe de le suivre dans un petit
réfectoire où il nous sert en silence un plat de légumes
accompagné d'une miche de pain et d'un grand pichet d'eau
fraîche: frugal mais assez copieux et nous étions morts de
faim. Puis le moine revient et nous conduit à l'église.
L'office du soir est commencé. Il fait très sombre. Nous
devinons à la lueur ambrée des cierges de cires, à l'odeur
si agréable, que la totalité des murs et des voûtes est
recouverte de fresques qui semblent être d'une grande
beauté. Nous y reviendrons le lendemain matin: c'est
effectivement très beau. L'office est interminable. Les
moines psalmodient longuement des chants qui me paraissent
très orientaux, accompagnés de longues notes tenues à la
basse. On ne voit rien d'autre. Tout semble se passer
derrière cette clôture dorée, richement sculptée et ornée
d'icônes. De temps à autre, le célébrant s'encadre dans la
porte de l'iconostase dont il soulève le rideau pour brandir
un livre ou un objet de culte, avant de se retirer. Une
vingtaine de fidèle occupent la nef, debout comme nous car
il n'y a pas de sièges. Ils répondent aux psalmodies des
moines, se signent presque constamment, de droite à gauche
comme le font les orthodoxes, et défilent devant les icônes
pour les baiser respectueusement. L'odeur de l'encens nous
étourdit un peu. Nous ne savons que faire et tombons de
fatigue. Sans même avoir besoin de nous consulter, les
allemands et moi retournons dans notre dortoir.
Nous avons bien fait car les moines se lèvent tôt et il nous
faut se mettre rapidement en chemin si nous voulons arriver
au monastère de la Grande Lavra avant la fermeture des
portes. Un rapide coup d'œil à l'église et nous voici à
nouveau sur le sentier, non sans avoir déposé une petite
obole dans le tronc qui se trouve, très visible, à l'entrée
du monastère. Mais nous avons présumé de nos forces,
d'autant plus que accablés par la chaleur nous avons perdus
un peu de temps à nous baigner dans une petite crique à
l'eau incroyablement transparente.

Le soleil baissant nous
finissons par nous arrêter dans une hameau de pêcheurs: deux
ou trois maison, pas plus. Je conserverai longtemps le
souvenir de l'accueil de ces gens, qui se sont faits une
réelle joie de nous recevoir, malgré l'écueil de la langue.
Nous avons partagé avec eux un repas de poisson, bien arrosé
par un vin blanc raisiné qui n'avait rien à voir avec ces
bibines commerciales que l'on trouve en France sous ce nom.
La soirée n'a pas été triste, même si nous devions nous
comprendre plus par le geste que par la parole. Les pêcheurs
parlaient, je pense, un dialecte local qui dépassait de loin
mes rudiments de grec, mais le cœur y était. Et quand est
venue l'heure de dormir, ces braves gens sont allés se
coucher par terre, dehors, nous laissant leurs propres lits.
Quelle belle démonstration d'hospitalité. Le lendemain,
lorsqu'est venue l'heure de se mettre en route, ils ont
énergiquement refusé quelques drachmes que nous voulions
leur donner, presque scandalisés d'une telle proposition
mais ont avec joie accepté de se faire prendre en photo par
un des allemands. J'espère qu'il leur a envoyé la photo, car
ils avaient donné leur adresse, hors du mont.
Le chemin vers la Grande Lavra n'a pas été trop long et nous
y étions avant midi. Imaginez une sorte de forteresse ocre
flanquée de tours carrées et percée de deux grosses portes
avec, à l'entrée, une délicate fontaine de marbre blanc,
entourée de lauriers roses; le tout se détachant, suivant
l'endroit où l'on se trouve, soit sur une mer bleu cobalt,
soit sur le vert délicat de la montagne.

Accueil en touts points semblables à celui du monastère précédent. Mais l'intérieur est plus riche, plus orné. Devant l'église, aux murs peints en rouge sombre, se détache un portique dont le fond est recouvert de fresques anciennes, d'une grande beauté.

Et face à ce portique, une magnifique fontaine à coupole, également recouverte de fresques. la vivacité des couleurs, étonnante pour des peintures de cet âge, et en plein air, offre un contraste surprenant avec la sobriété des murs rouges de l'église et ceux, de pierre ocre ou enduits de blanc, des autres bâtiments monastiques, en particulier ceux des cuisines, aux imposantes cheminées.
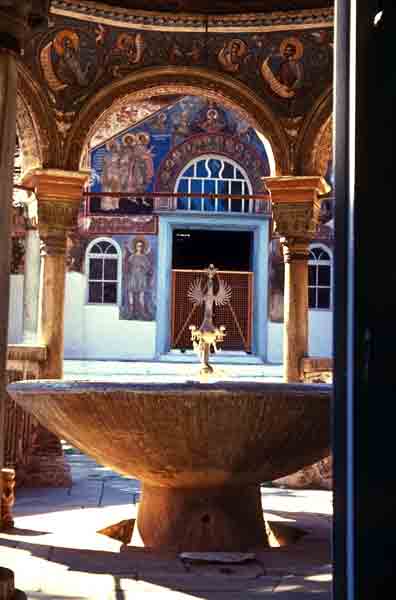
Un jeune moine vient nous chercher et nous conduit dans la bibliothèque pour nous montrer des manuscrits mais, sans doute ce n'est pas du goût de ses supérieurs car on vient rapidement nous faire sortir de la pièce sans que nous ayons rien pu voir et le jeune moine est, visiblement, réprimandé. Je prends quelques photos mais on me fait comprendre que ces fresques sont trop fragiles pour supporter les flashs. Je me limite donc à celles qui sont à l'extérieur. C'est l'heure de l'office du soir. Assez semblable à celui de l'avant-veille, mais cette fois ci l'église est pleine de monde: les pèlerins sont nombreux.

Distribution de pain bénit. On se met en file pour le recevoir. Je ne comprends pas de quoi il s'agit vraiment et suppose que c'est la communion. Je me tortille à droite et à gauche pour essayer de voir comment ça se passe: en vain. Arrive mon tour. Le pope me tend un dé de pain que j'essaye d'attraper en ouvrant grand la bouche. Le pope retire aussitôt le pain. Nouvelle tentative, nouveau refus. Je finis par comprendre ce que me dit la personne qui me suit: "me ta cheria" (avec les mains). J'attrape le bout de pain béni et vais le manger dans un coin, rouge de honte. Cette fois ci encore nous n'assisterons pas à la fin de l'office, mais profiterons des fresques, très anciennes, du réfectoire.

Lendemain plus calme. Nous commençons à être fatigués de
marcher dans la montagne et on nous indique qu'un bateau
sert de navette et fait le tour de la péninsule, une fois
par jour, avec des arrêts dans les principaux monastères.
Voilà qui est plus civilisé. Après un dernier regard au
monastère, nous descendons au port à l'heure dite et prenons
le bateau.

Belle promenade. Nous doublons la pointe de la presqu'île et remontons vers le nord. La côte est plus escarpée. Plusieurs ermitages sont accrochés aux flancs de la falaise, dans des endroits improbables, avec des échelles branlantes et des passerelles d'accès qui font froid dans le dos. Ces moines là, c'est certain, ne doivent guère être dérangés.

Nous débarquons au monastère de saints Pierre et Paul, occupé je crois par des moines russes. C'est un vaste ensemble de bâtiments, d'une grande simplicité, accrochés à flanc de coteau au dessus de la mer.

Le monastère est en fête car
on célèbre je ne sais quel saint. Apprenant que je suis
catholique et les autres protestants, un moine nous prend
presque à partie et commence une tentative de conversion.
Son supérieur le calme et nous propose d'assister à l'office
du soir, où nous devrions entendre des chants d'une grande
beauté. Mais l'office doit durer toute la nuit aussi nous
propose t-il ne nous réveiller au bon moment, pour que
puissions assister au moment le plus intéressant puis nous
recoucher ensuite. Ce qui fut fait. Le saint homme!
Nous reprenons le bateau au matin, jusqu'à un monastère qui
est sans doute le plus étonnant de ce périple. Imaginez un
bouquet de bâtiments blancs autour d'une cour si étroite
qu'on pourrait presque en toucher les murs opposés en
tendant les bras et débordant largement au dessus de la mer,
soutenus par des encorbellements de bois et de fer dans un
équilibre qui semble précaire mais qui dure certainement
depuis des siècles.

Un moine assez bavard nous prend en charge. Il se propose de nous faire accéder à la plus haute tour du monastère, d'où la vue est magnifique. Nous surplombons les lourdes coupoles de plomb de l'église, déployées comme les corolles de fleurs délicates et, tout en bas, une mer d'une transparence parfaite au point que les bateaux amarrés semblent voler au dessus de l'ombre que leur coque fait sur le fond.

Cette mer est bien tentante et notre hôte nous fait comprendre qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que nous en profitions pour une petite baignade. En sortant de l'eau, nous voyons venir à nous le moine, escorté de son supérieur qui, visiblement, désapprouve notre comportement de touristes. Nous regagnons notre cellule en baissant la tête mais agréablement rafraîchi. Arrive l'heure du dîner. Pour la première fois nous sommes autorisés à le prendre avec les moines, dans un réfectoire magnifiquement orné de fresques, recouvrant le moindre mur et dans une vaisselle en étain. Tout cela est si beau que nous en oublions de manger.

Nous avons quitté cet
accueillant monastère le lendemain pour rejoindre notre
point de départ et, après de longues opérations de douane,
retrouver le 20ème siècle. Quel choc! Cette visite du mont
Athos est un des plus beaux souvenirs de voyage de ma vie et
je ne sais pas s'il est encore possible d'y accéder ainsi,
en toute liberté. Mais si vous le pouvez et ne craignez pas
l'inconfort, n'hésitez pas.
Le reste de mon premier séjour en Grèce a été plus classique
mais m'a encore donné l'occasion de connaître cette
remarquable hospitalité, qui semblait si naturelle à ce
peuple. Qu'en est il resté avec la modernité et l'invasion
des touristes? Sans doute plus grand chose. C'était à
proximité d'Épidaure et j'attendais un bus qui devait me
ramener sur la côte de la mer Égée. Nous étions en début
d'après midi et il faisait un soleil et une chaleur
épouvantables. J'étais là, stoïque, essayant de m'abriter
tant bien que mal sous arbre squelettique quand je fus hélé
par des paysans qui faisaient la sieste à une cinquantaine
de mètres de là, à l'ombre de quelques oliviers. Ils
m'avaient vu attendre en plein soleil et me proposaient de
les rejoindre. Je fus accueilli comme l'enfant prodigue. On
m'offrit un café turc bien sucré, précédé des
traditionnelles friandises confites sans lesquelles, pour un
grec, il n'y a pas d'accueil digne de ce nom. Puis ils me
posèrent avec curiosité une foule de questions, se moquant
gentiment de la maladresse avec laquelle je maniais les deux
imparfaits du subjonctif que les grecs ont la curiosité
d'utiliser. Les grecs sont ainsi, qui vous posent d'emblée
des questions que nous considérons comme terriblement
personnelles mais qui leurs semblent tout à fait naturelles.
Lorsque le bus est arrivé j'ai quitté ces gens avec regret
et beaucoup de gratitude pour ce moment de pur bonheur
qu'ils m'avaient si naturellement accordé.

en permission à Chalon en 1915: la distillerie ne tournait plus guère mais on avait conservé un bon stock de liqueurs

en guise de cadeau, mon grand-père avait ramené de Salonique cette année là
des costumes grecs pour ses soeurs
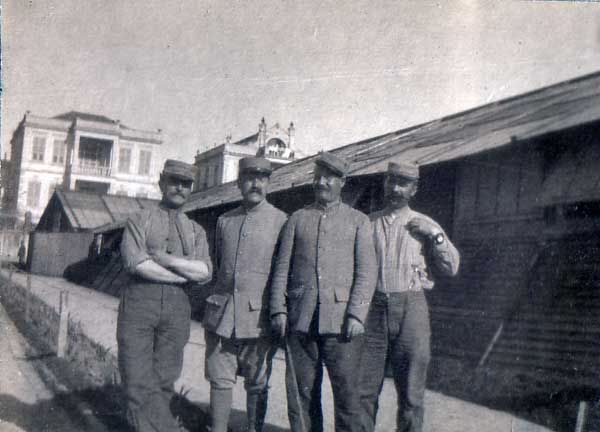
Grand-père Simon à Salonique en 1916; c'est le deuxième à
gauche
Tout n'a
d'ailleurs pas été aussi rose pour grand-père qui, en 1917,
se trouvait sur le front de l'Aisne. Un peu en arrière du
front, il en est revenu sans une égratignure.

c'est lui le premier, debout, à gauche
Mes débuts à l'opéra
J'avais conservé
l'adresse d'un des allemands qui avait visité avec moi le
mont Athos. Il était étudiant à Francfort sur le Main.
Aussi, mettant à profit un passage dans cette ville,
l'année suivante, j'ai décidé de lui rendre visite. Il se
montre ravis de ces retrouvailles mais, en même temps, un
peu gêné car, me dit-il, il n'est pas libre de s'occuper
de moi ce soir là, devant faire de la figuration à
l'opéra, ce qui lui assurait ses fins de mois. Mais
pourquoi ne viendrai-je pas avec lui? Installé dans le
local des figurants, en coulisses, je pourrai suivre le
spectacle, retransmis par le circuit vidéo interne de
l'opéra et nous irions ensuite achever la soirée dans un
endroit plus convivial. Va pour ce programme.
Nous arrivons juste à
temps à l'opéra. Mon ami me présente au régisseur qui nous
dit tout de go: "vous tombez bien, je manque de figurants
ce soir". Et avant que j'ai eu le temps de comprendre et
réaliser ce qui m'arrivait, je me trouve en collant vert à
gambader sur la scène de l'opéra de Francfort et faire le
diable autour de la reine de la nuit, dans son grand air
de la flûte enchantée. Voici comment j'ai fait mes débuts
à l'opéra. La représentation achevée, nous sommes allés
dépenser les quelques marks que j'avais gagnés dans une
brasserie du centre ville, et ça n'a pas été triste non
plus.

L'ancien opéra de
Francfort-sur-le-Main, partiellement incendié en 1987
Lorsque j'ai raconté à papa
cette histoire il m'a avoué que lui aussi, du temps où il
était étudiant, a fait de la figuration à l'opéra. C'était
facile me dit-il. Nous avions un meneur qui était un peu
habitué du spectacle et il suffisait de le suivre. Or voilà
qu'un jour ce meneur, empêtré dans un long péplum,
s'accroche dans un clou dépassant d'un portant et arrive en
slip sur la scène d'opéra. Scandale. Il fallut baisser le
rideau. Le meneur fut congédié. Les autres figurants,
jugeant cette punition fort injuste se promirent de le
venger. L'occasion ne se fit guère attendre. La scène se
passait au pieds de murailles sur laquelle un ténor chantait
son grand air pendant qu'une troupe de figurant faisait les
assaillants et cherchait à escalader la muraille tout en
lançant de grosses pierres. Bien entendu ces pierres étaient
en carton pâte. Les figurants se sont donnés le mot: "visez le ténor". Le
malheureux, esquivant l'attaque de son mieux finit par se
planter et fit un couac d'une telle laideur que l'on dut,
une fois de plus, baisser le rideau sous les sifflets du
public. Papa ne fut plus jamais admis à l'opéra depuis ce
jour mémorable.
Il avait déjà fait de la figuration lors de son service
militaire, mais dans un film. Son unité avait été
réquisitionnée pour figurer dans un film qui se passait au
moyen-âge, sous les remparts de Carcassonne. Le metteur en
scène donne ses instructions. "À mon signal vous montez à l'assaut. Vous posez
des échelles de long des murailles et commencez à monter.
Mais une troupe de soldats vous attend, qui va vous
bombarder de pierres. Ne craignez rien, ce sont des
éponges. Dès le premier jet de pierres, la moitié d'entre
vous va tomber à terre, morts. L'autre moitié continuera
l'assaut". Moteur. La troupe s'ébranle avec ses
échelles, reçoit la première volée de pierres et comme un
seul homme tout le monde se trouve mort: c'était moins
difficile. On dut recommencer: "ceux dont l'initiale va de A à L mourront, les
autres monteront à l'assaut". Il fallait le dire.
La mémoire qui flanche
Maman, sur ses vieux jours, avait la hantise de perdre la
mémoire aussi s'entraînait-elle soigneusement à exercer
son esprit; ce qui n'a hélas pas été suffisant. Elle avait
longtemps été une très bonne bridgeuse, participant à de
nombreux tournois de bridge et les gagnant alors même
qu'elle n'avait plus, comme on dit, toute sa tête. Puis,
faute de partenaires, elle s'était mise au scrable,
jusqu'à ce que plus personne dans son foyer logement ne
veuille jouer avec elle, car elle était devenue, en toute
innocence, une redoutable tricheuse.
Ce fut alors le déclin
mais un petit détail nous intriguait. Maman avait pris
l'habitude de fabriquer des mots, de toutes pièces, au
moment où l'on s'y attendait le moins. Par exemple nous
prenions le café et soudain maman, avec un air inspiré,
nous assénait un péremptoire "cafetièrassent". Allez
comprendre. C'est moi ai levé le lièvre: maman continuait
à jouer toute seule au scrable dans sa tête, et comme elle
avait pris l'habitude de tricher, elle en rajoutait. Un
jour où elle venait de nous sortir un de ces néologismes
de derrière les fagots, je lui dis "alors là, tu triches
vraiment un peu trop!". Maman éclata de rire: je
l'avais comprise. Depuis ce temps elle ne nous a plus
fabriqué aucun mot nouveau.

Retour à la table des matières