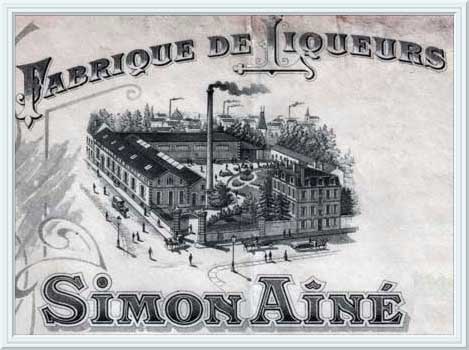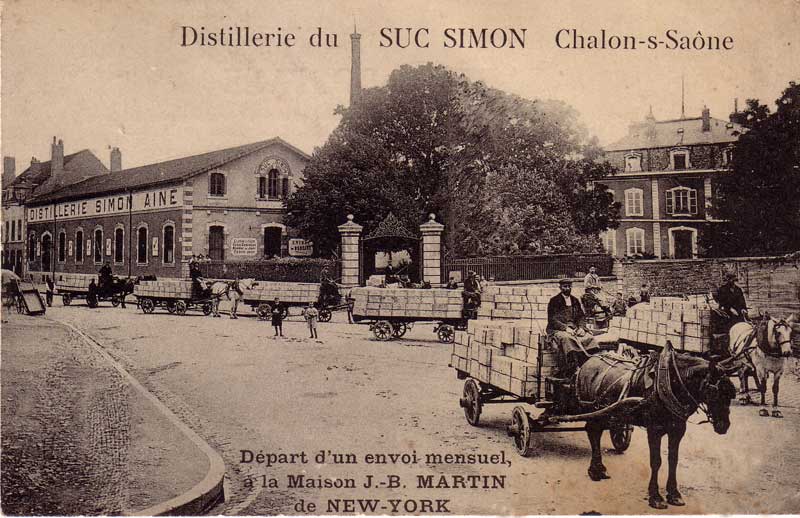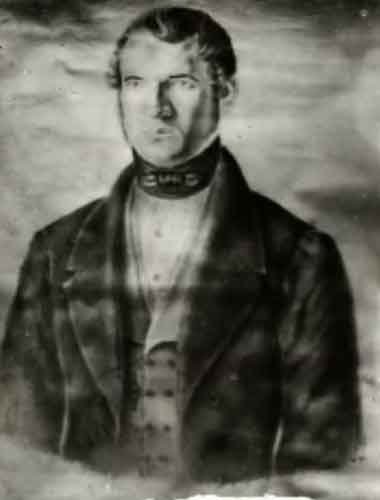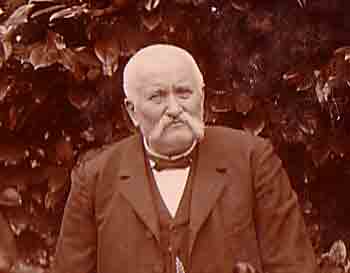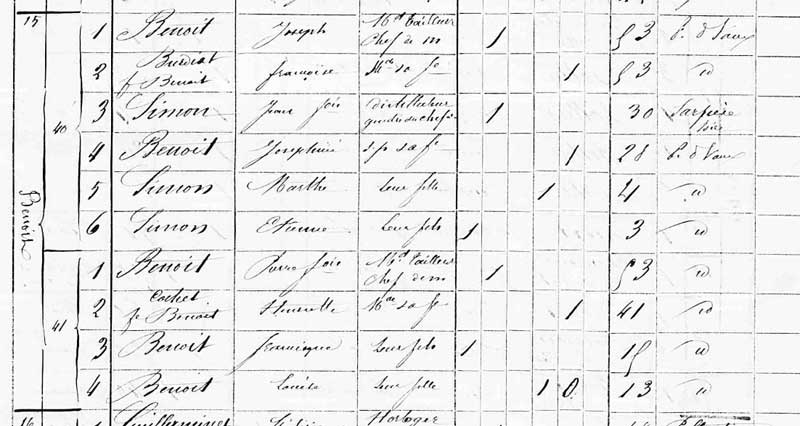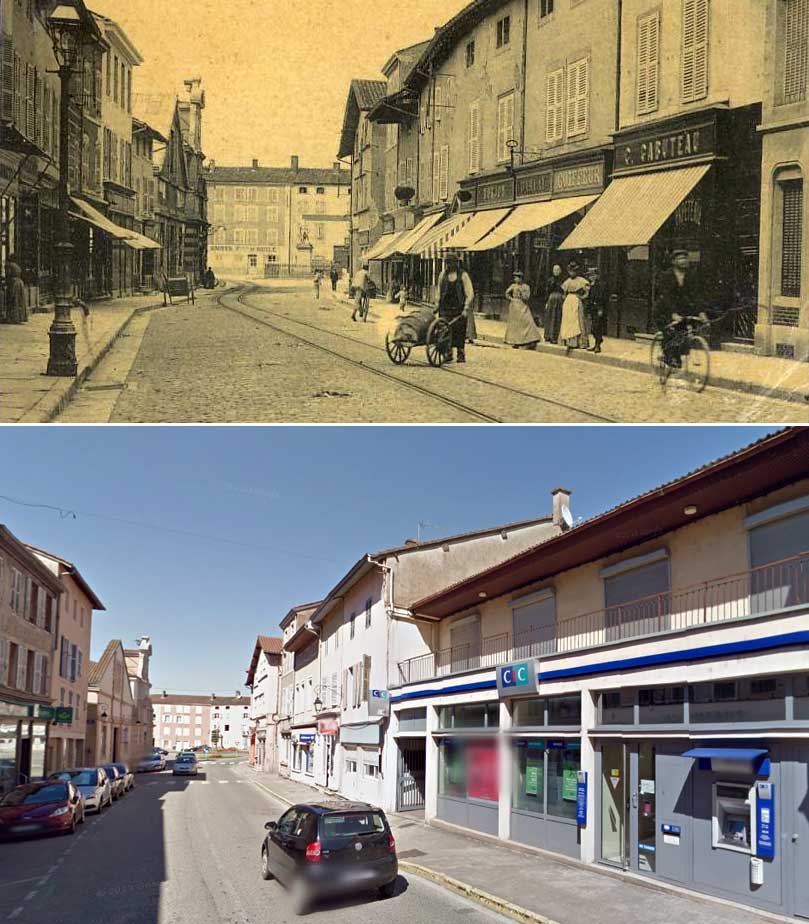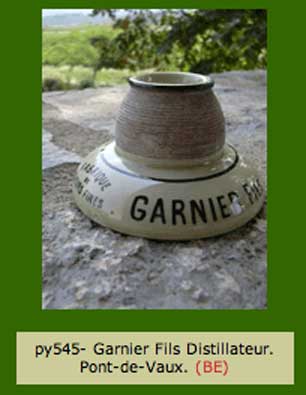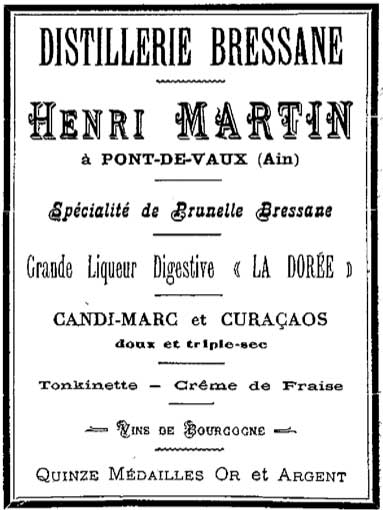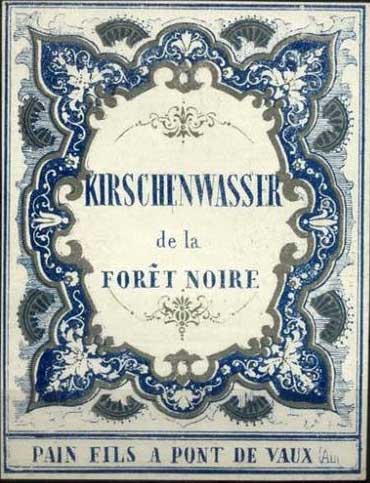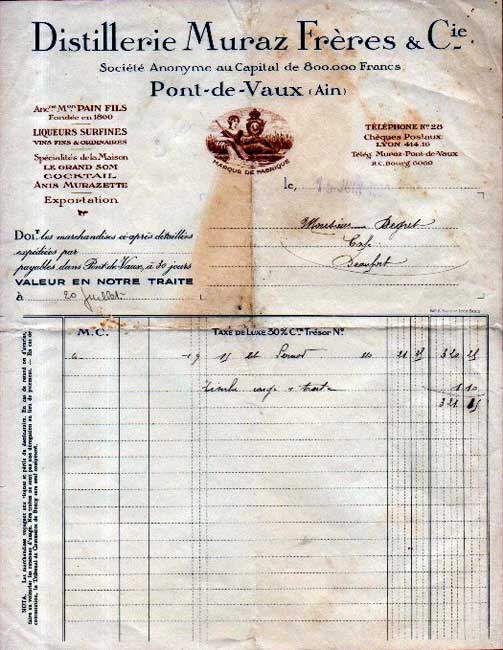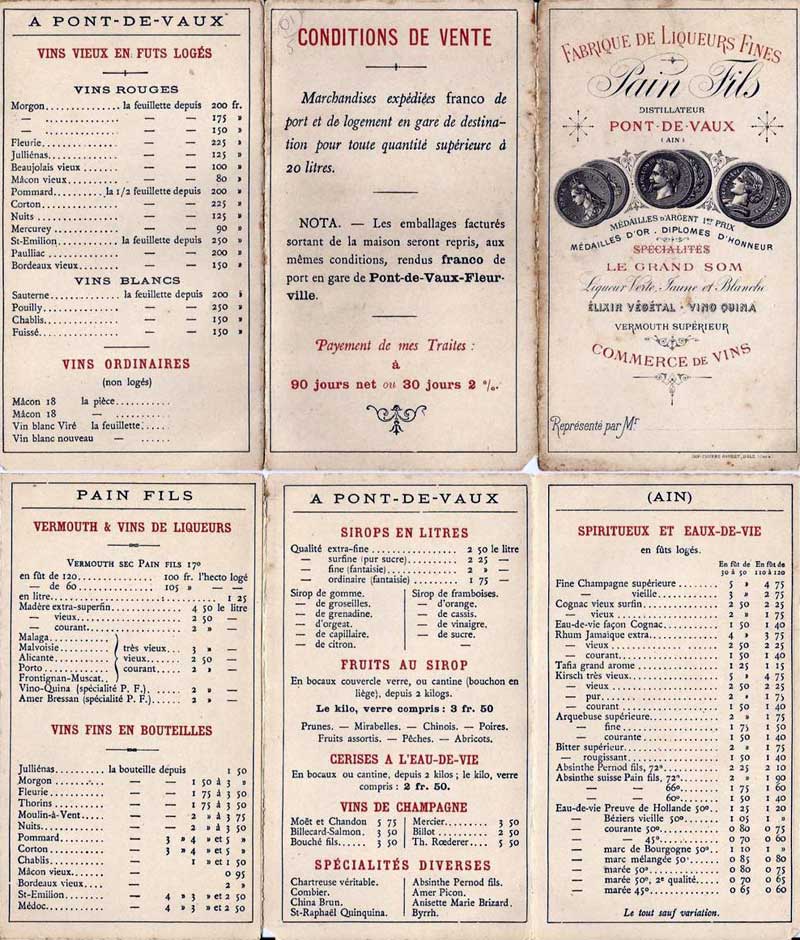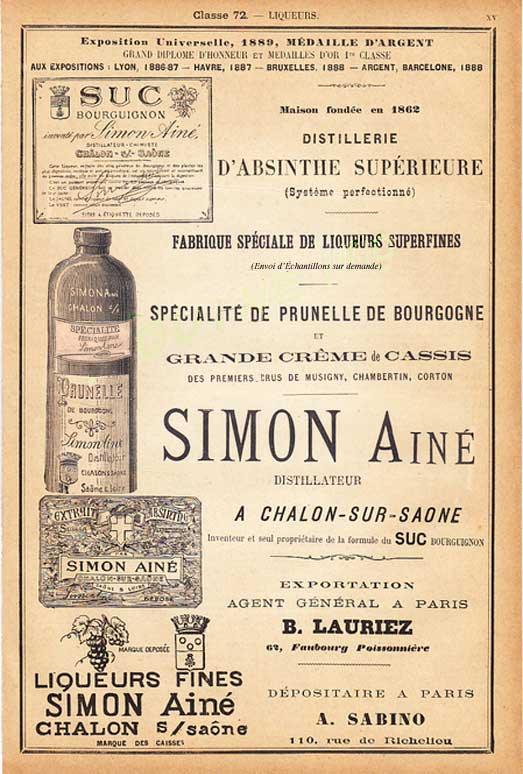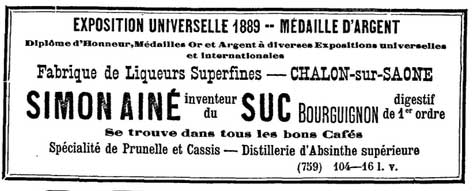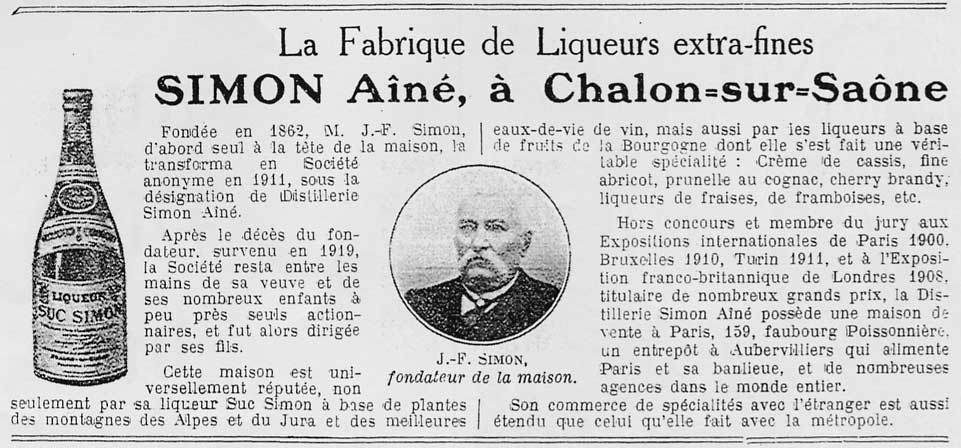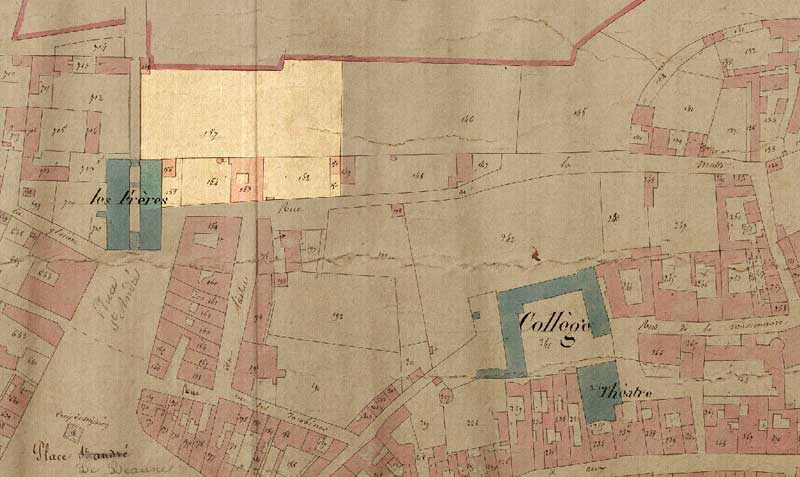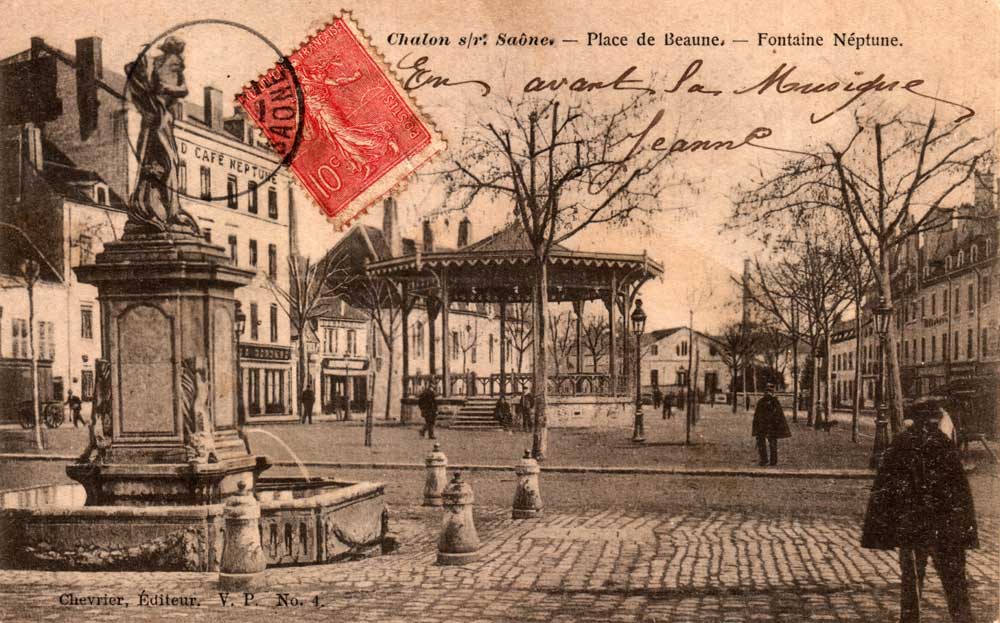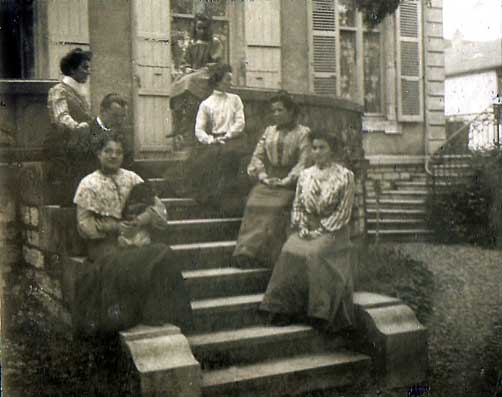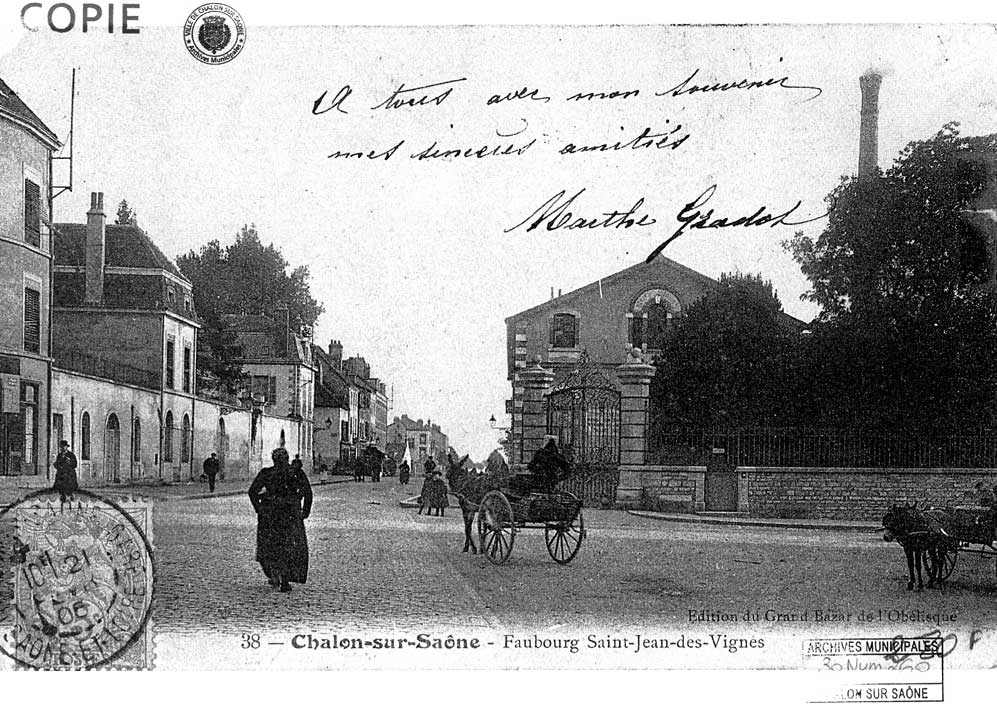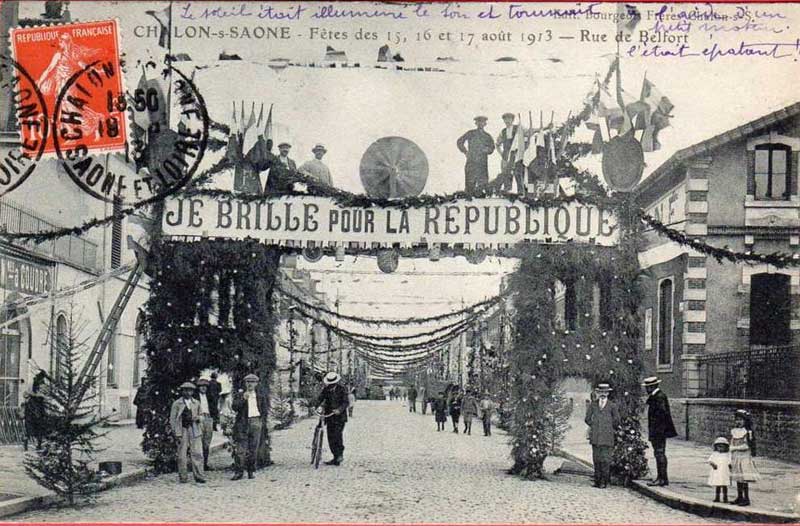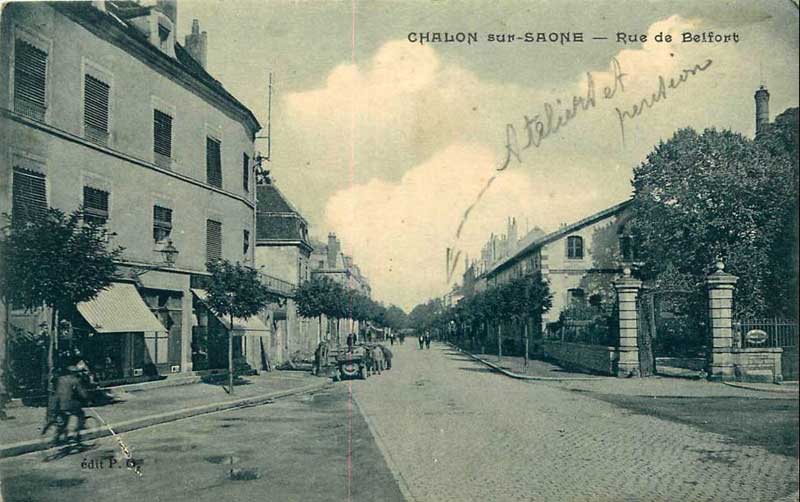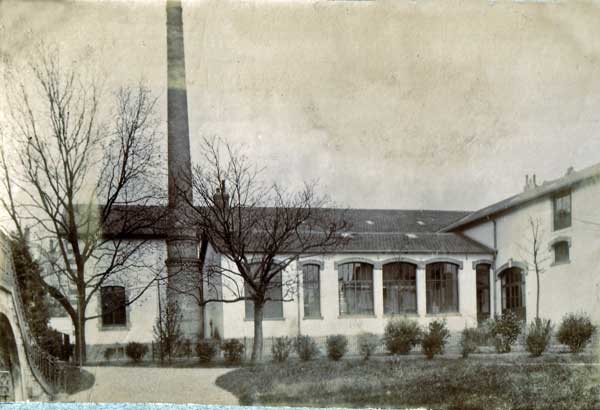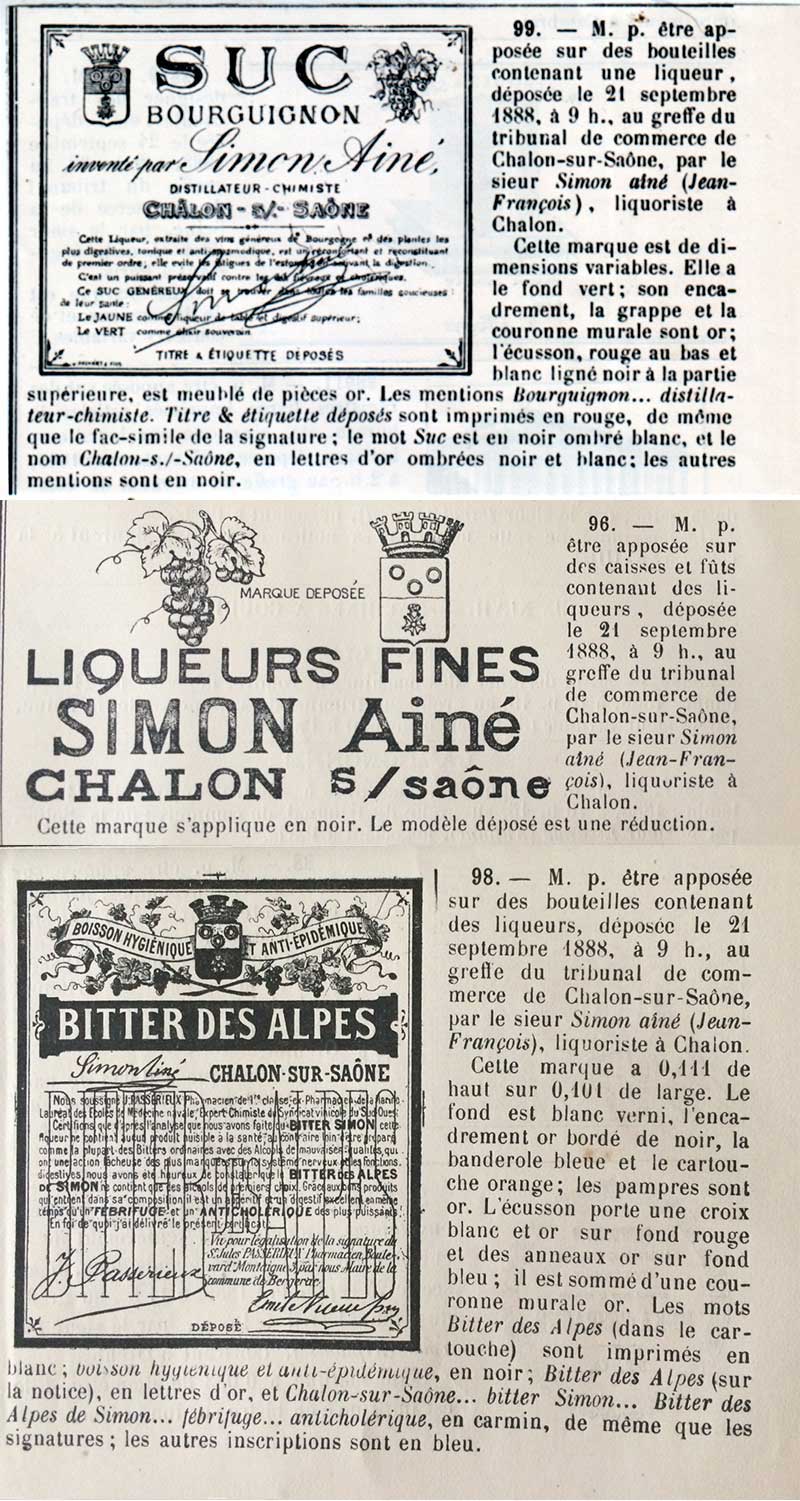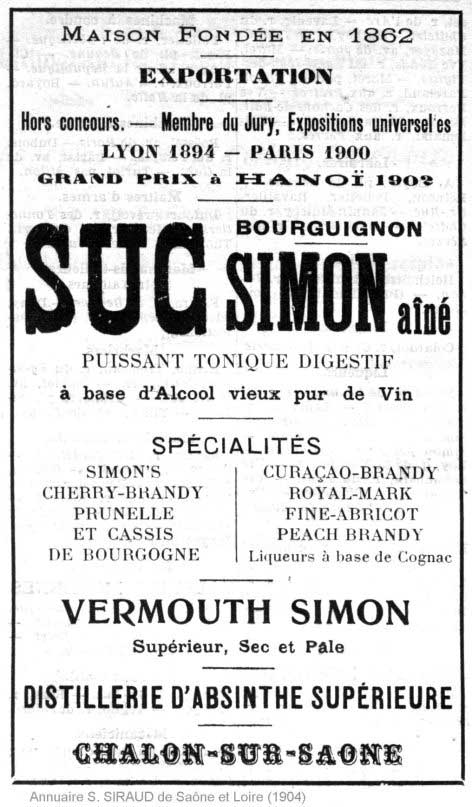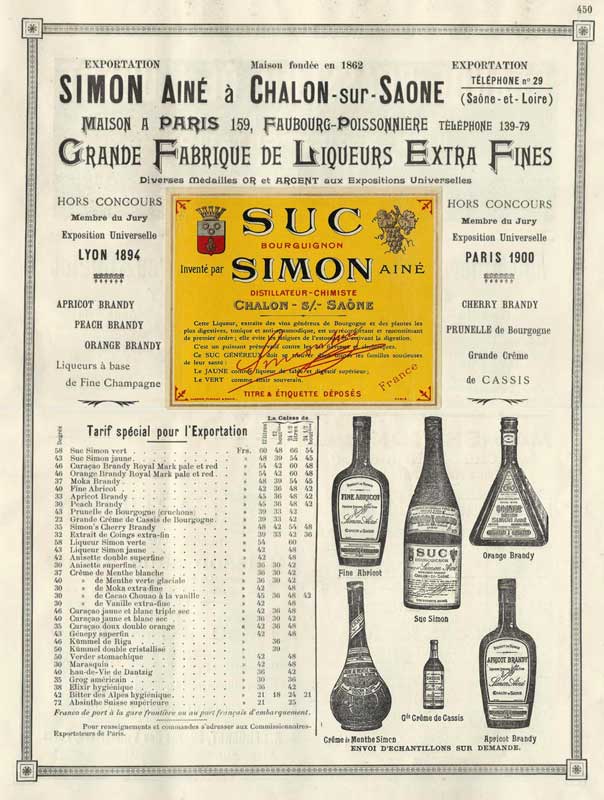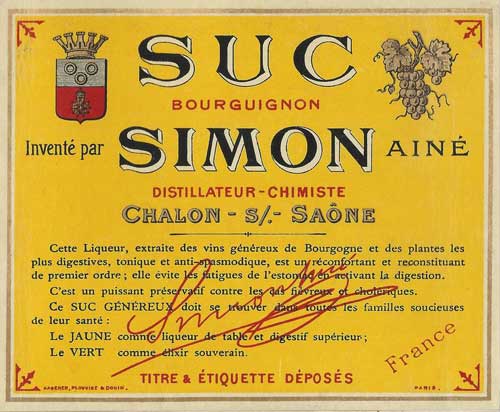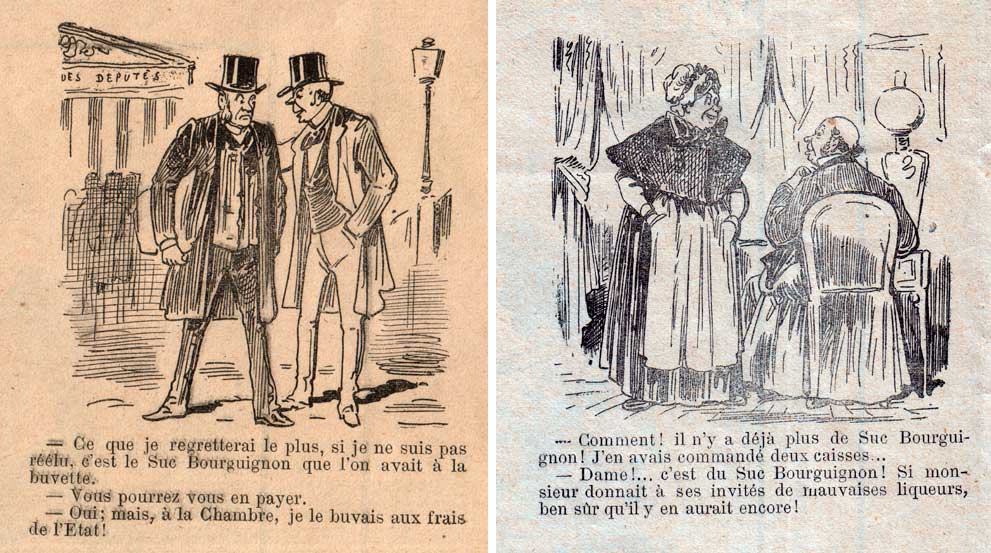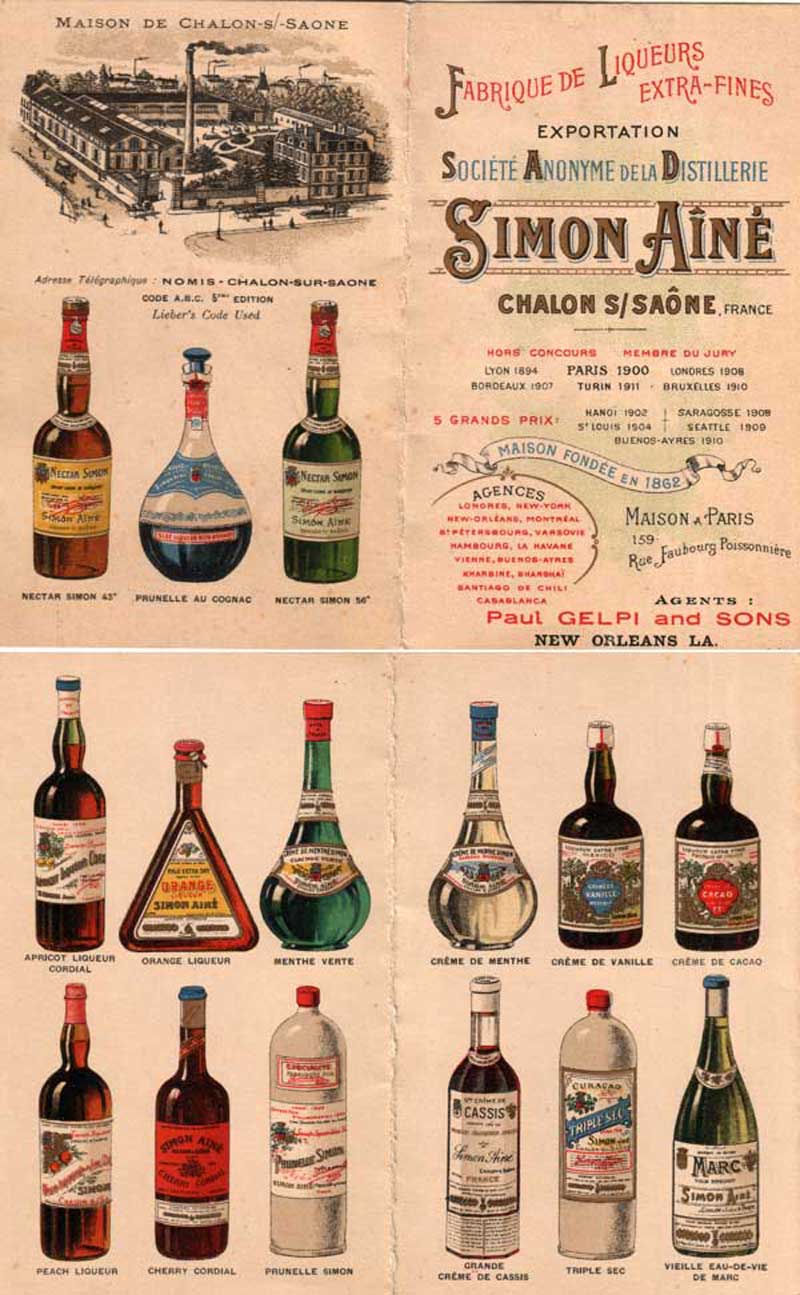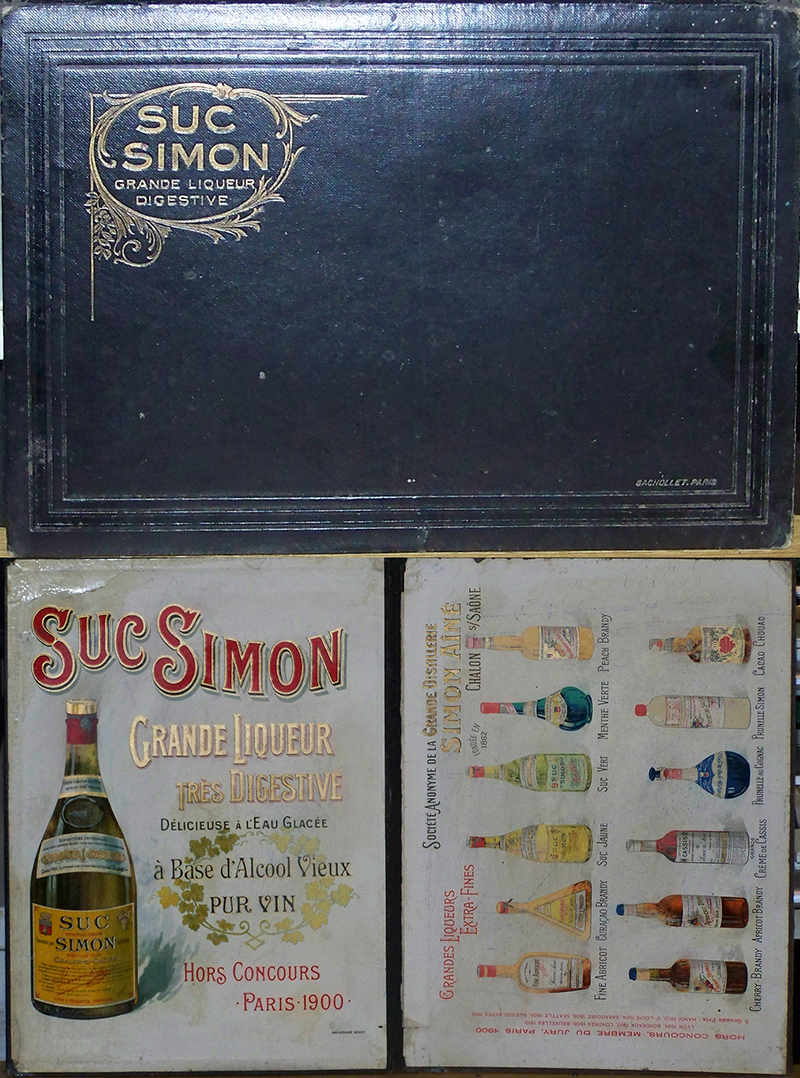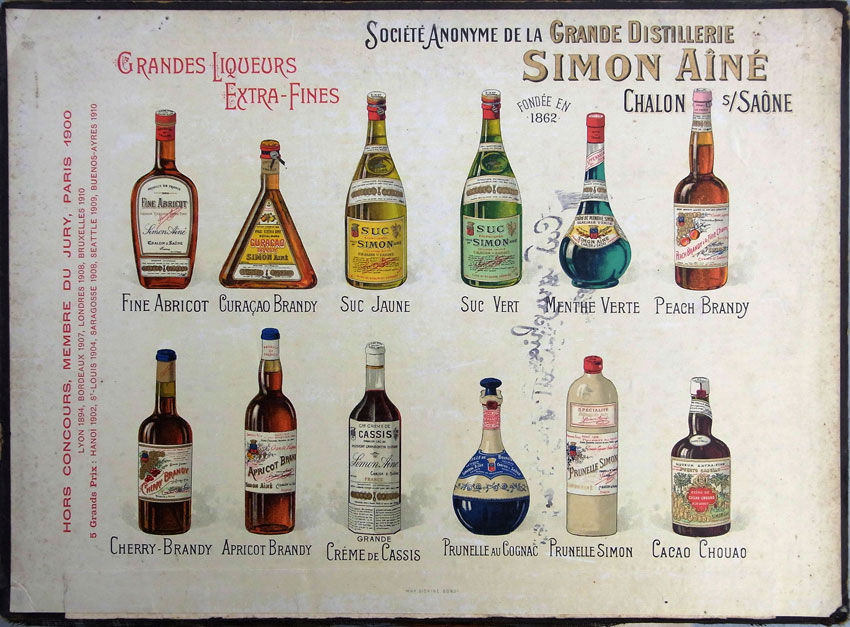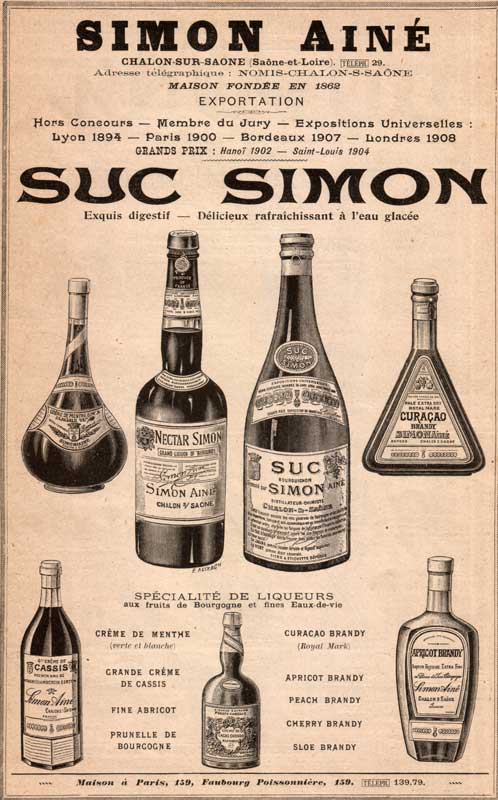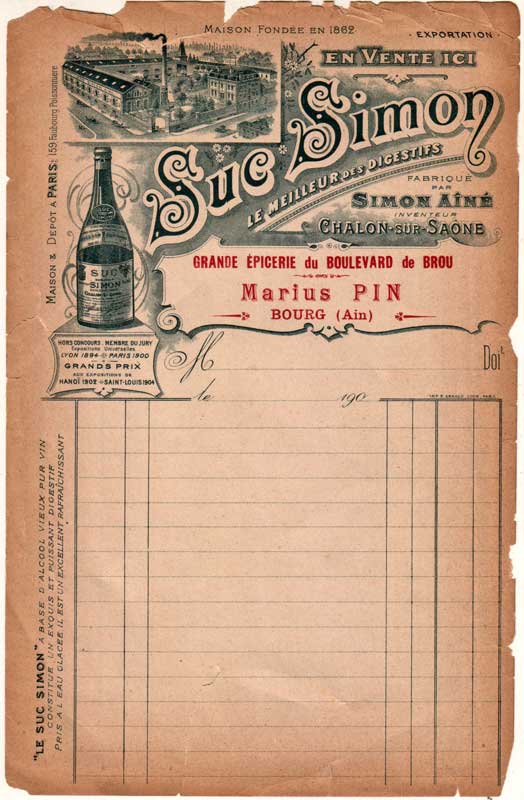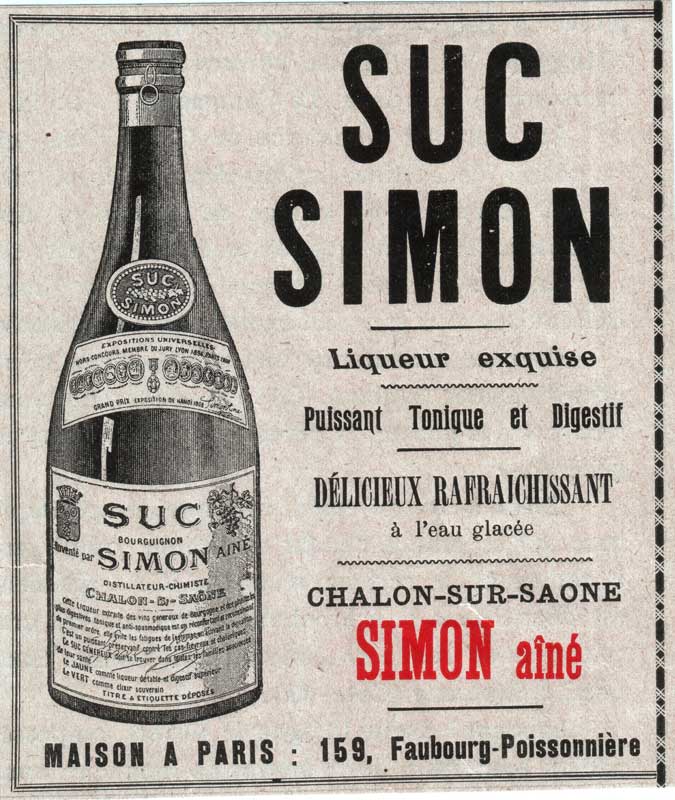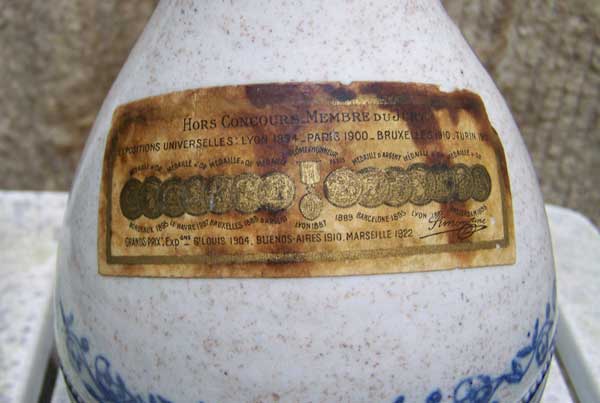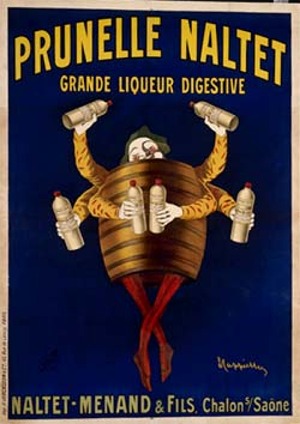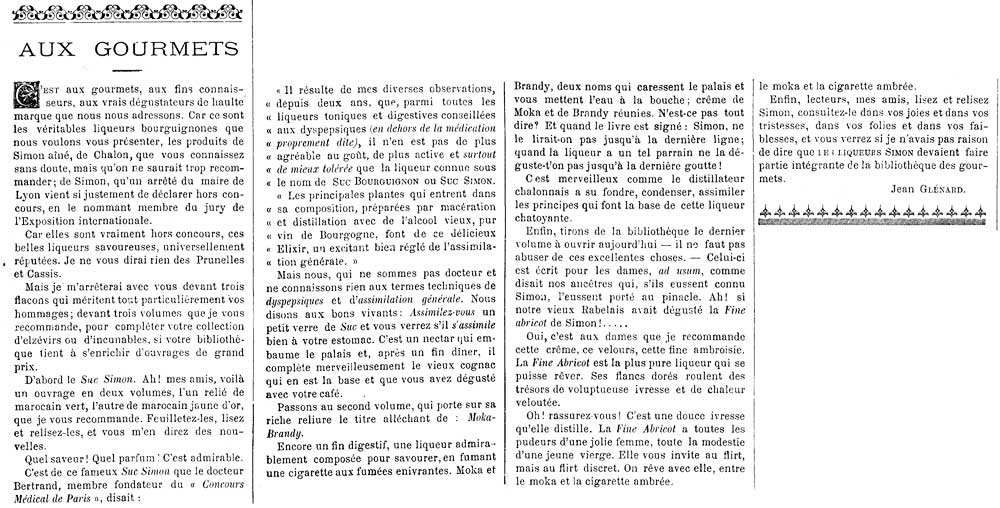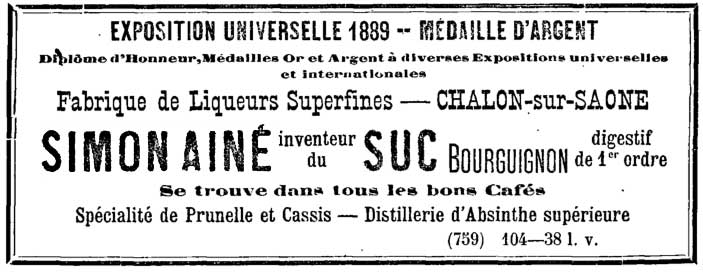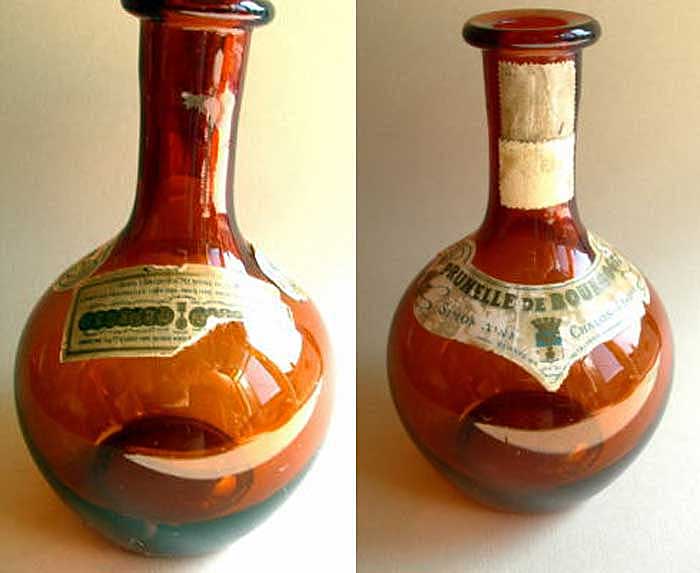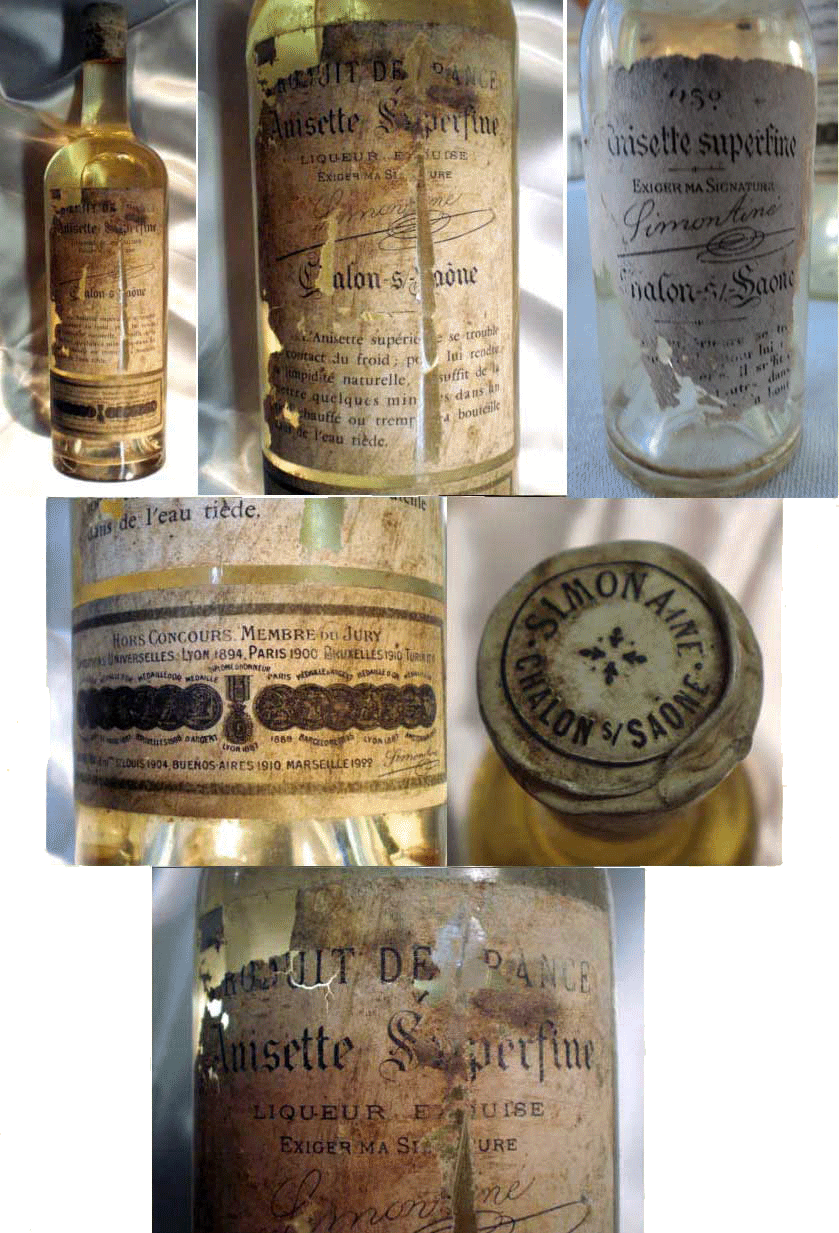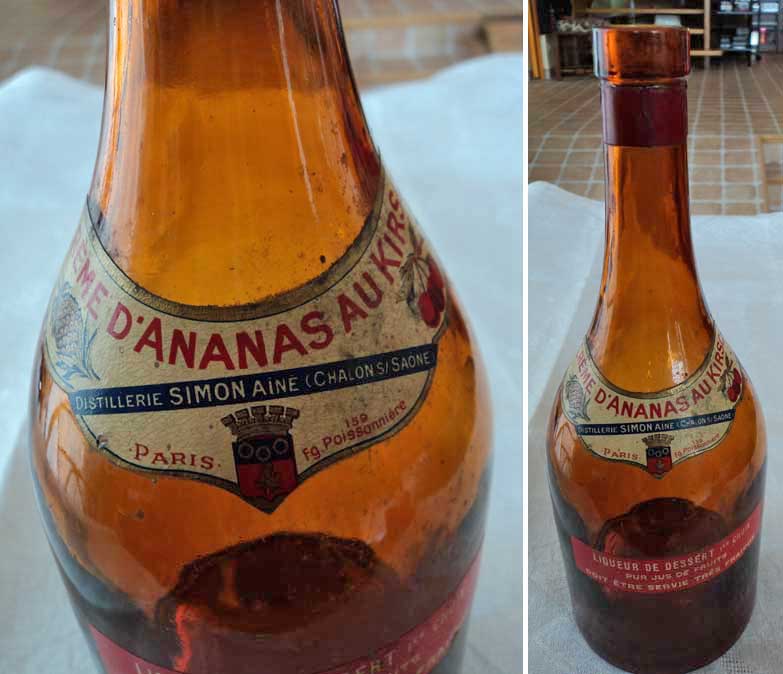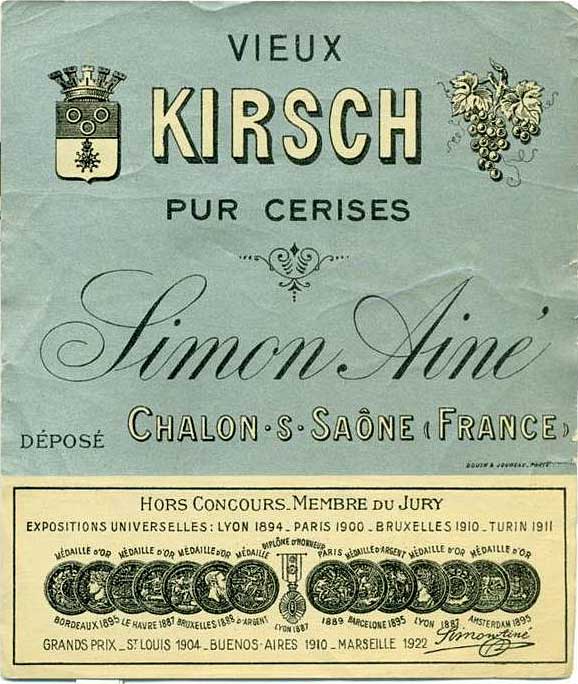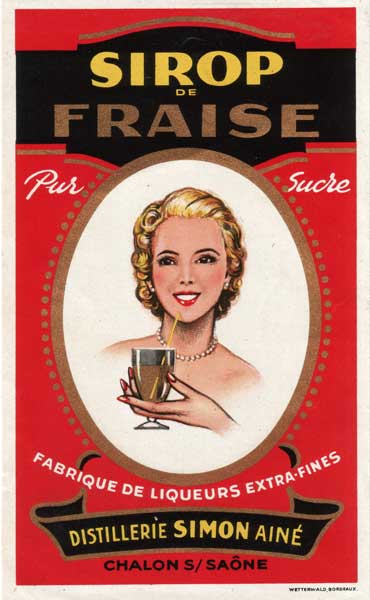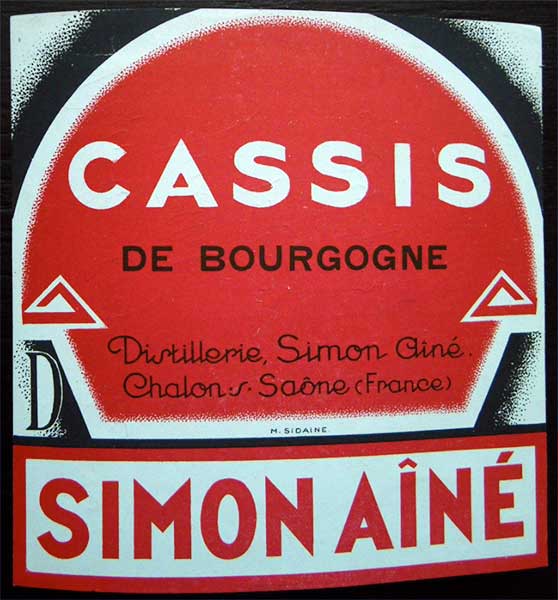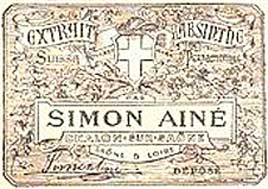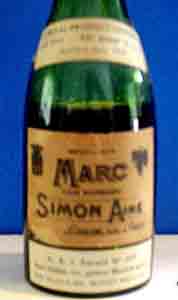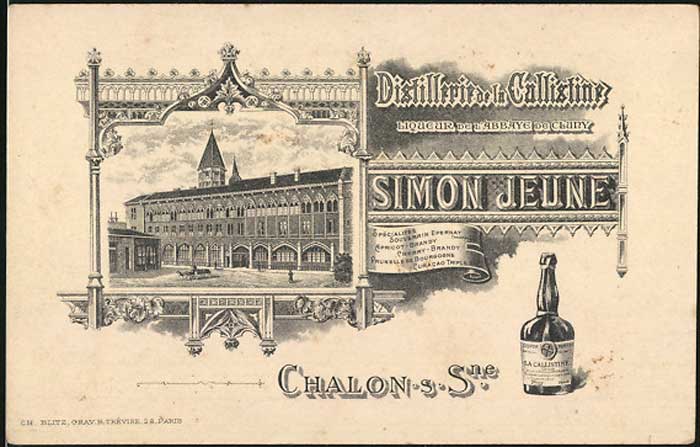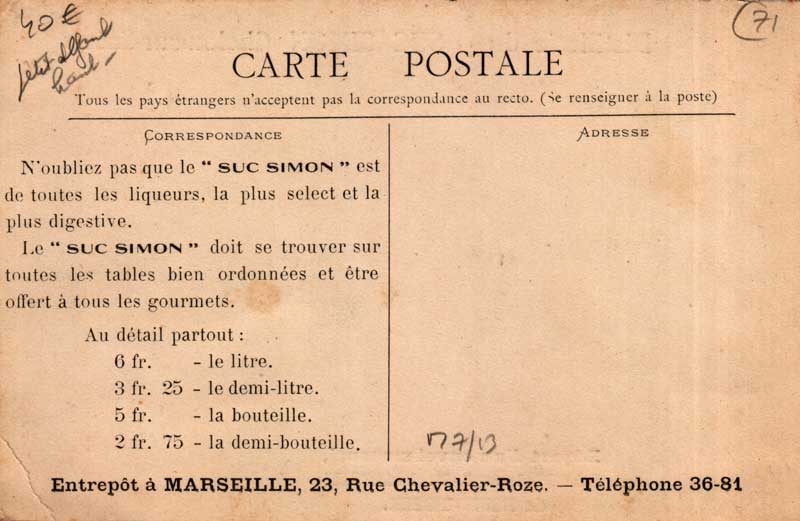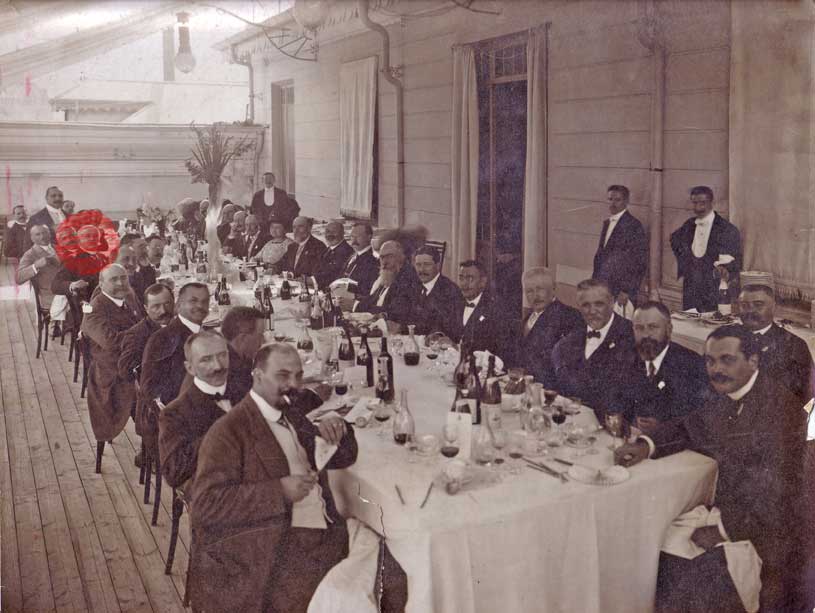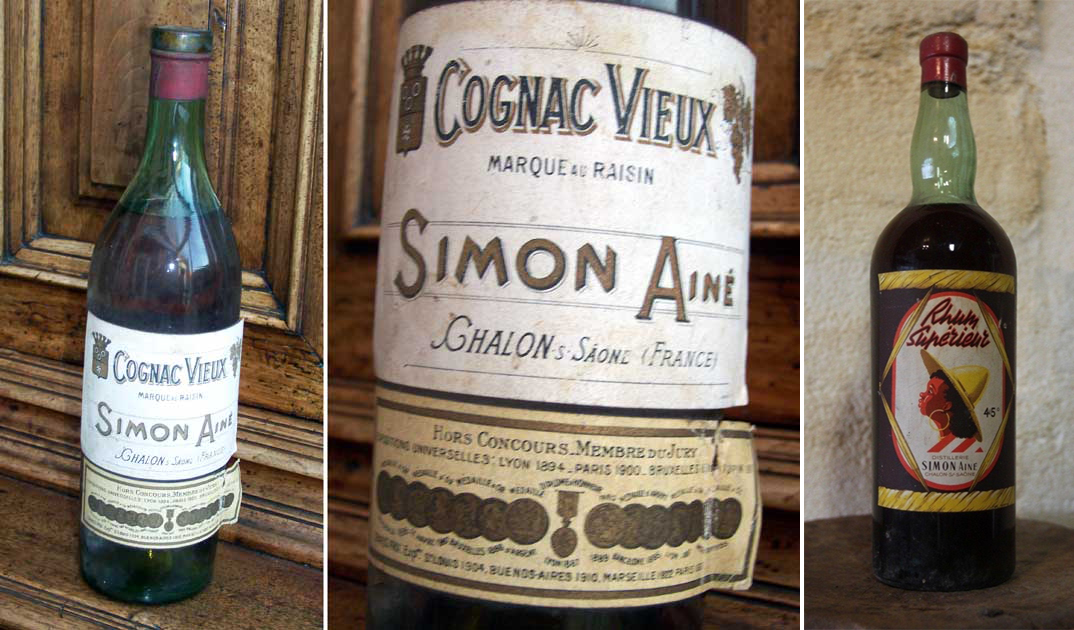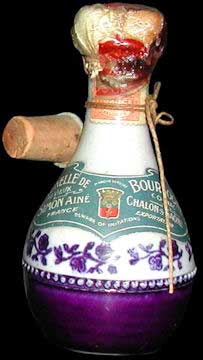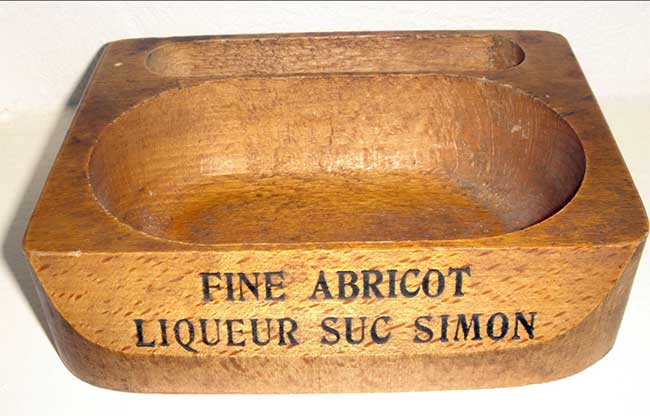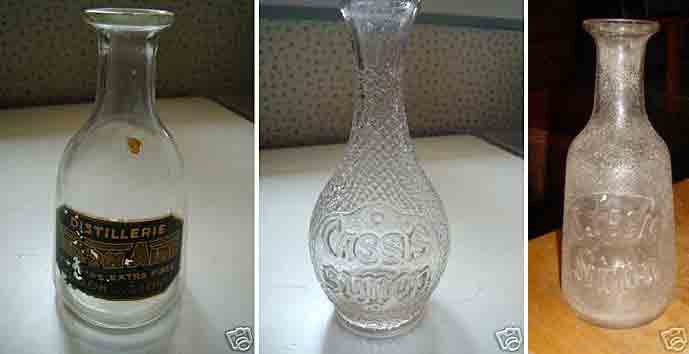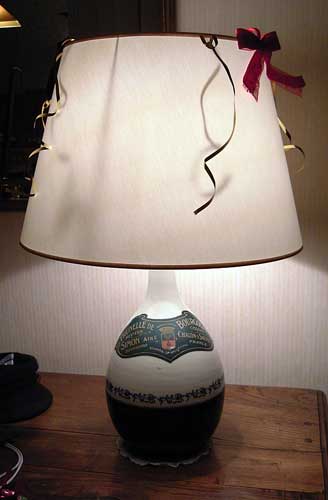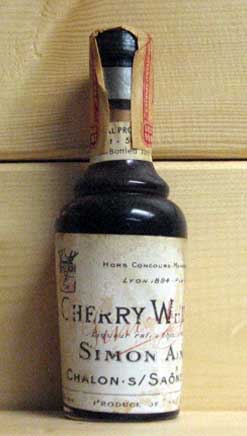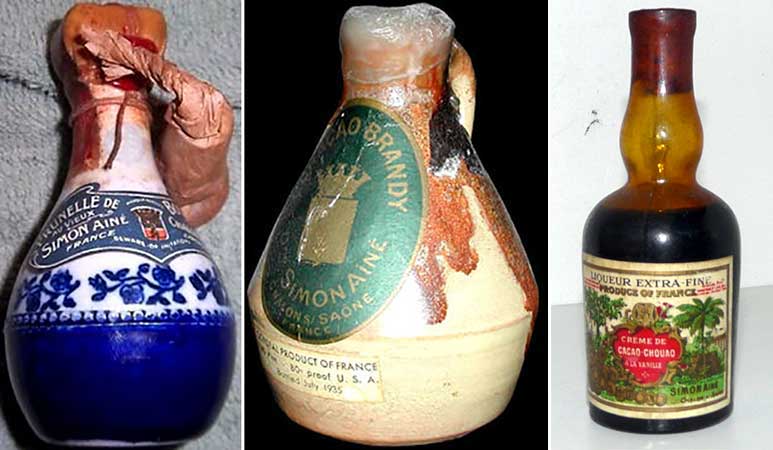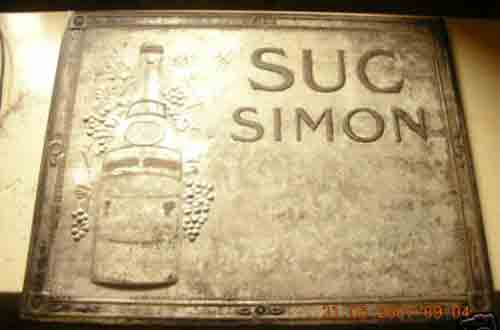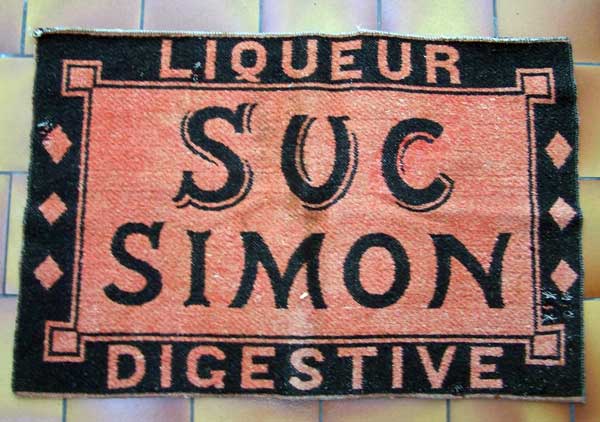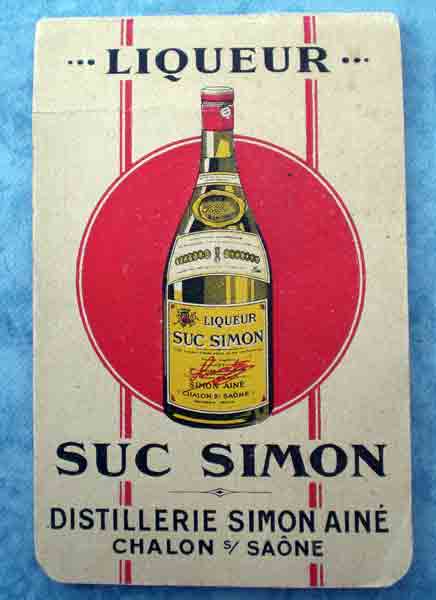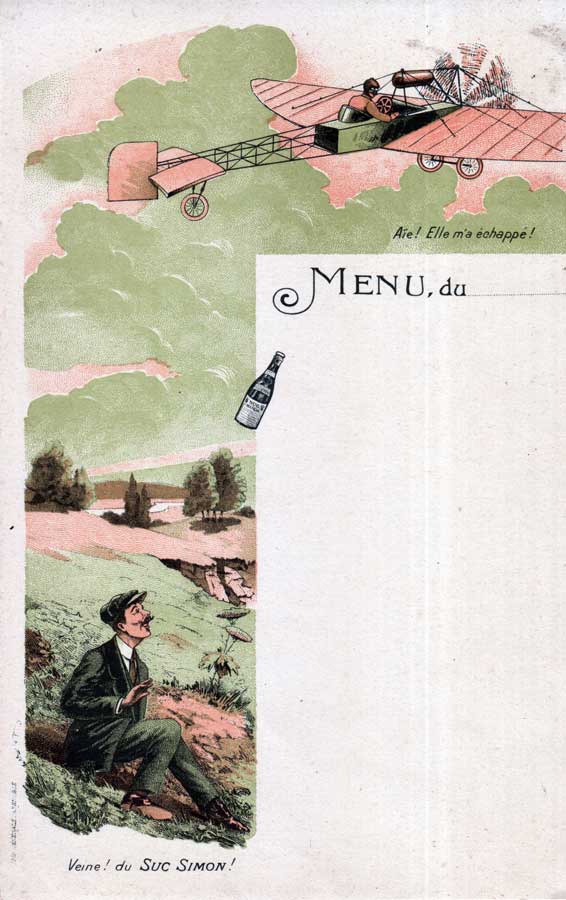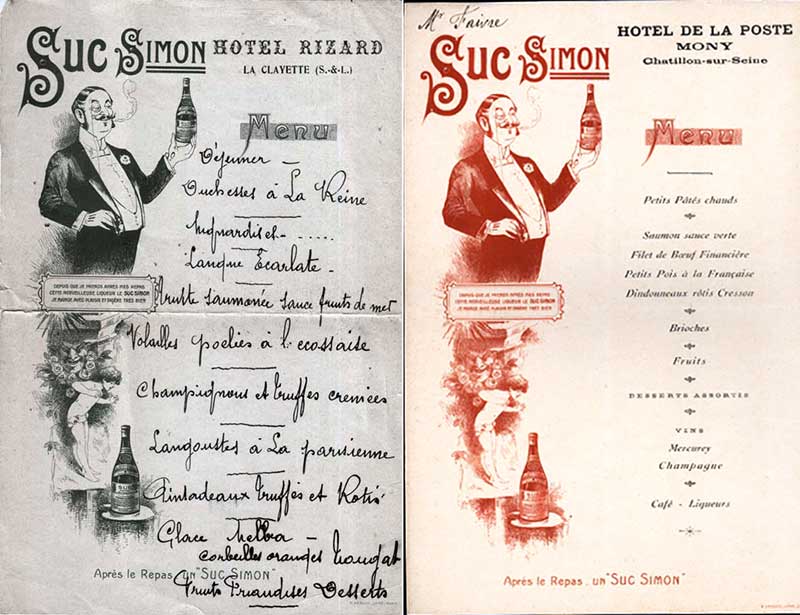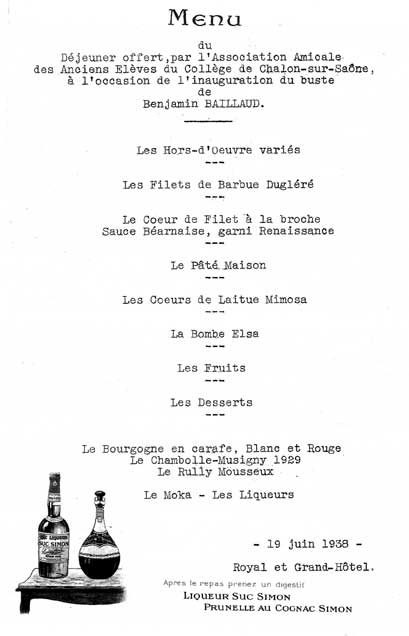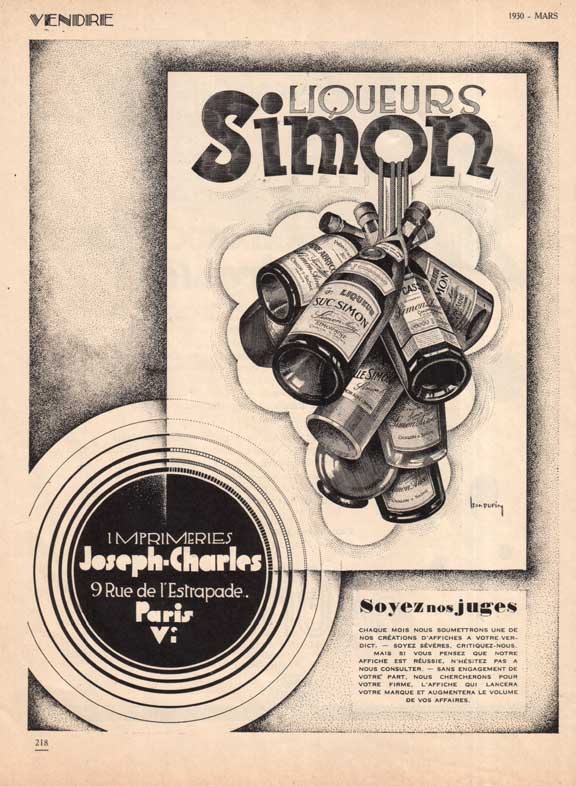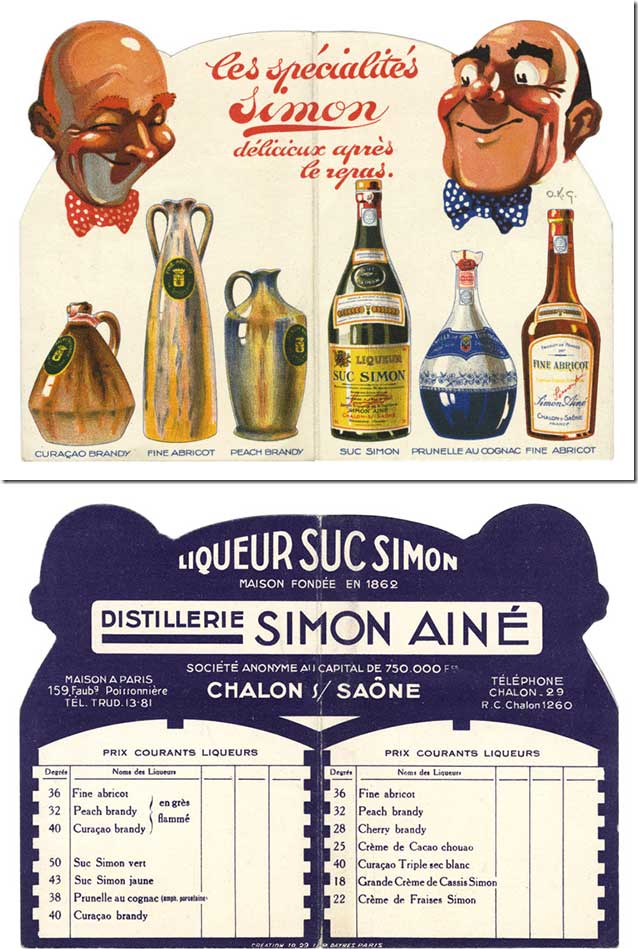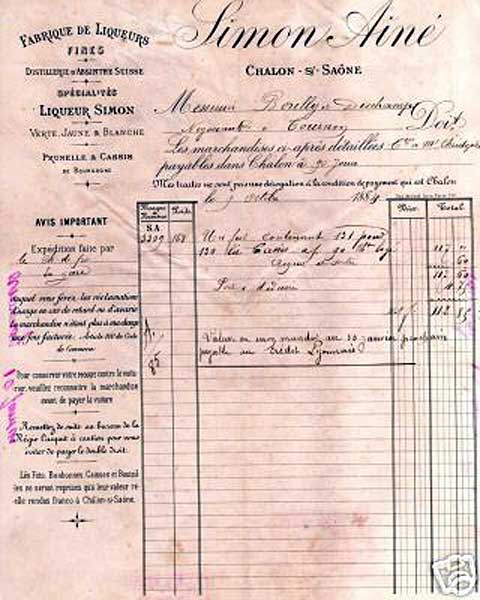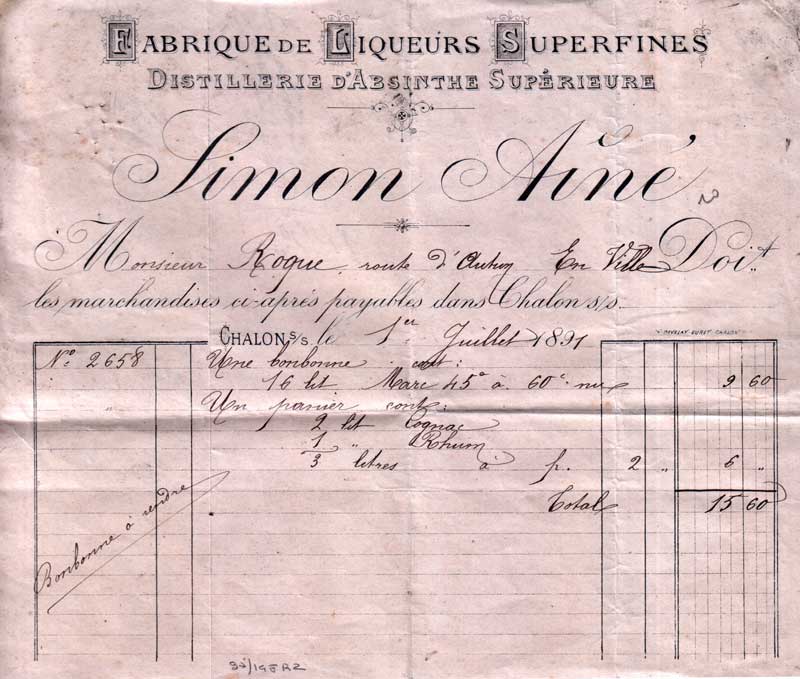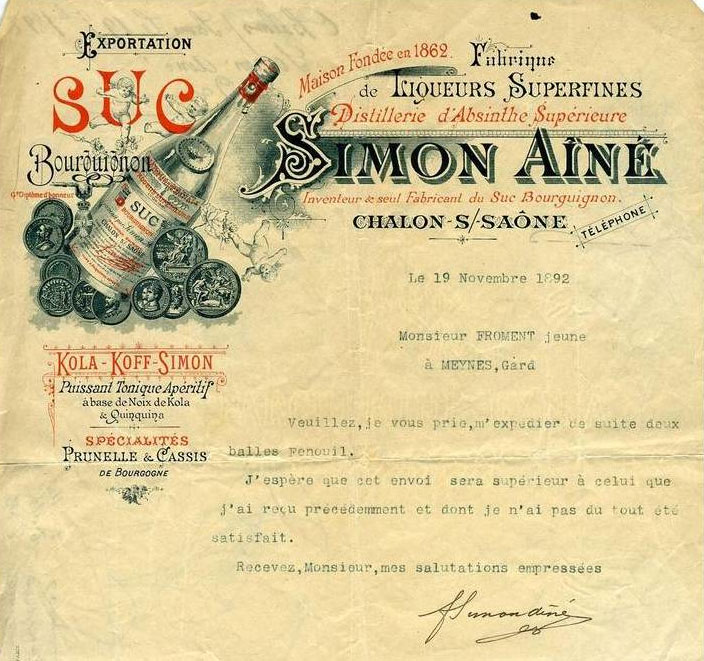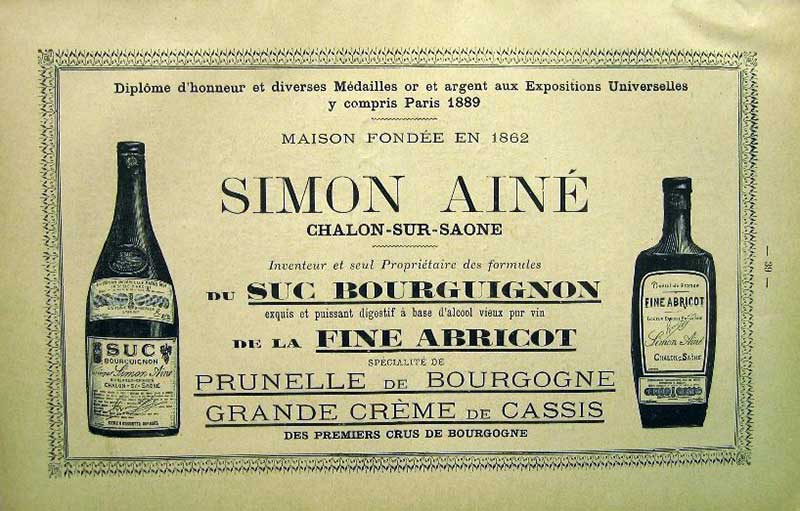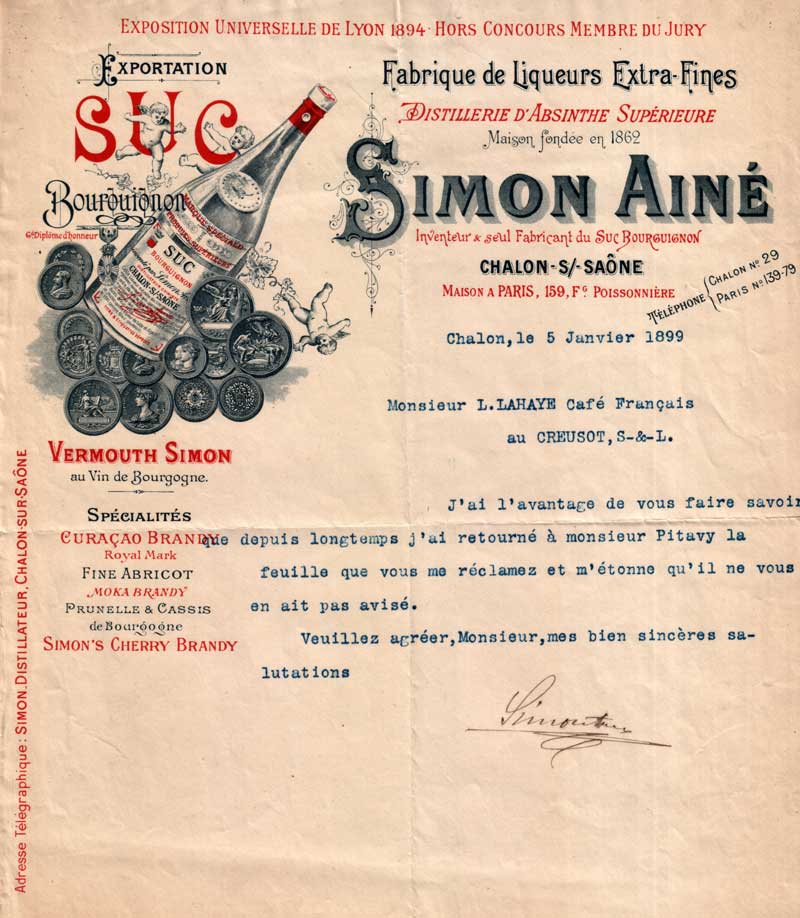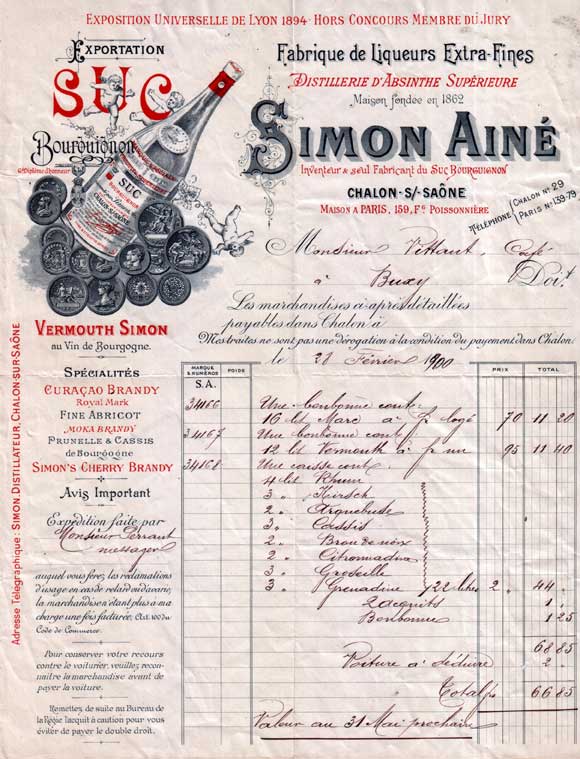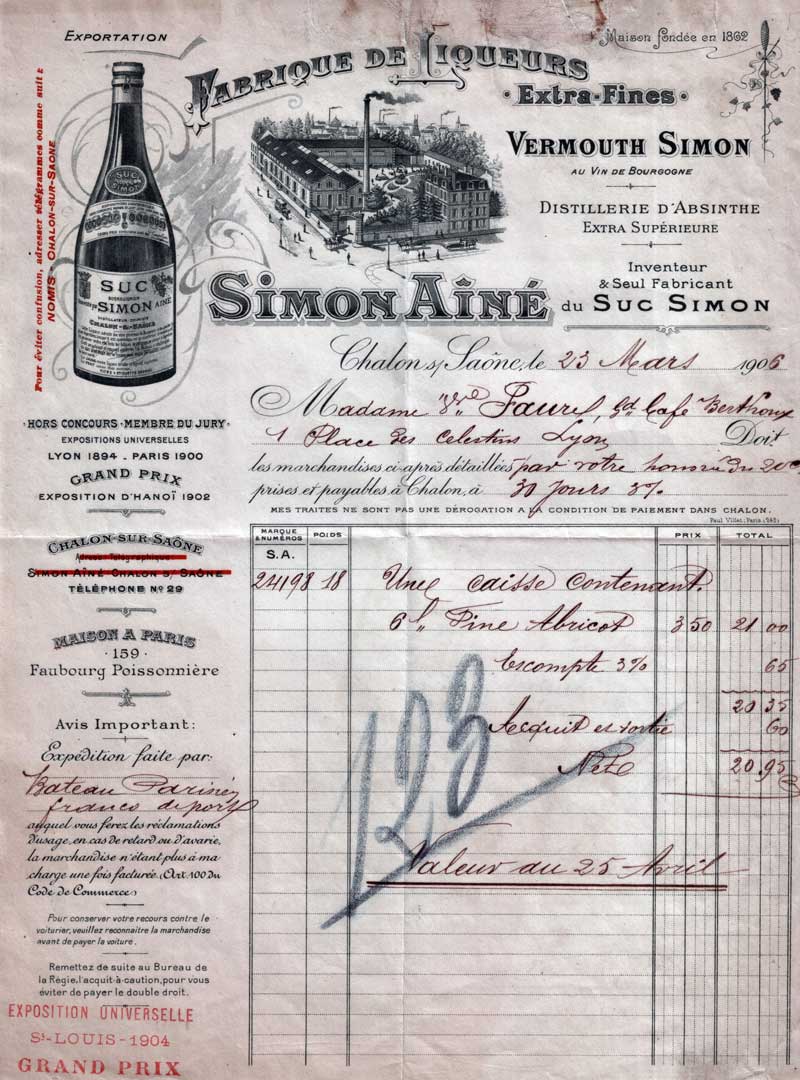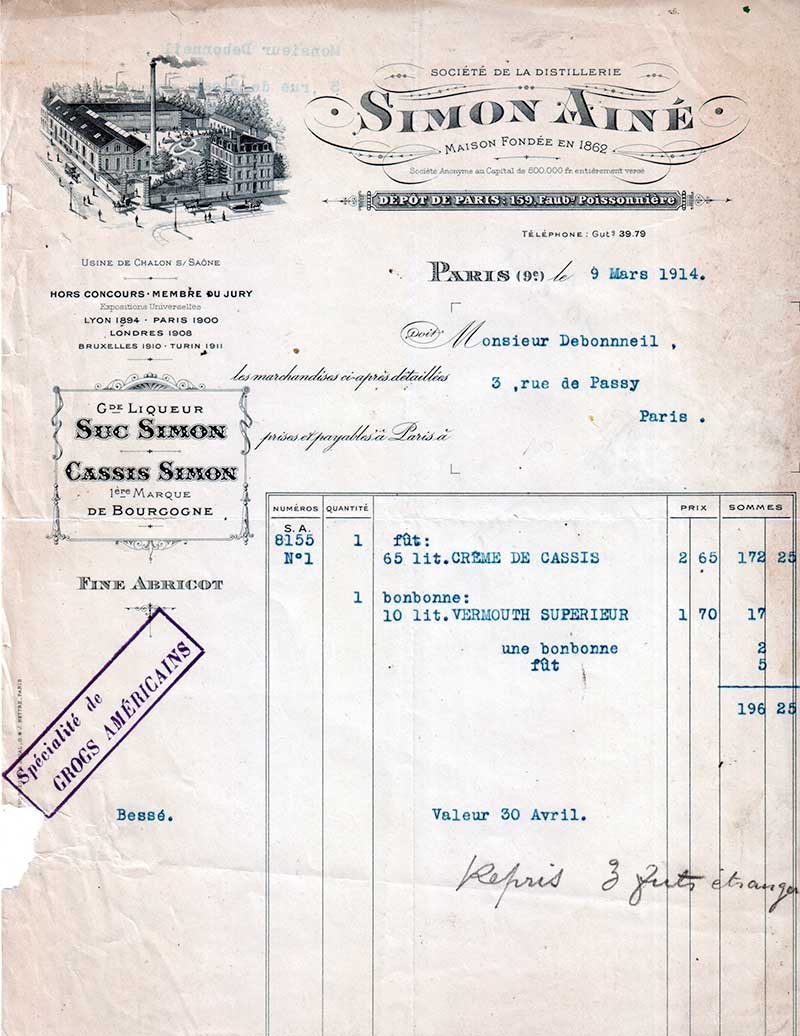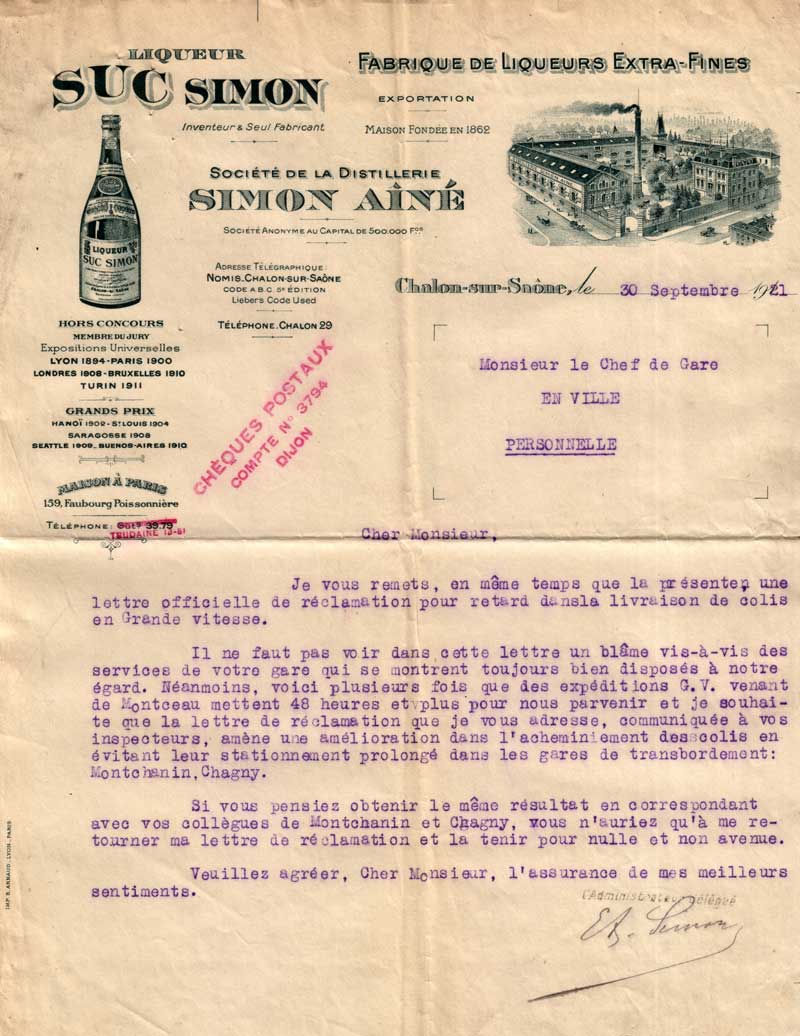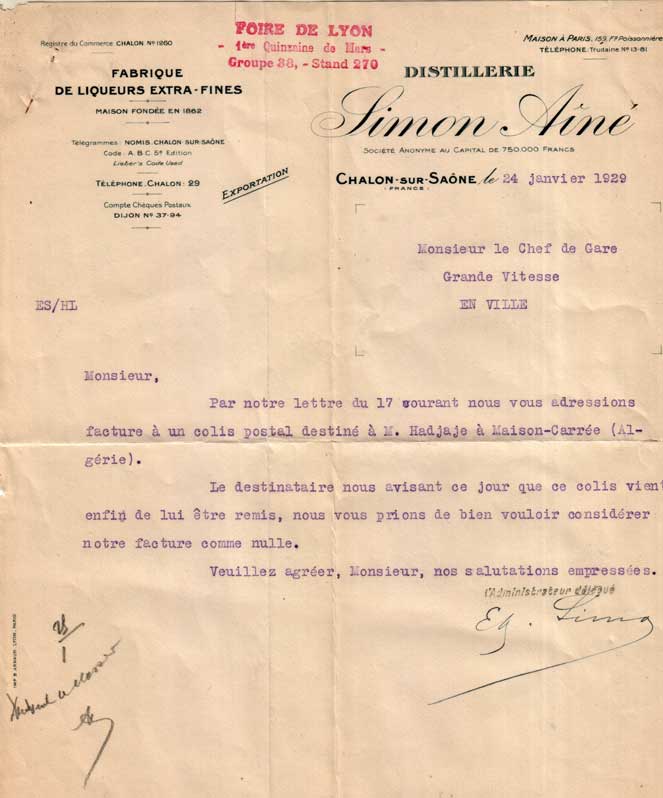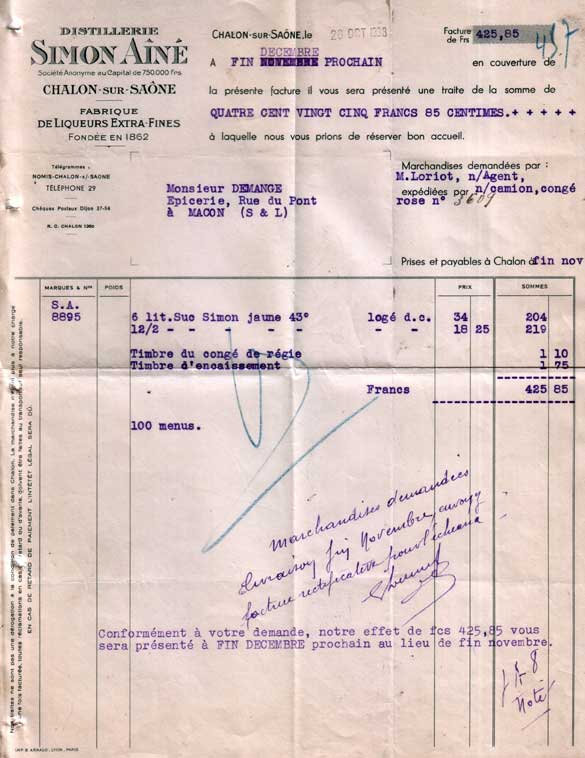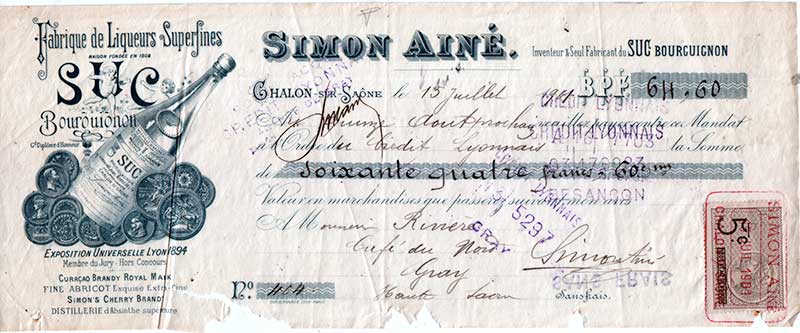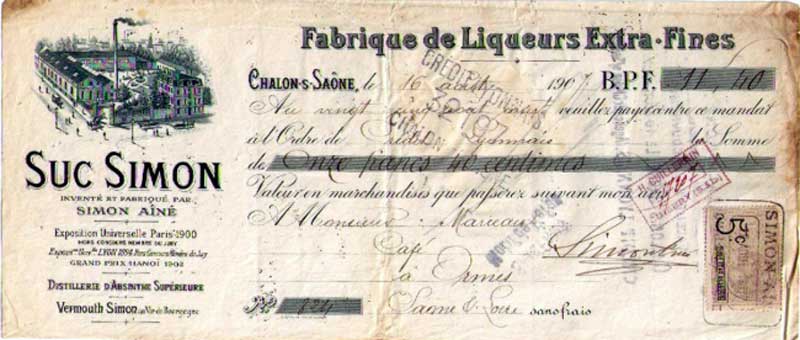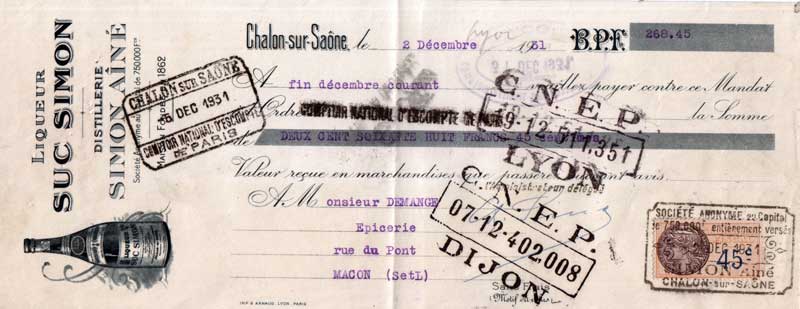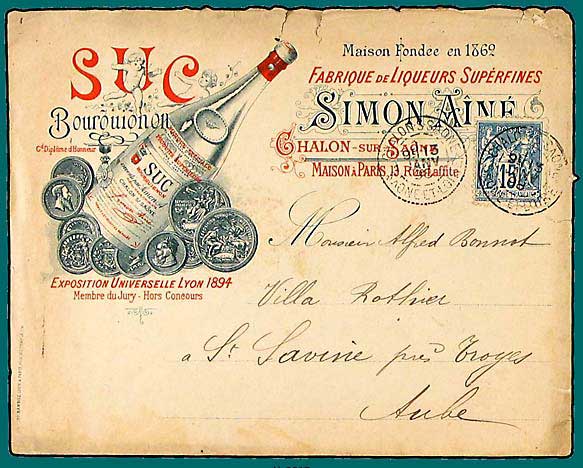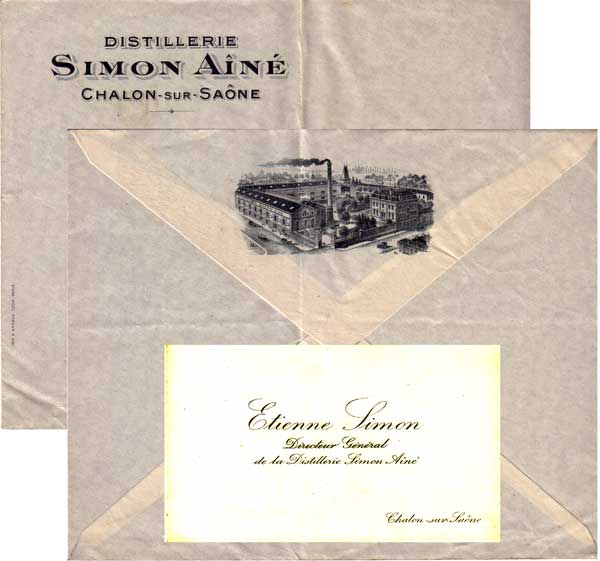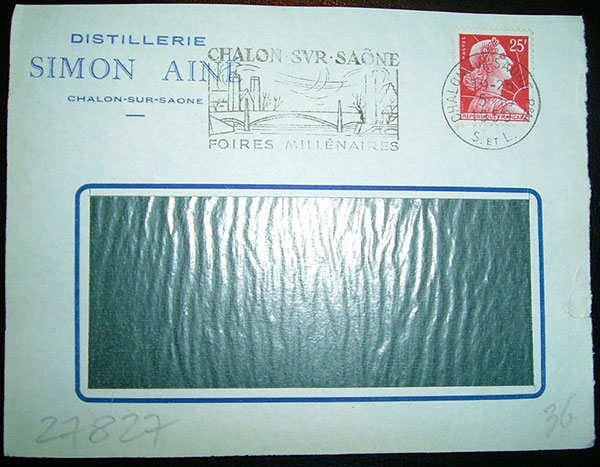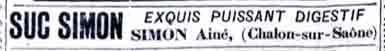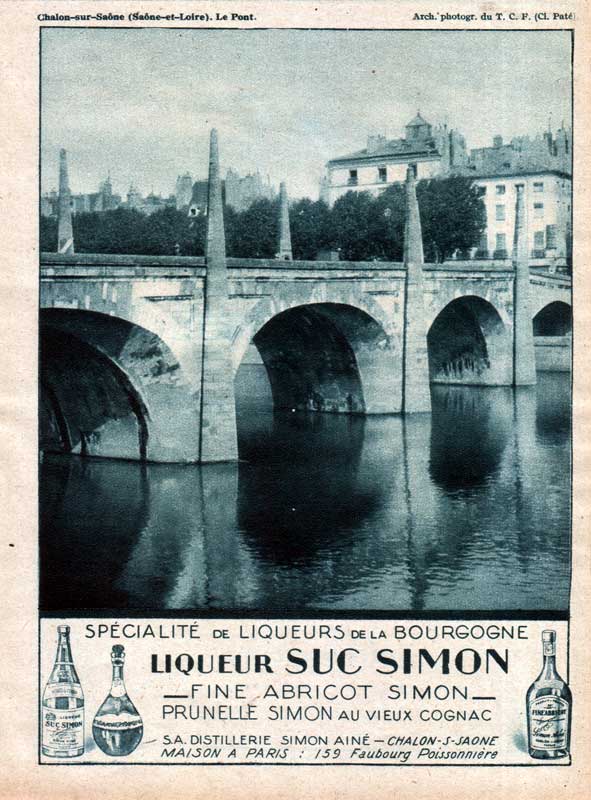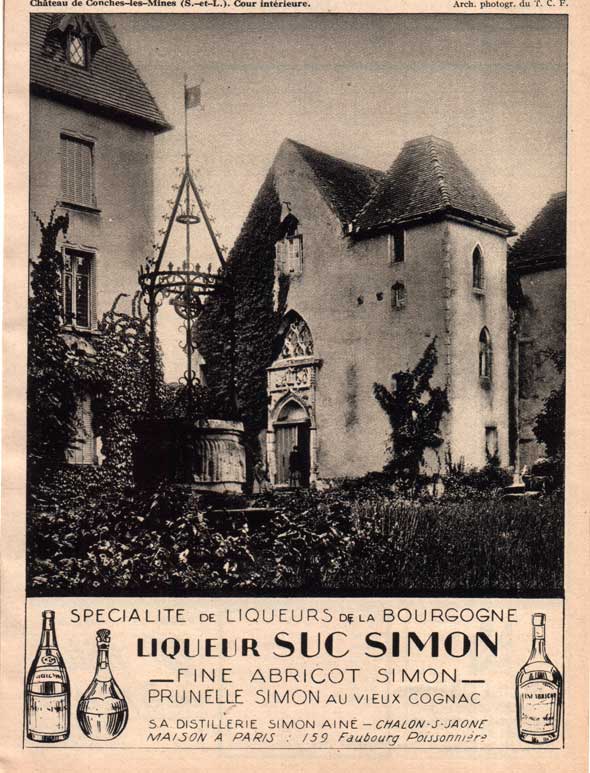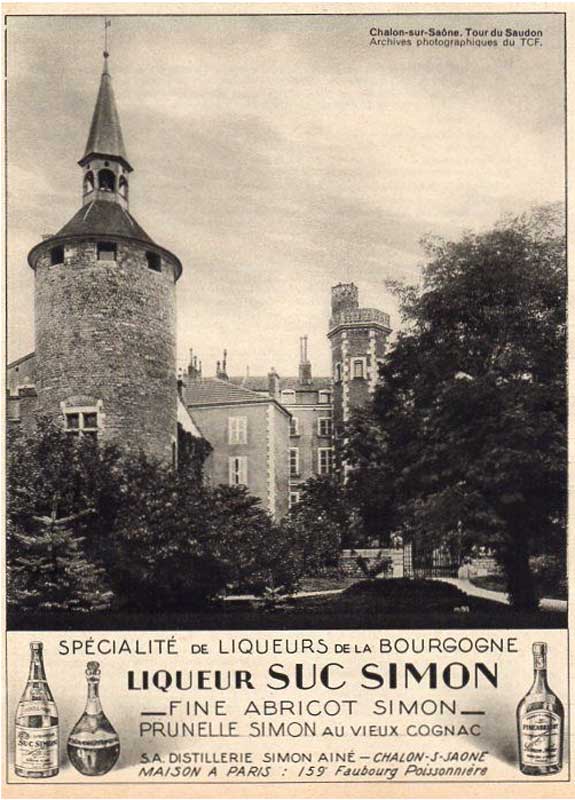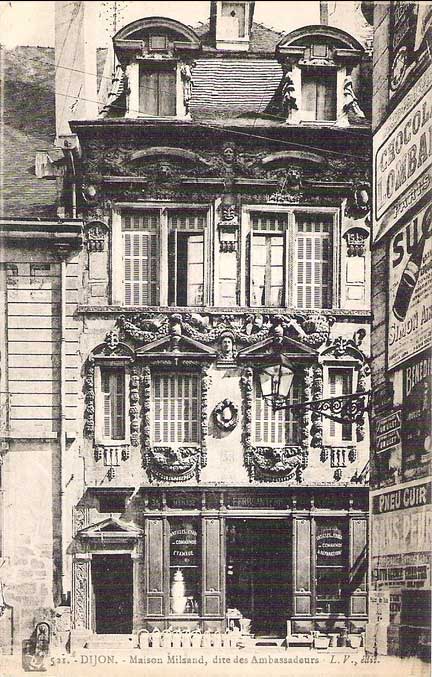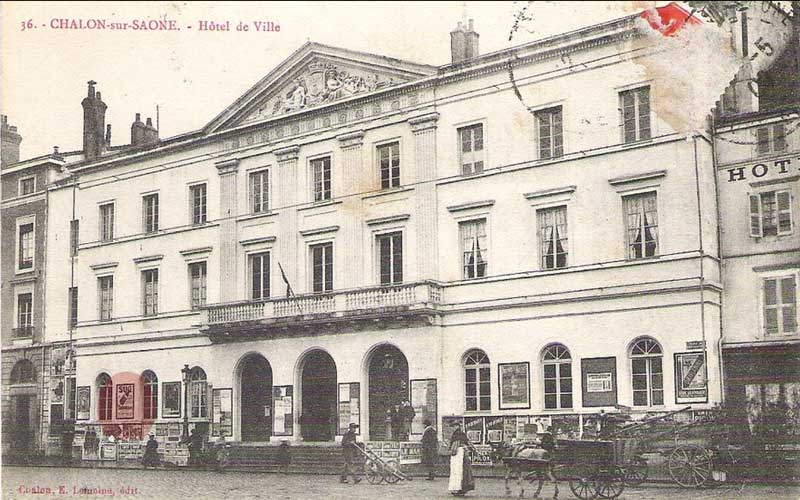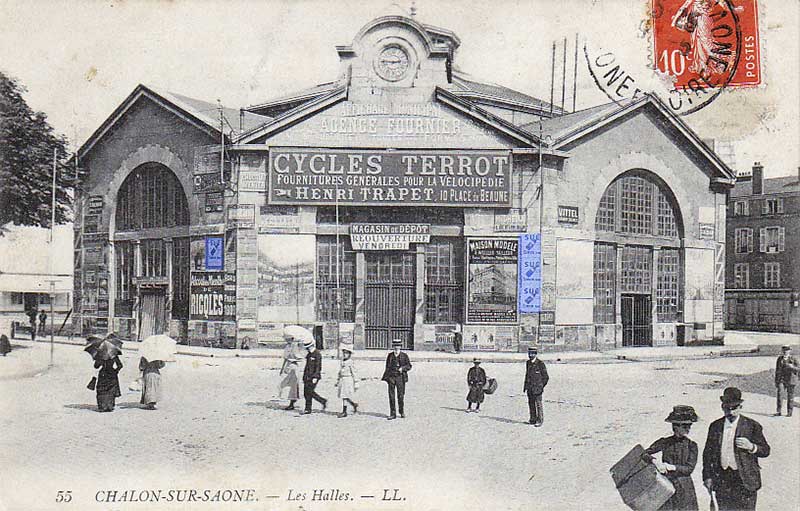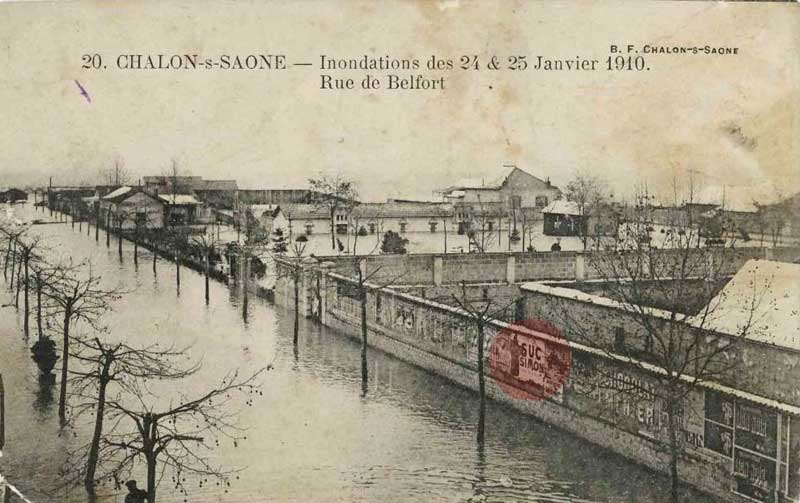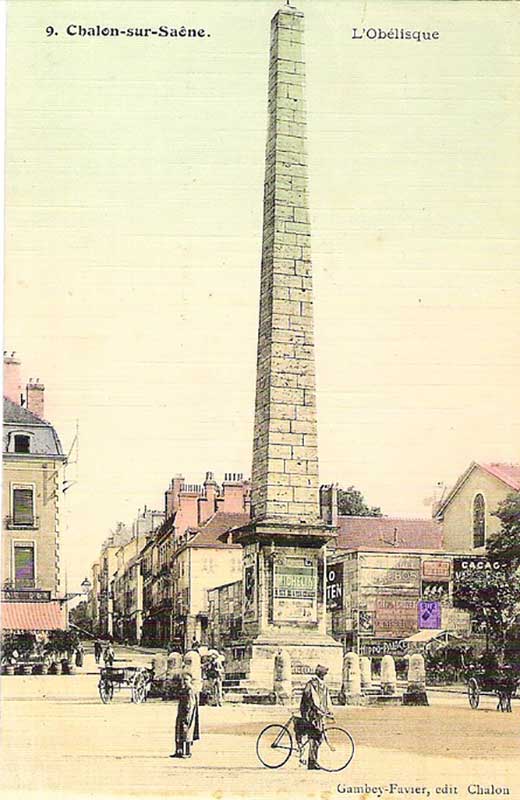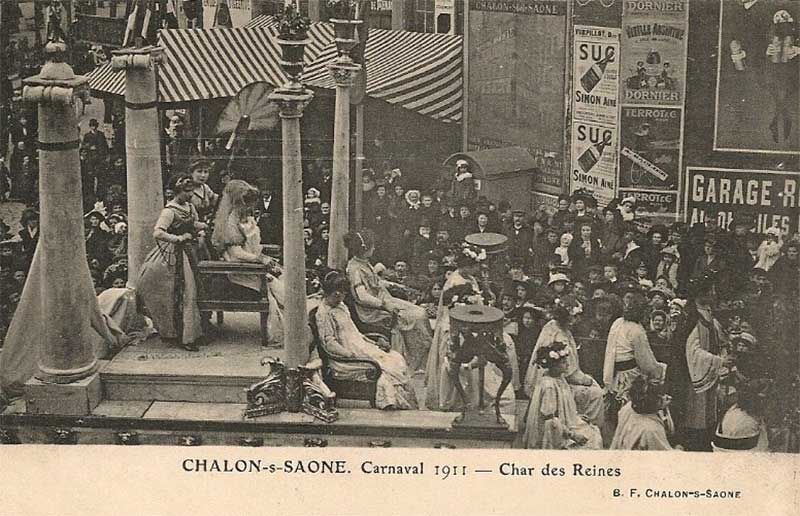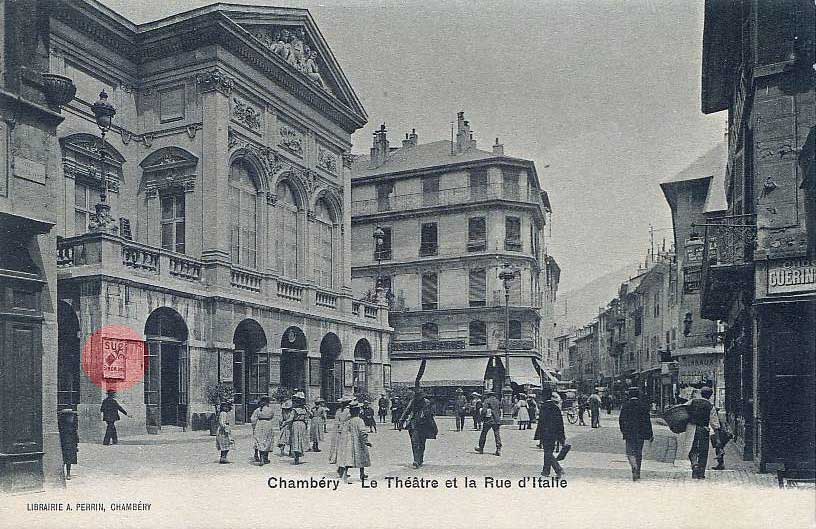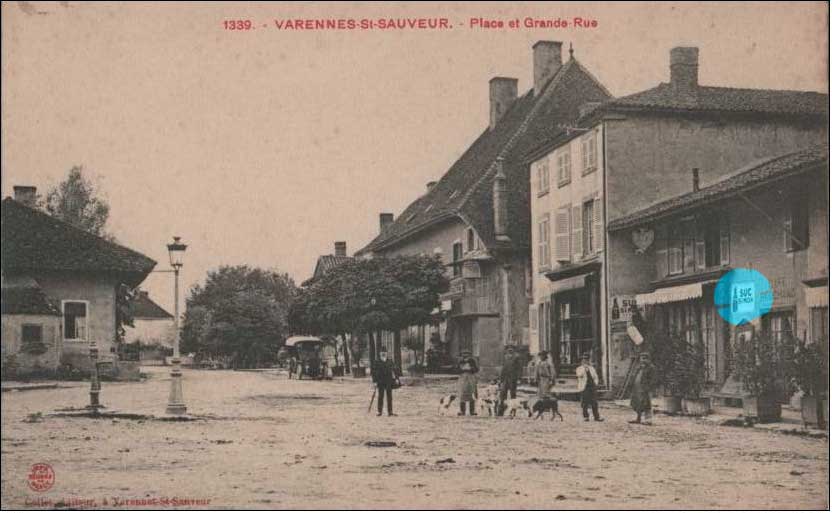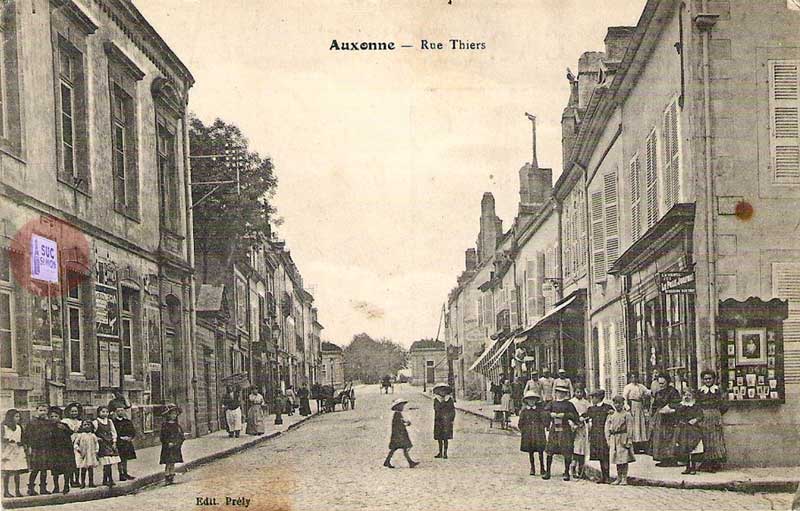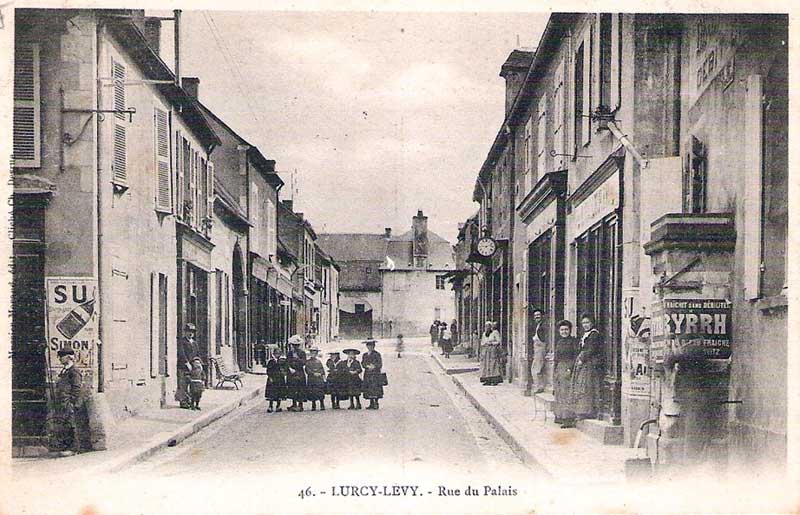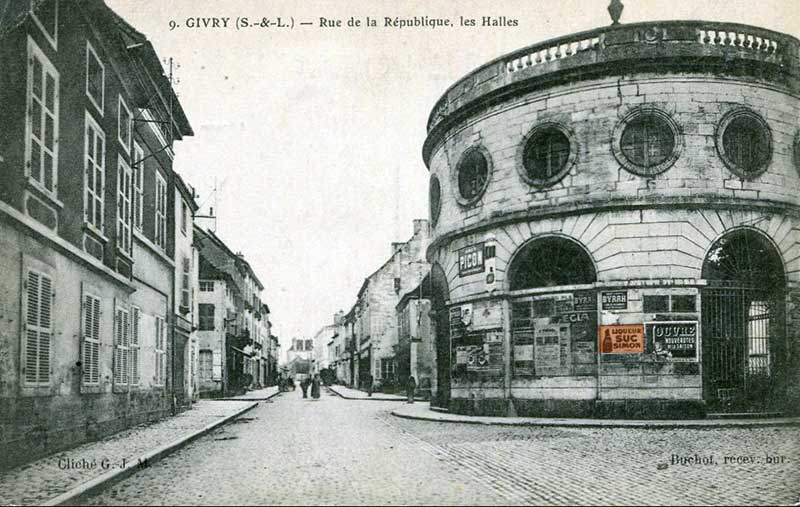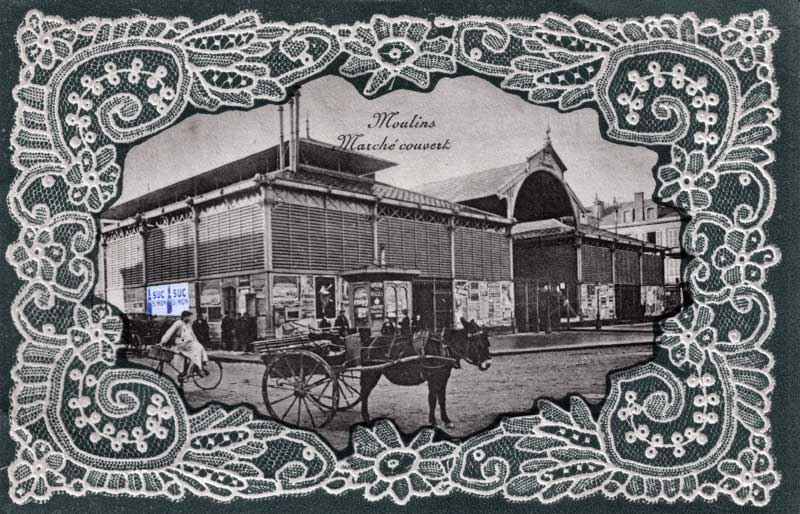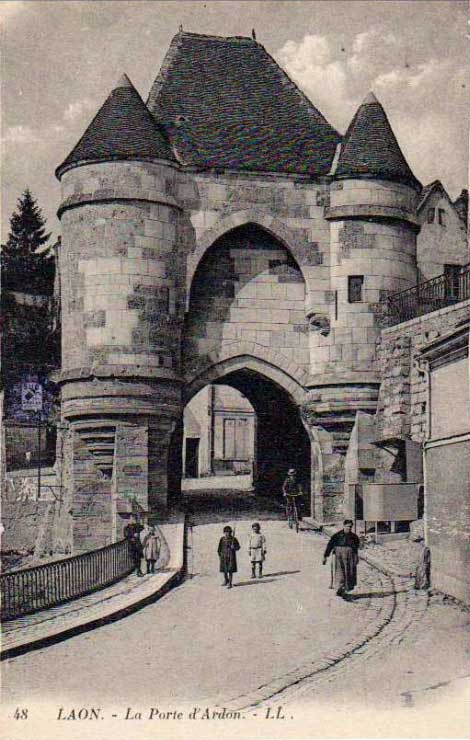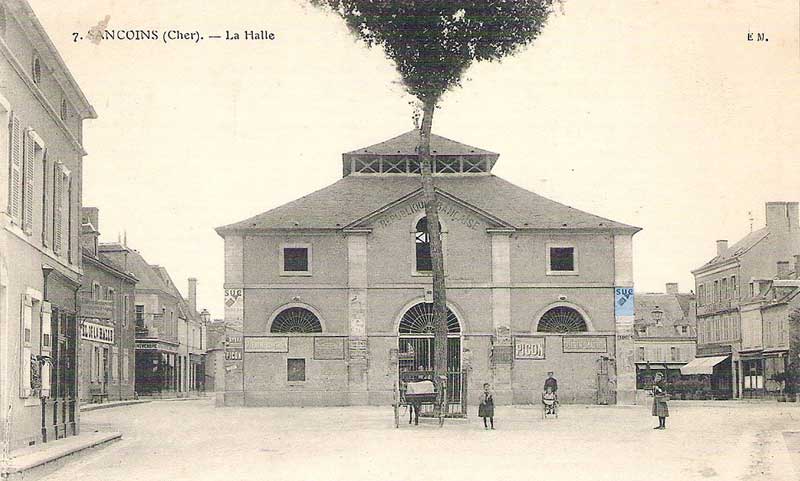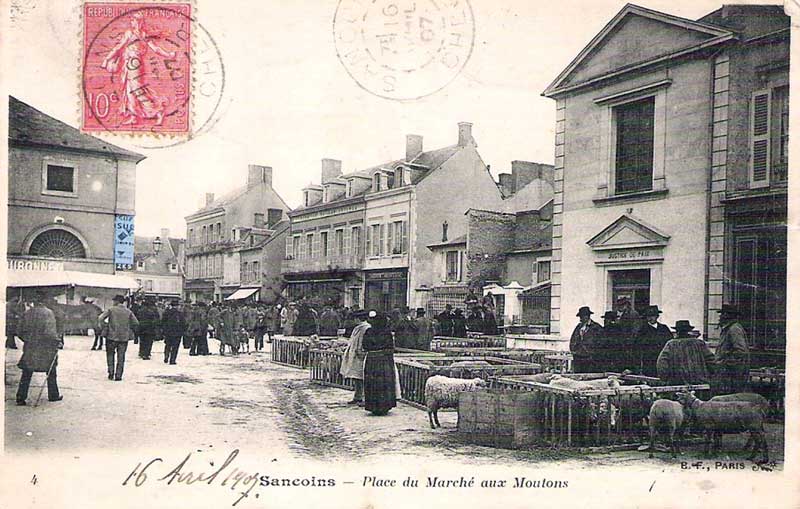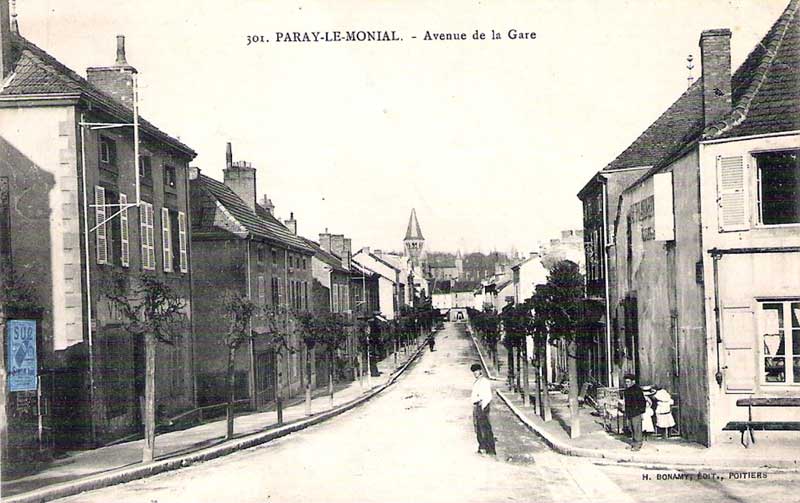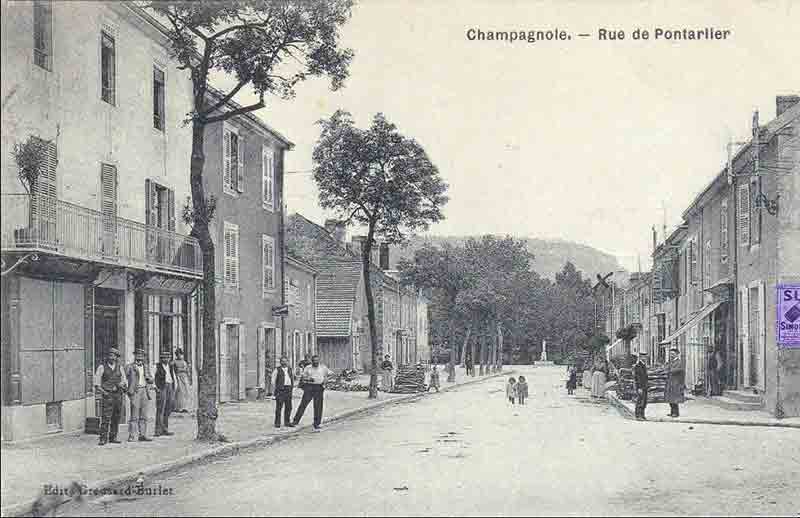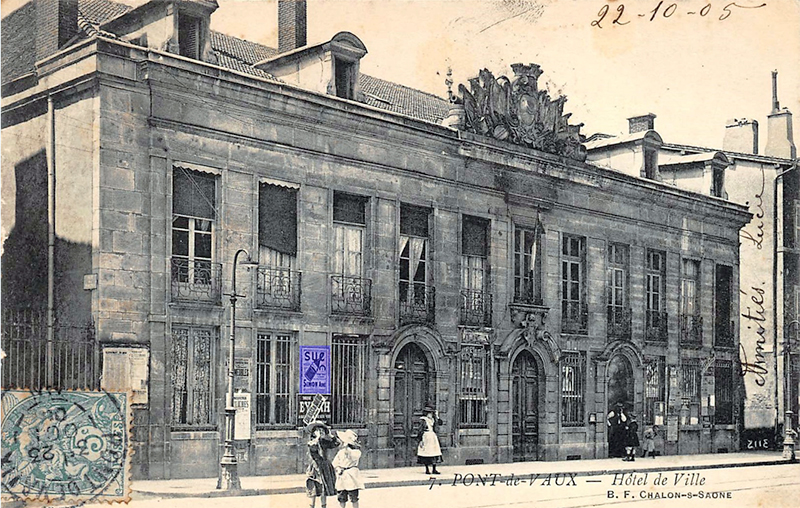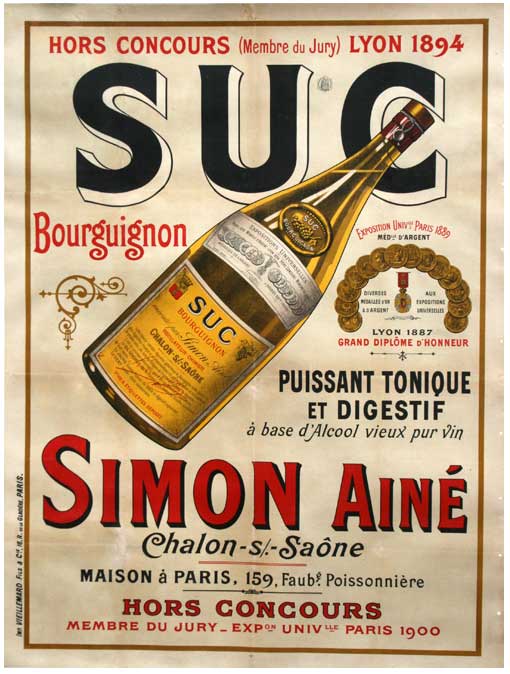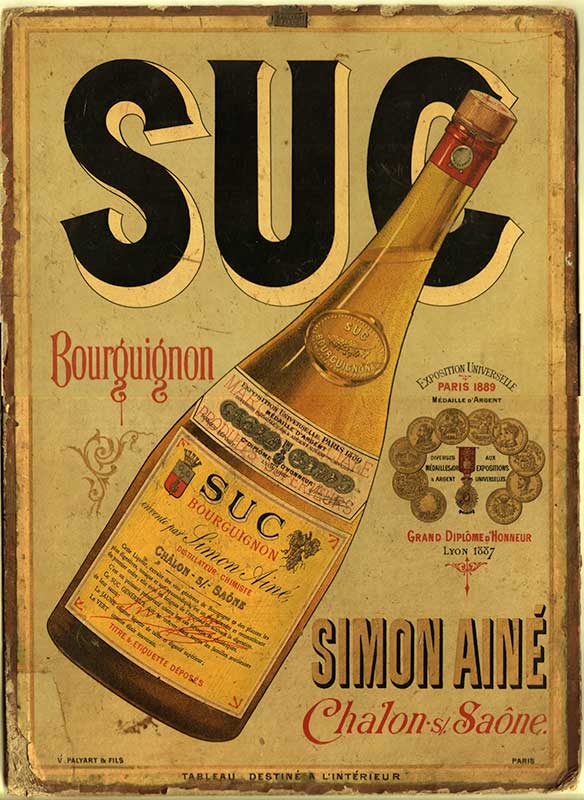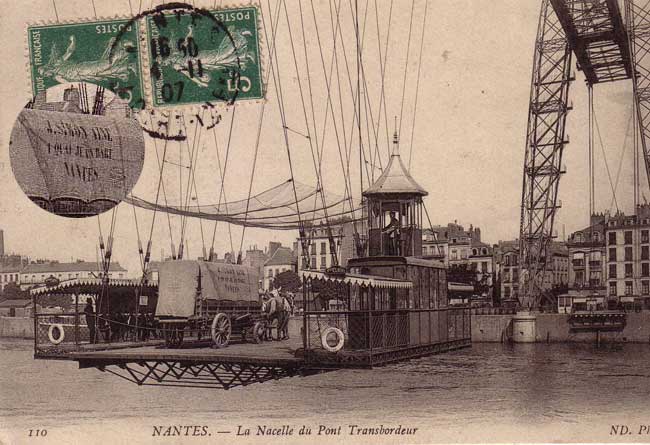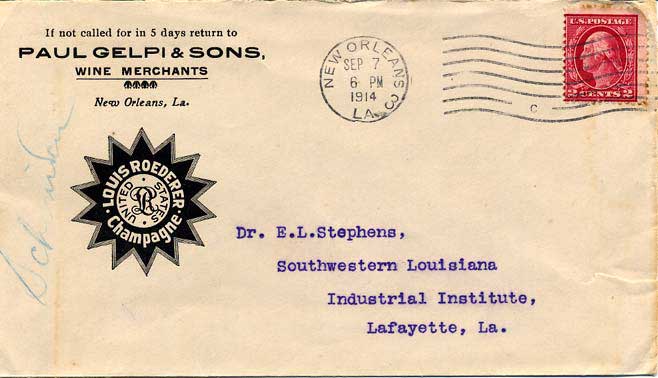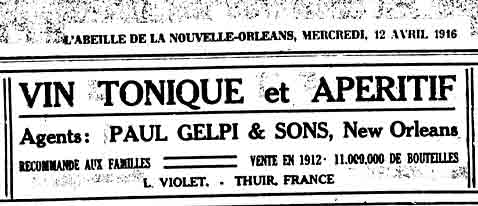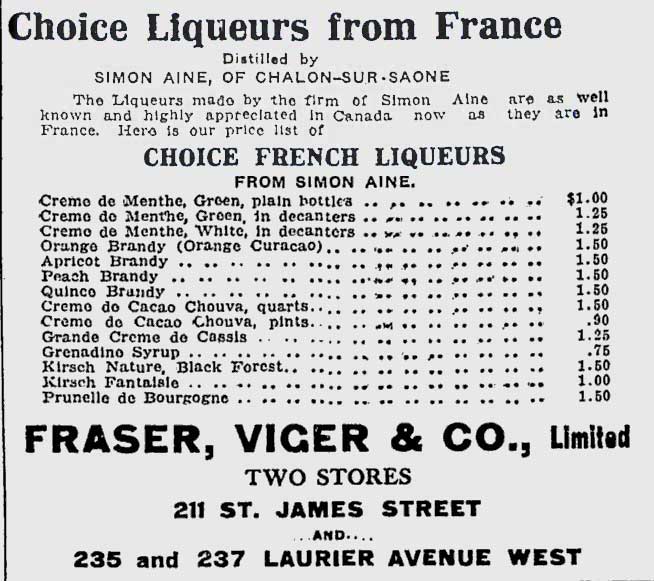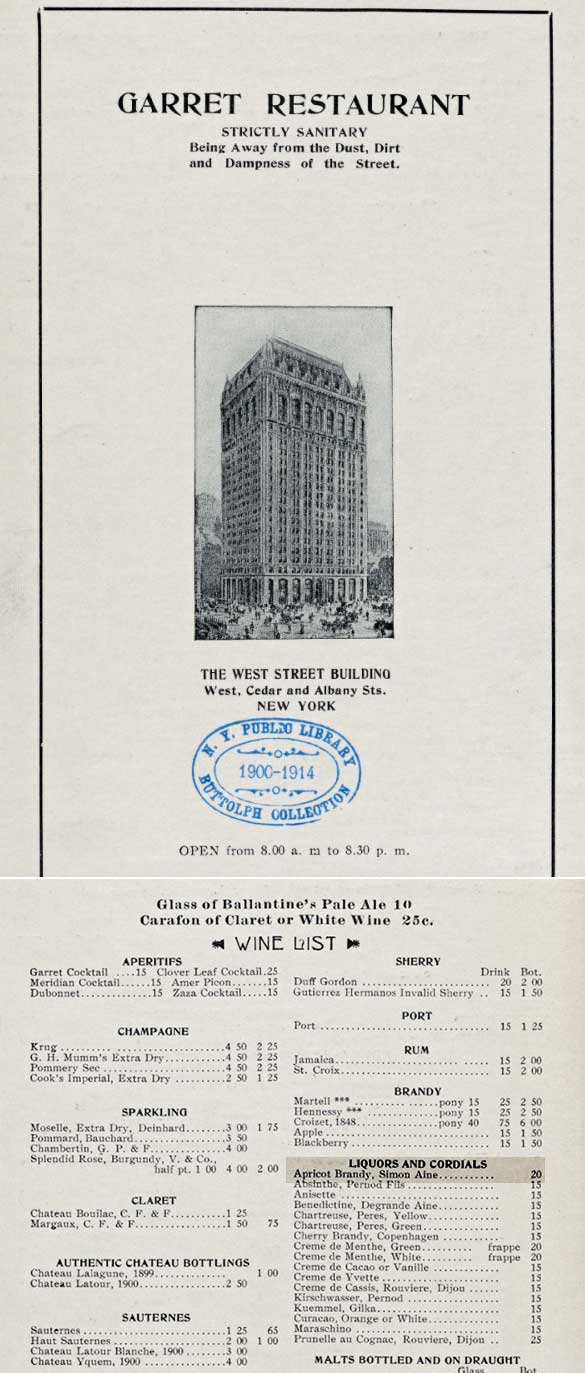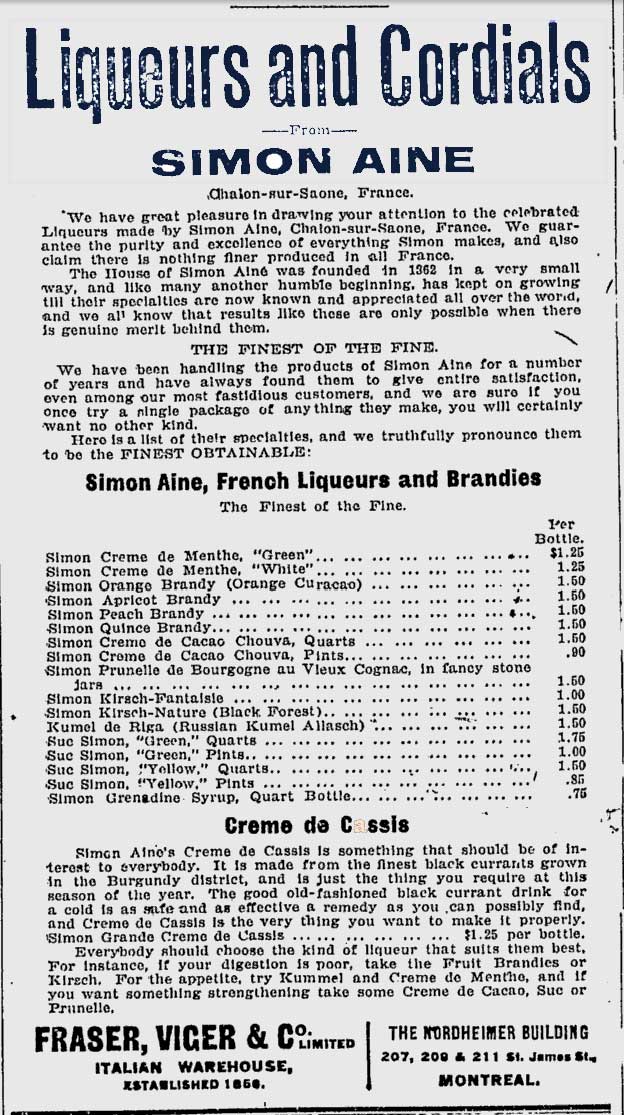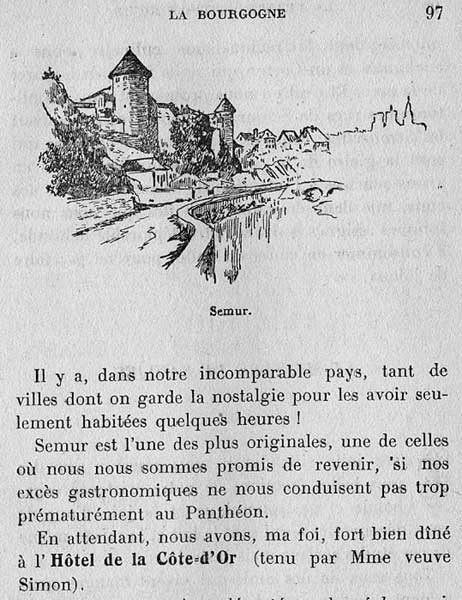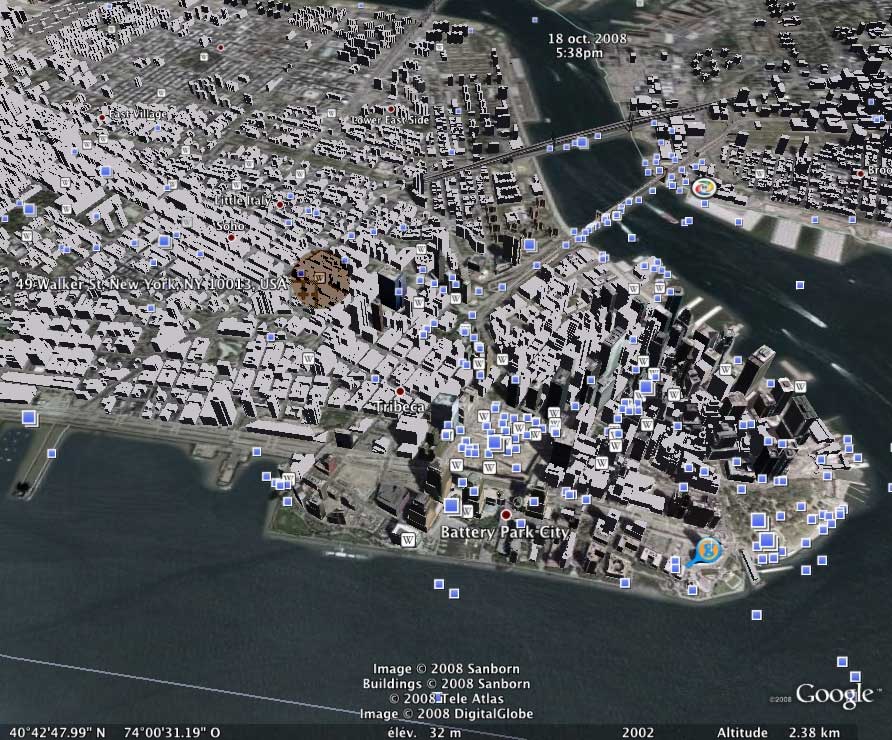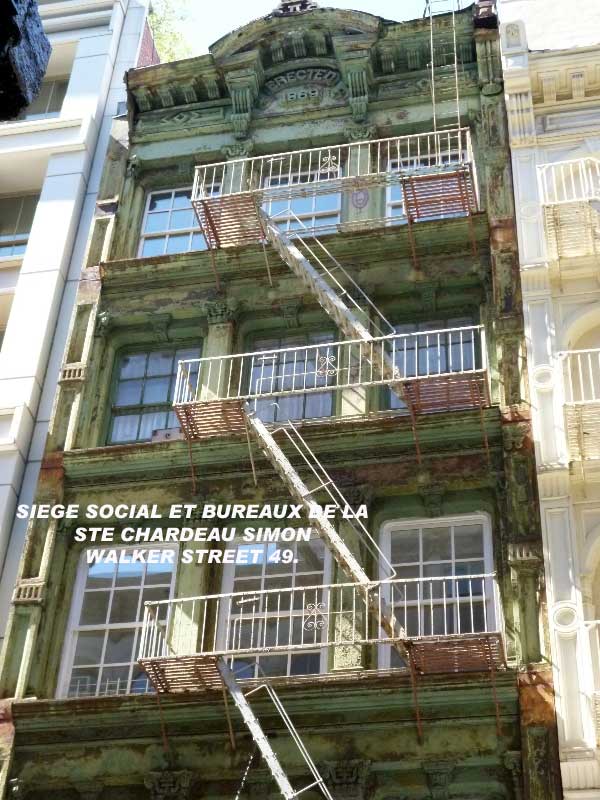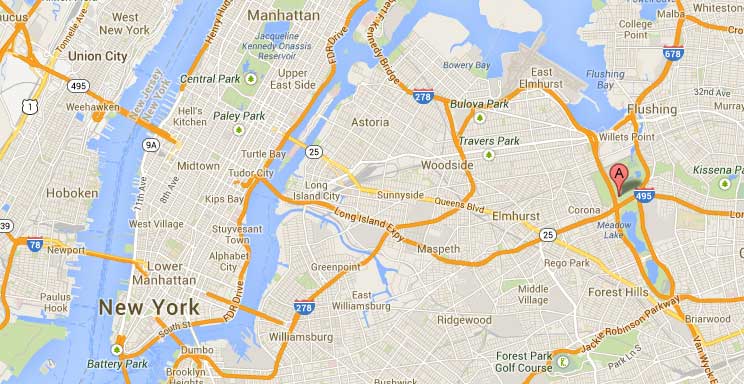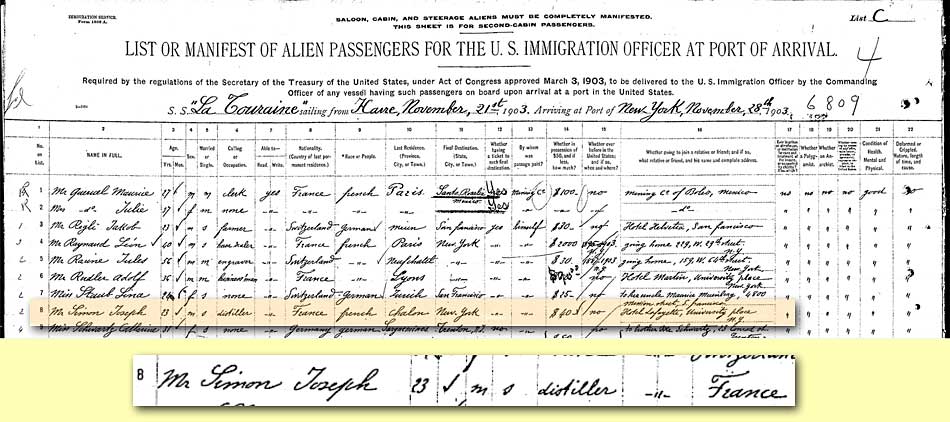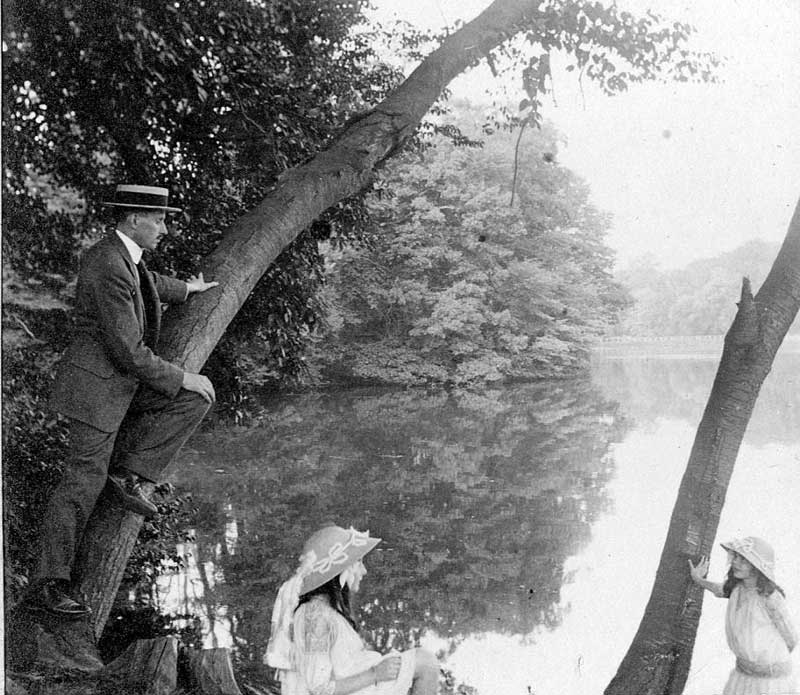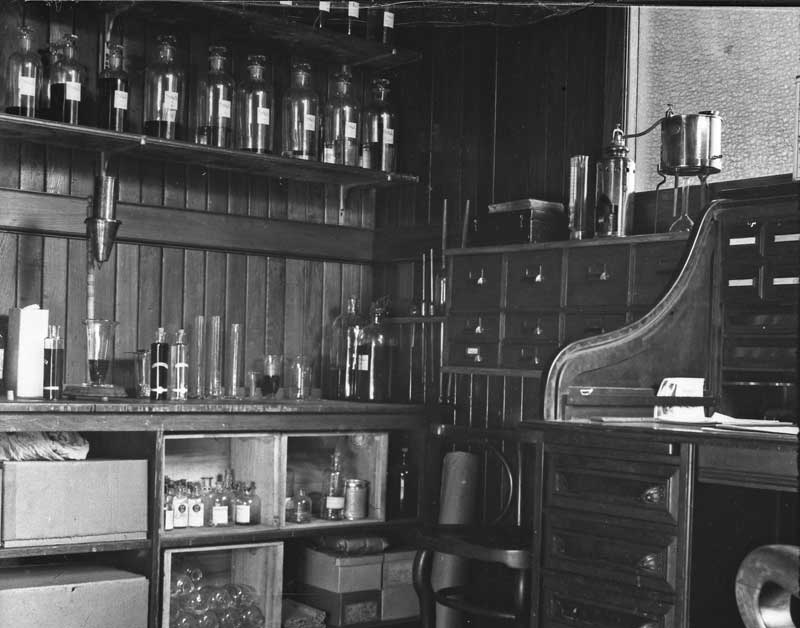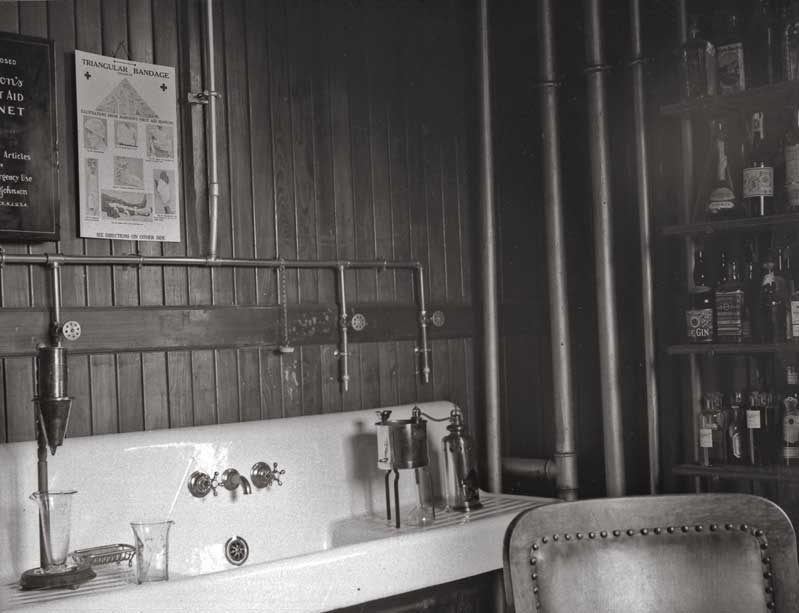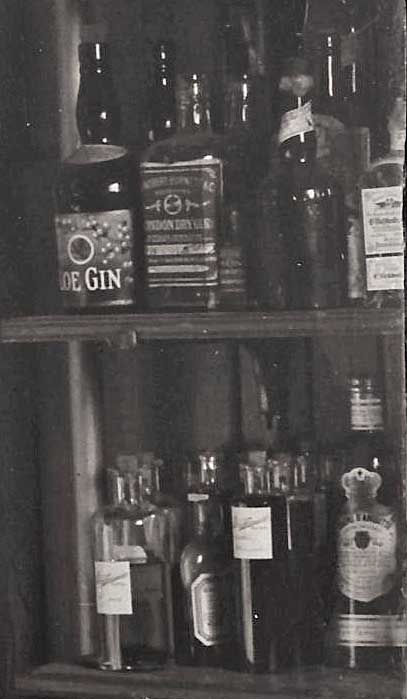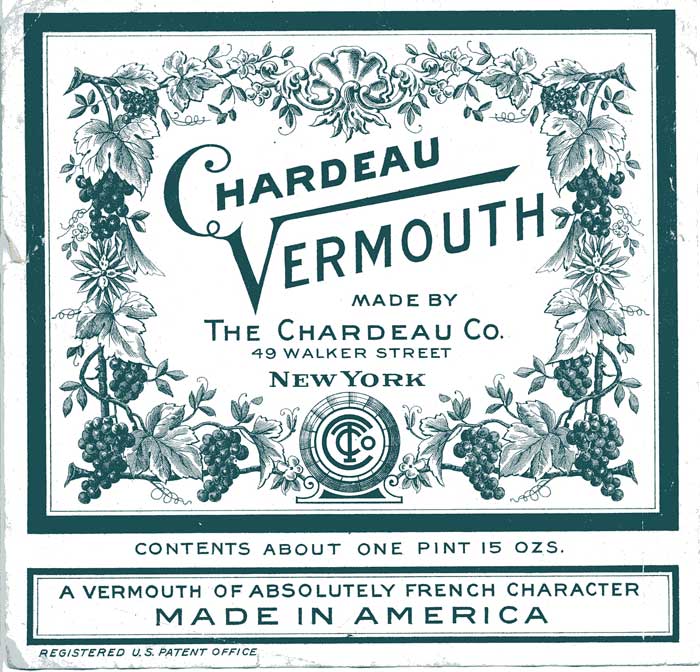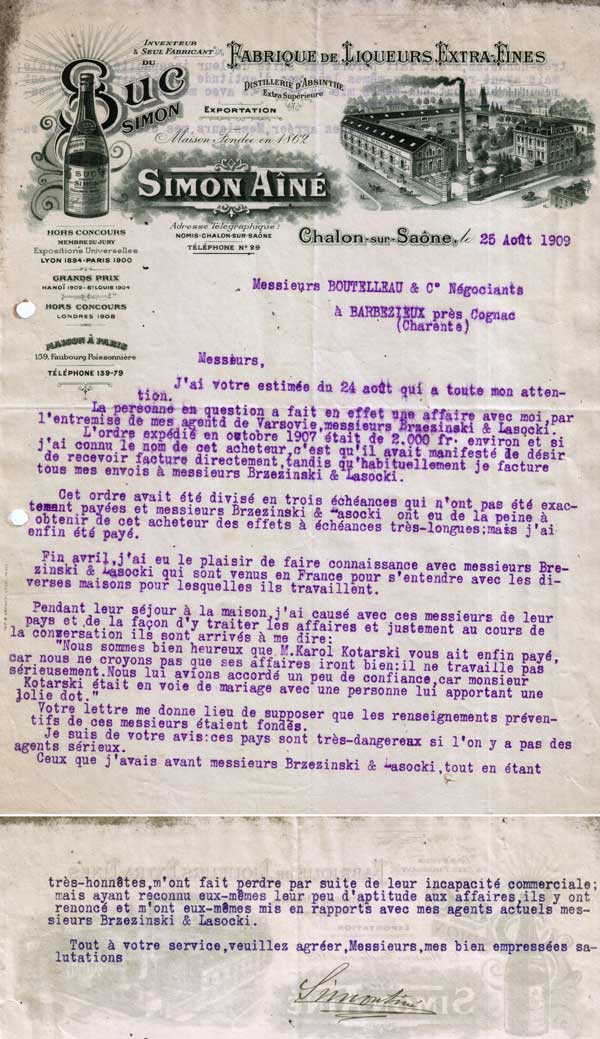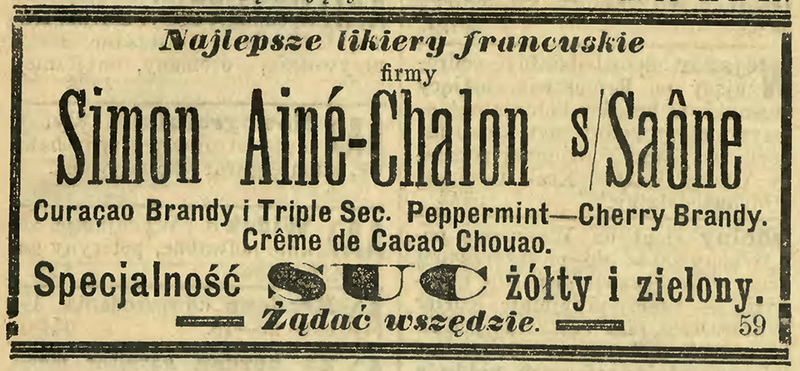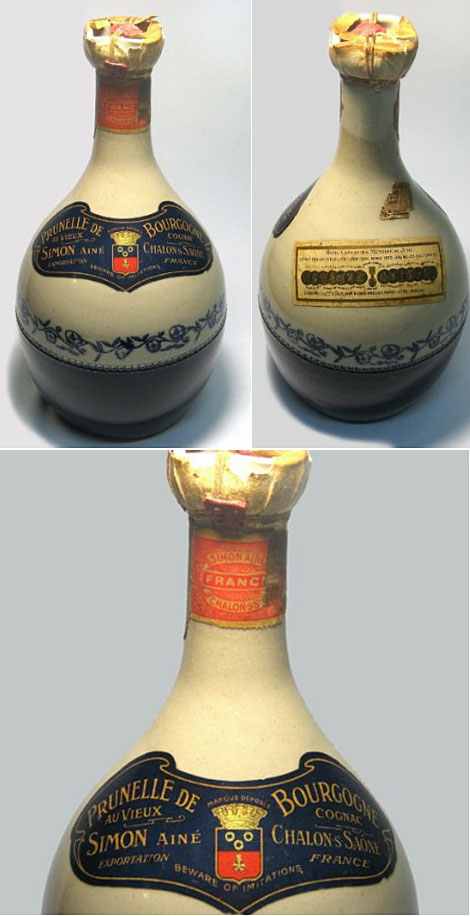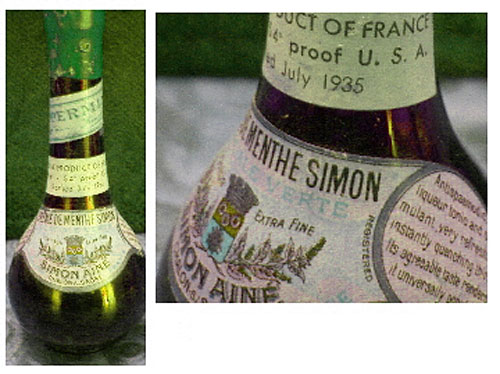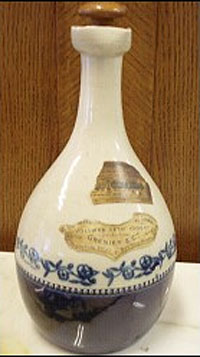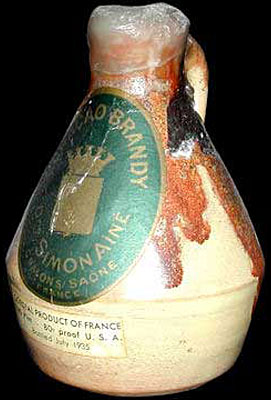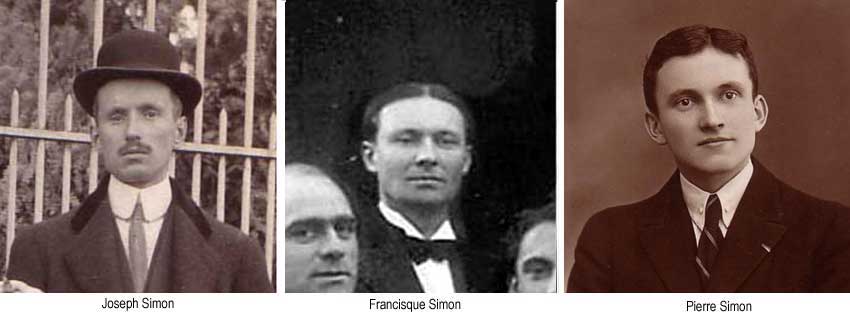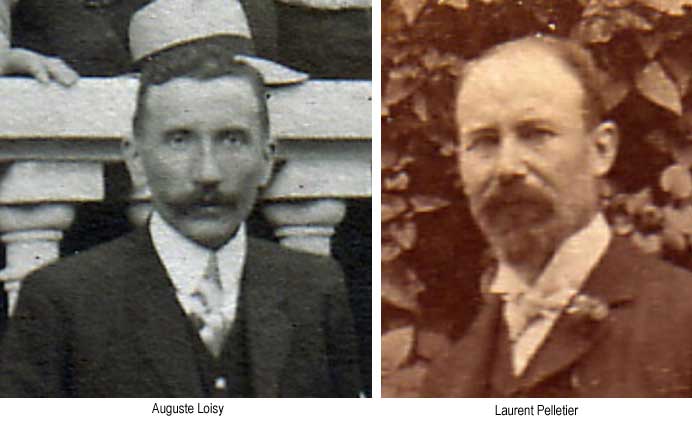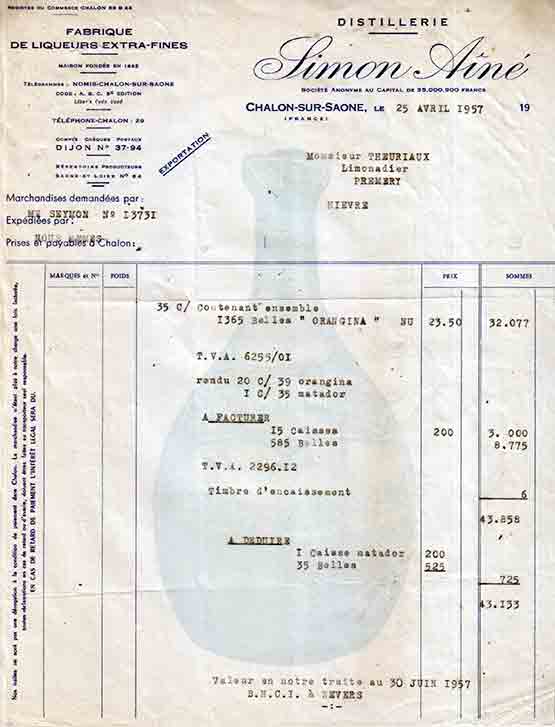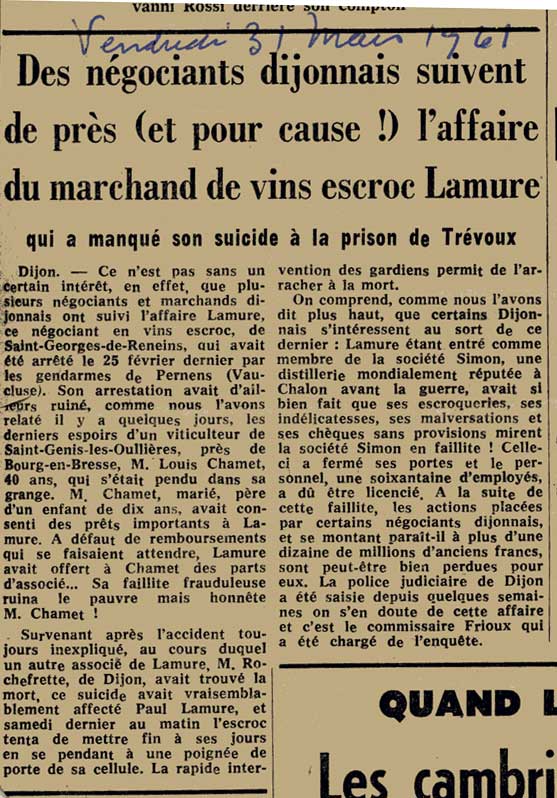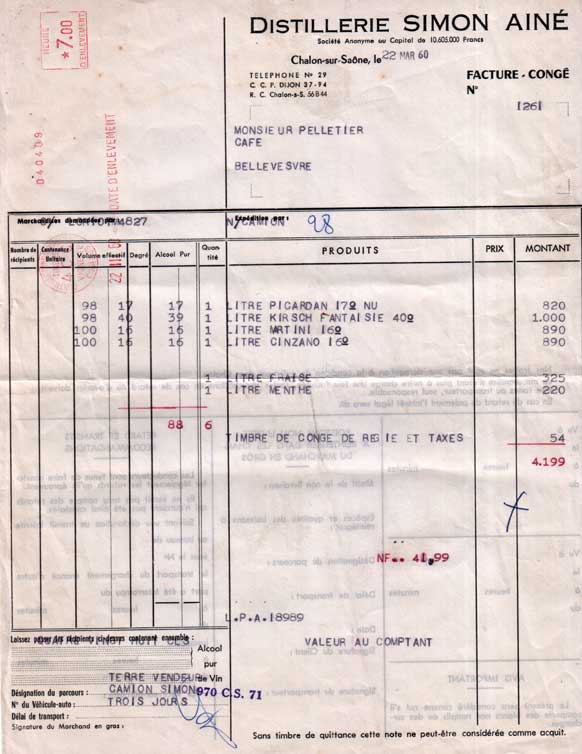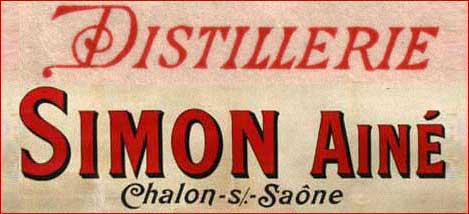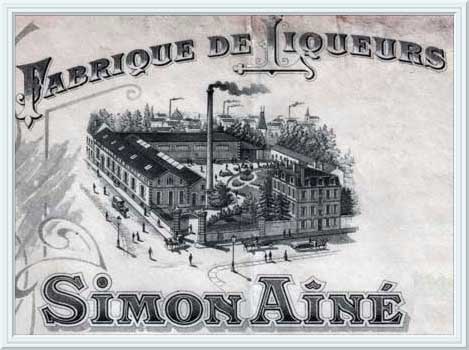 1862 - 1959
1862 - 1959
mis à jour le 1er février 2025
TABLE DES MATIÈRES
Lorsque je repense à la distillerie SIMON-AÎNÉ,
c'est tout un pan de mon enfance qui me revient. J'y ai en effet
passé pratiquement toutes mes vacances, chaque été, auprès de
mes grands-parents maternels et je peux encore sentir l'odeur
pénétrante du cassis ou des oranges macérées qui embaumait tout
le jardin autour des bâtiments.
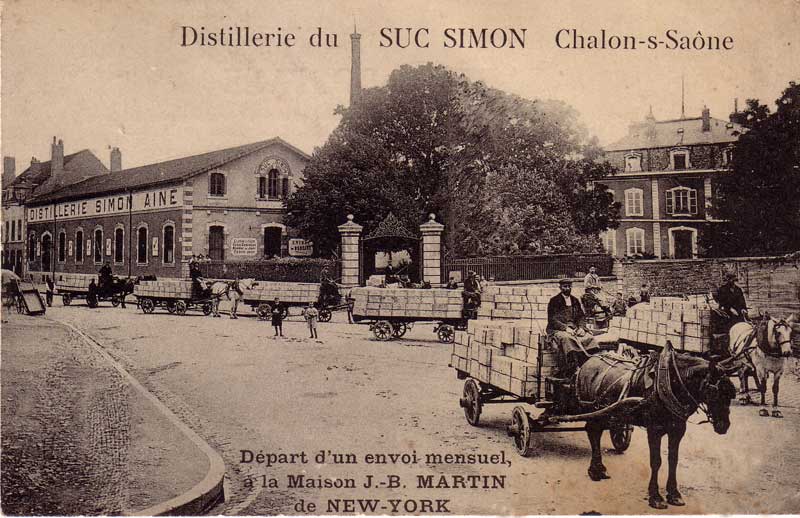
la distillerie
au début du XXè siècle, avec la maison sur la droite

c'est moi, sur les genoux de grand'mère, en 1944

HISTOIRE
Selon Claude Elly, ancien journaliste au
"Courrier de Saône et Loire" avec qui j'ai pris contact, mais qui
n'a pu m'éclairer (19 spécialités bourguignonnes du temps
passé - parution du 6 septembre 1977) la distillerie
SIMON-AÎNÉ aurait été fondée en 1862 (ou du moins elle
commercialisait une liqueur de prunelle en cruchon, depuis 1862).
À cette date mon arrière-grand-père Jean-François SIMON, dit
"Simon Aîné", qui semble bien en être le fondateur n'avait que 16
ans.
C'était le fils de Géraud-Étienne Simon,
instituteur, puis propriétaire terrien à Luzinay (commune proche
de Vienne - Isère) mais qui était originaire de Serpaize
(Isère).
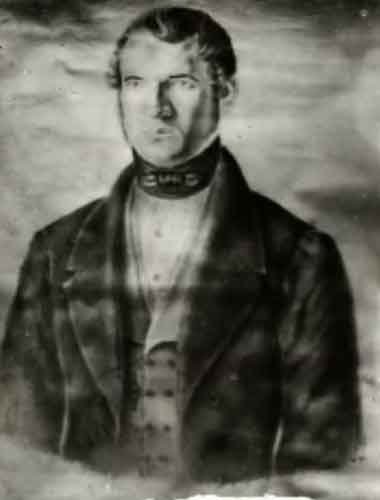
Portrait de Géraud-Étienne Simon
L'origine de la famille Simon est toutefois dans
l'est du département de la Creuse (Mérinchal et Saint-Bard. Vous
pouvez jeter un il sur la page qui lui est consacrée). Jean-François
SIMON avait épousé en premières noces Joséphine Benoît, de
Pont-de-Vaux (Ain) dont il avait eu 8 enfants et qui est décédée à
l'âge de 30 ans, puis en secondes noces la cousine germaine de sa
première épouse, Louise-Sophie Benoît qui lui a donné 4 autres
enfants: la descendance était bien assurée!
Selon des souvenirs conservés dans la famille
(mais qui sont très discutables), Jean-François SIMON aurait
quitté très jeune la maison familiale, car il s'entendait mal avec
son père. Il aurait alors trouvé du travail dans une distillerie
où il a appris le métier et fini par prendre une telle influence
sur son patron qu'il a pu en obtenir la communication de ses
secrets de fabrication et créer sa propre entreprise (à seulement
16 ans!).

Jean-François SImon à 40 ans
Peut-être est-ce la raison pour laquelle,
instruite par l'expérience, la famille SIMON telle que je l'ai
connue dans mon enfance, ne buvait que de l'eau, sauf à déboucher
une bonne bouteille dans les très grandes occasions (comme
ci-dessous, en 1903).

Car la cave du grand-père était fabuleuse et,
paraît-il, une des plus belles de Bourgogne... J'ai entendu
raconter à ce propos une anecdote: lorsque Étienne Simon, mon
grand-père, a fait son service militaire, il a été appelé lors de
son incorporation par son colonel qui lui aurait dit: "vous êtes bien le fils de Simon
Aîné, distillateur à Chalon? alors vous devez vous y connaître
en vins de Bourgogne". Mon grand père, très intimidé et
ne sachant trop que répondre, son colonel lui proposa de visiter
sa cave personnelle, dont il était très fier, et lui donner son
avis. Étienne Simon, après avoir vu la cave aurait donné à son
supérieur quelques conseils si judicieux qu'il fit tout son
service militaire comme sommelier personnel du colonel!
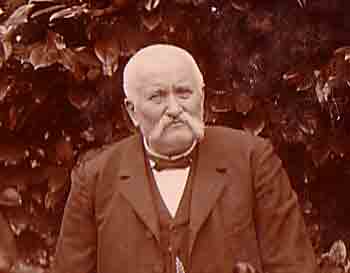
Jean-François Simon
Je sais donc bien peu de choses sur lui et encore
moins sur les conditions dans lesquelles il a été amené à devenir
distillateur. Il ne semble n'avoir aucun lien de parenté avec ce
SIMON-AÎNÉ qui exploitait déjà en 1833, en association avec
Auguste JULLIEN, une distillerie d'absinthe à Pontarlier dans les
locaux de l'ancien couvent des Bernardines, sous l'appellation
"Fabrique d'Absynthe du Roi".
J'ai recherché quelle était la distillerie où il
avait fait son apprentissage. Il a vécu à Pont-de-Vaux, dans
l'Ain, au moins à partir de 1871, date de son mariage avec
Joséphine Benoît (l'acte de mariage dit déjà qu'il est
distillateur). Au recensement de 1876, il habitait 15 Grand-Rue et
c'est là que sont nés ses 4 premiers enfants.
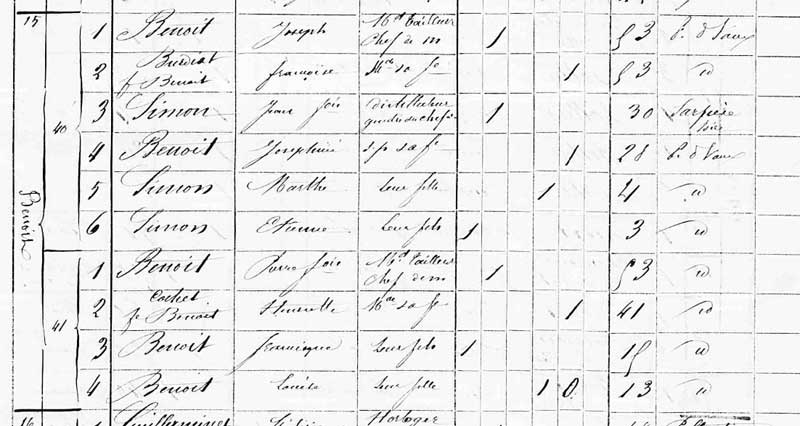 Recensement de 1876. Au même
numéro de rue habitent Jean-François Simon, son épouse et ses
deux premiers enfants
Recensement de 1876. Au même
numéro de rue habitent Jean-François Simon, son épouse et ses
deux premiers enfants
mais également la famille de ses beaux-parents et futurs
beaux-parents (il épousera successivement deux cousines
germaines)
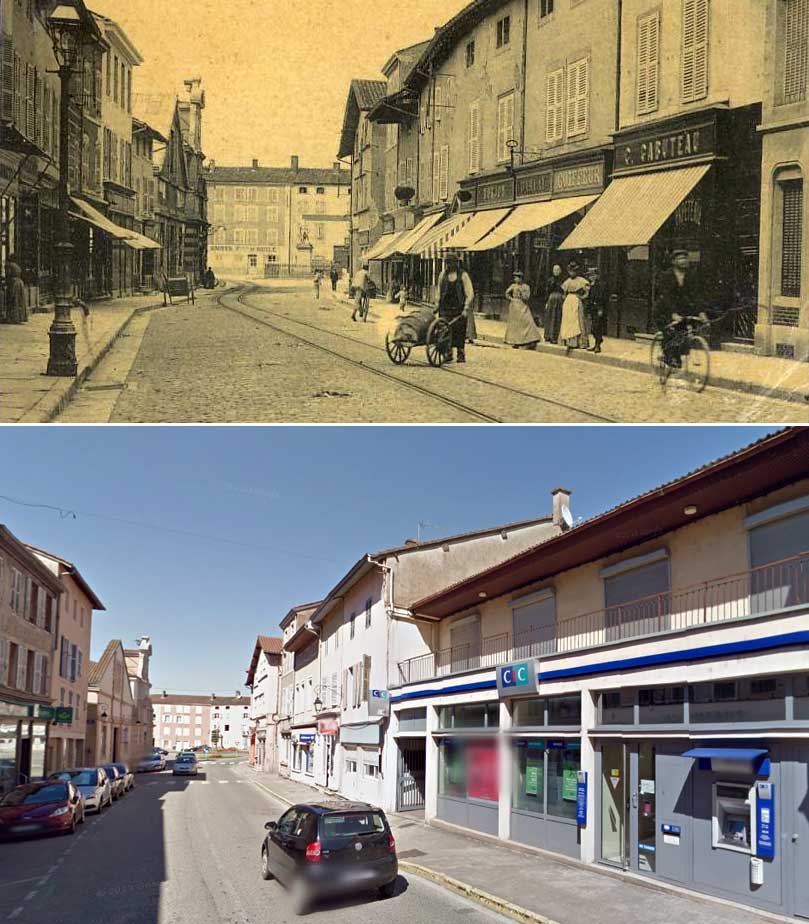
vues ancienne et actuelle
(Google) du 15 Grand-Rue (maintenant rue Maréchal de Lattre de
Tassigny) à Pont-de-Vaux
la maison habitée par Jean-François Simon et sa famille a
disparu. Elle a été remplacée par un bâtiment plus bas occupé
par une banque
sur la carte postale, cela correspond au serrurier, dont on voit
la clef en enseigne, au coiffeur et au magasin Cabuteau
Tout
porte donc à penser que la distillerie se trouvait également à
Pont-de-Vaux, et probablement au 15 Grand-Rue (lorsque la
distillerie déménagera à Chalon-sur-Saône elle se trouvera
également, pendant plusieurs années, au domicile de Jean-François
Simon). Je n'ai trouvé trace dans cette ville, à cette époque, que
de trois distilleries (mais il peut y en avoir eu d'autres):
1° - la distillerie
Garnier et fils, qui ne semble guère avoir laissé de souvenirs
mais dont l'existence (dont je n'ai trouvé nulle autre trace)
semble attestée par ce pyrogène, en vente sur internet, qui évoque
irrésistiblement ceux distribués en grand nombre par la
distillerie Simon-Aîné par la suite (il existe en France au moins
deux autres distilleries Garnier, mais elles ne sont pas à
Pont-de-Vaux; il; s'agit peut-être d'une erreur de titrage)
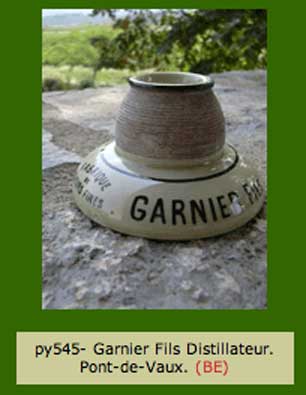
2° - la distillerie
Henri Martin, dite "Distillerie Bressane", plus connue et attestée
par cette carte postale, ce tapis de jeux et cette publicité de
1912, dont la production évoque celle de la distillerie
Simon-Aîné: une spécialité de liqueur de prunelle, une liqueur
digestive (la dorée) évoquant le Suc Simon, du marc, du curaçao,
des crèmes diverses et des vins de Bourgogne. Mais tout cela est
bien classique, au demeurant et ne peut servir de preuve ni même
d'indice. Ceci d'autant plus que je viens de trouver l'en-tête
d'un courrier de cette distillerie, qui indique qu'elle a été
fondée en 1866; quatre ans, par conséquent, après
la distillerie Simon-Aîné.
Je ne puis m'emêcher
de penser que le jeune Jean-François SIMON, après un bref
apprentissage (un ou deux ans tout au plus) dans une distillerie
de Pont-de-Vaux où il aurait gagné l'estime du patron, appris le
métier et retenu les recettes de fabrication, s'est rapidement mis
à son compte à 16 ans, probablement après la fermeture de cette
distillerie ou sa reprise par la société Muraz. Henri MARTIN
(peut-être employé de cette même distillerie, aurait profité de ce
créneau pour s'installer lui aussi à son compte peu après). Bien
sûr, ce n'est que la version "romancée" des faits.

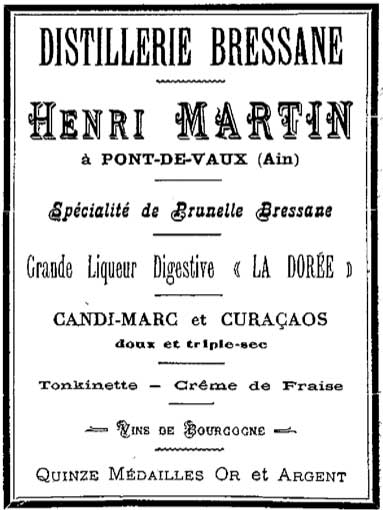


3° - La distillerie Pain-Fils, dont j'ai
longtemps ignoré à quand elle remontait, qui semble être surtout
un marchand de vins et liqueurs en gros, assortie d'une petite
distillerie. Il s'agit d'un établissement certainement plus ancien
que les distilleries Bressane et Simon-Aîné, comme l'indique une
médaille à l'effigie de Napoléon III et une autre à celle de la
reine Victoria jeune. Cette étiquette, qui daterait du milieu du
XIXè siècle selon un collectionneur spécialisé, prouverait
également l'ancienneté de la distillerie Pain-Fils.
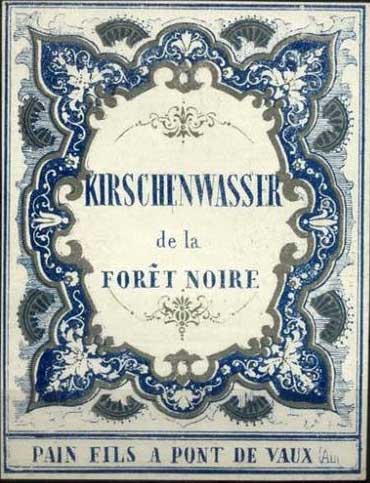

Un pyrogène Pain-Fils
Une facture de la distillerie Muraz Frères et
Cie, qui affiche "anciennement Maison Pain-Fils fondée en 1860"
nous donne la réponse. Mais Jean-François SIMON ayant fondé sa
propre distillerie en 1862, est-ce bien là qu'il a fait son
apprentissage? La question reste donc posée;
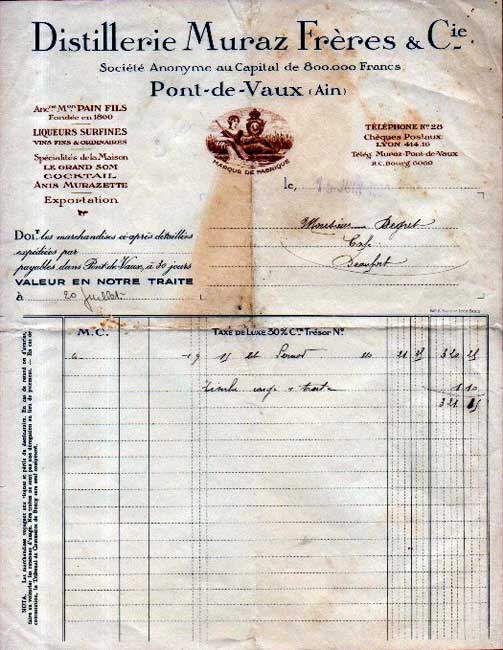
Chez Pain-Fils aussi on trouve une spécialité
dite "le Grand Som" (du nom d'un sommet de la Grande-Chartreuse)
déclinée en trois versions: verte, jaune et blanche. Comme quoi
l'idée était dans l'air. Et on y fabriquait également de
l'absinthe. C'était jusqu'à présent cette distillerie Pain-Fils
qui me paraissait être la candidate la plus sérieuse comme endroit
où Jean-François Simon a fait son apprentissage, mais depuis que
j'ai trouvé qu'elle a été fondée seulement deux ans avant la
distillerie Simon-Aîné, j'ai quelques doutes. La recherche reste
donc ouverte.
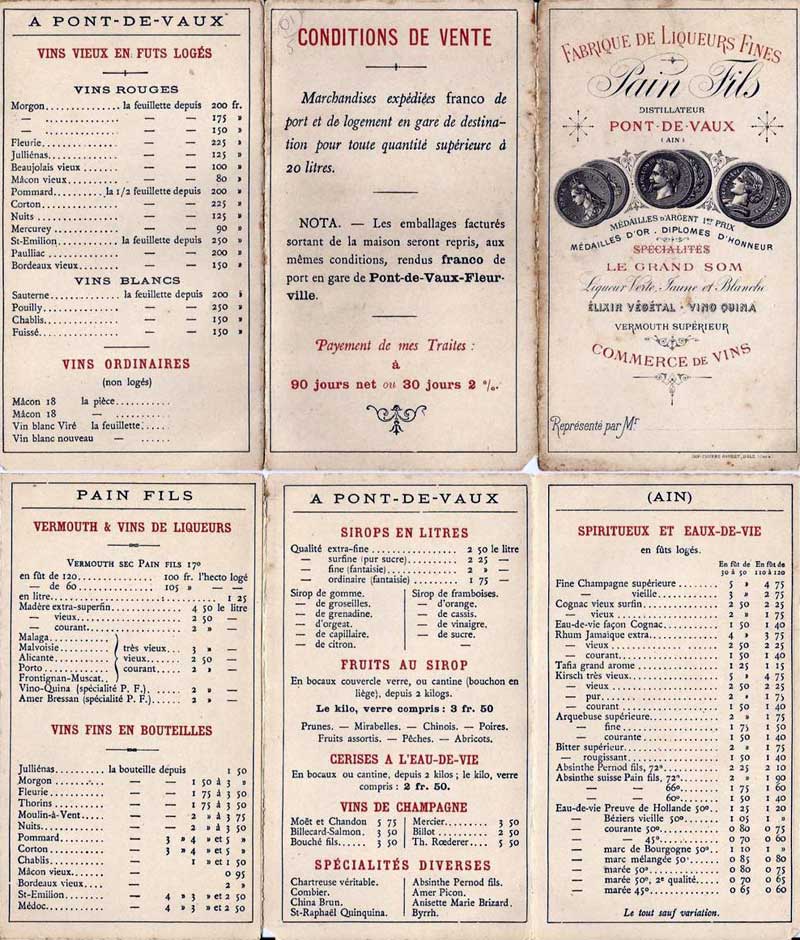
Toujours est-il qu'en 1879 (17 ans par conséquent
après la création de sa distillerie) Jean-François Simon est allé
vivre à Chalon-sur-Saône, rue des Carmélites (non loin de la rue
de la Motte, où ont été édifiés ensuite les bâtiments que j'ai
connus dans mon enfance) où est née sa fille Jeanne, puis rue des
Lancharres où sont nés Joseph, Joséphine et Francisque. Les deux
filles qui suivent: Marie et Marguerite sont nées à Pont-de-Vaux
mais leur acte de naissance dit que leur père, distillateur,
réside à Chalon-sur-Saône, rue de Lyon. Et c'est rue de Lyon où
naissent ses deux derniers enfants: Pierre et Gabrielle.
La distillerie Simon-Aîné de Chalon-sur-Saône
apparaît donc comme la continuation d'une distillerie plus
ancienne dont tous les papiers commerciaux indiquent une fondation
en 1862. Cette distillerie est présentée au début comme étant
essentiellement fabricant d'absinthe.Voir ci-après une facture
signée F. Simon Aîné, du 19 novembre 1892 où il se plaint d'un
envoi de deux balles de fenouil - utilisé dans la fabrication de
l'absinthe - qui se serait avérées être de mauvaise qualité). J'ai
moi-même eu l'occasion de déguster une bouteille d'absinthe
Simon-Aîné trouvée dans le fond de la cave de mon grand-père, dans
les règles, avec la cuillère spéciale dite "feuille ou pelle
d'absinthe" et le morceau de sucre posé dessus. Pour la petite
histoire, le sucre en morceaux a été inventé en 1843 par Jacob
Christoph Rad (jusque là on cassait des pains de sucre) et il est
encore loin d'être adopté par tous les pays du monde, qui lui
préfèrent généralement le sucre en poudre.

une "feuille d'absinthe" qui, à
Chalon, a probablement servi à la dégustation de produits
Simon-Aîné
Une facture plus ancienne, de 1884 mentionne "Distillerie d'Absinthe Suisse":
un terme générique, l'absinthe étant sans conteste une invention suisse.
Une très ancienne publicité de la maison SIMON
AÎNÉ (1882 d'après son vendeur sur eBay) que j'ai acquise, donne
comme adresse pour la distillerie 5, rue des Lancharres et 9, rue
de Lyon (là où sont nés 3 des enfants de Jean-François). Il est
donc probable qu'elle se trouvait à l'angle de ces deux rues,
avant la construction de l'usine et de la maison que j'ai connues.
Il est amusant de noter qu'elle propose un "extrait d'absinthe
suisse perfectionnée"


de la même époque une publicité
de la maison Bonnaud, de Nantes, reprend les mêmes produits,
mais sous une présentation légèrement différente (la marjolaine
est en bouteille et non en cruchon)
Nous retrouvons encore ces produits sur
une publicité un peu plus ancienne de 1890 qui, toutefois, ne
donne pas l'adresse de la distillerie à Chalon-sur-Saône. Elle a,
par contre, déjà à Paris un agent Faubourg Poissonnière et un
dépositaire, rue de Richelieu.
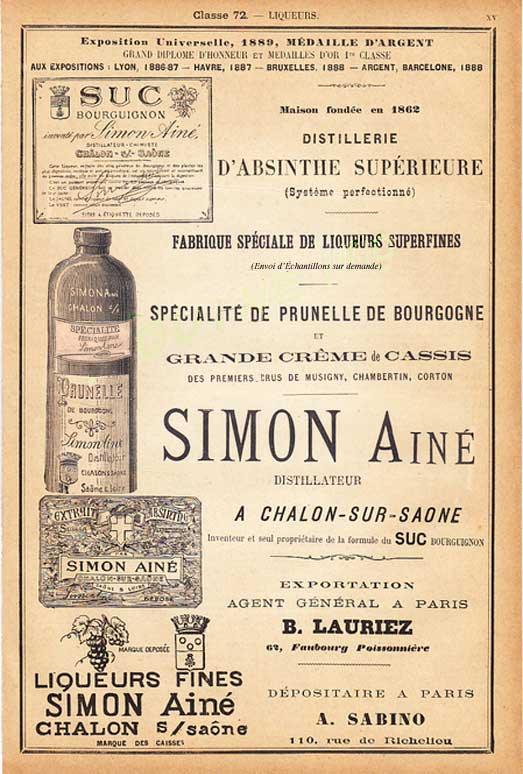
On trouve aussi cette publicité dans le Journal
de l'Ain 1889
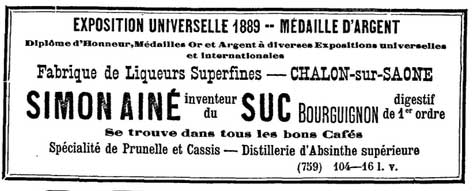
Nous savons donc que la distillerie SIMON AÎNÉ a
été crée en 1862. Or, en 1862, Jean-François SIMON n'avait que 16
ans; c'est une peu jeune, mais pourquoi pas? Nous savons aussi
qu'il a habité Pont-de-Vaux jusqu'en 1878. Ce qui voudrait
dire que la distillerie, probablement très modeste à ses débuts, a
été créée à Pont-de-Vaux. Un article des "Chroniques Chalonnaises"
de 2002, conservé aux archives de Chalon-sur-Saône (mais je
possède un double), semble confirmer le fait.
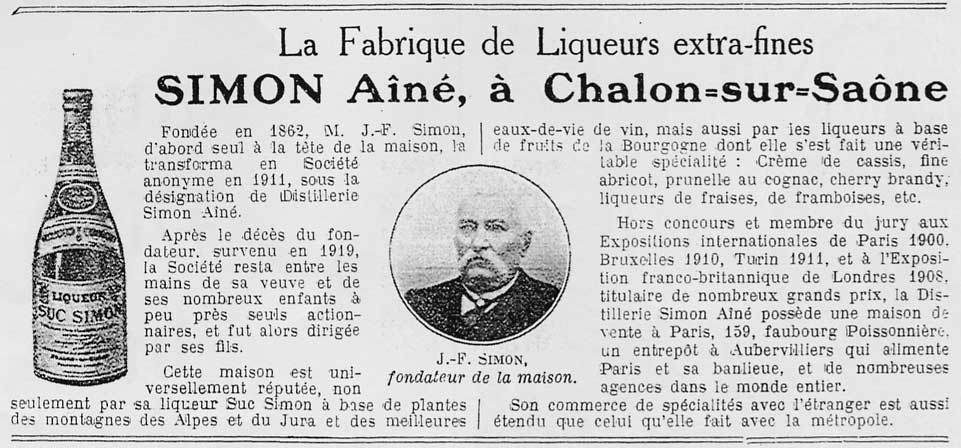
On retrouve ensuite la distillerie Simon-Aîné en
1879 à Chalon-sur-Saône, rues de Lancharres et de Lyon (également
dans des bâtiments peu étendus) avant qu'elle ne déménage à
l'angle de la rue de la Motte et de la place de Beaune - sur un
terrain acquis par Jean-François SIMON entre 1898 (l'acte de
naissance de Gabrielle, dernier enfant de Jean-François Simon, est
rue de Lyon) et 1902, date de la première photo datée que nous
ayons des bâtiments.
 état actuel de l'ancienne
distillerie Simon-Aîné
état actuel de l'ancienne
distillerie Simon-Aîné
à gauche 5 rue des Lancharres, à droite 9 rue de Lyon
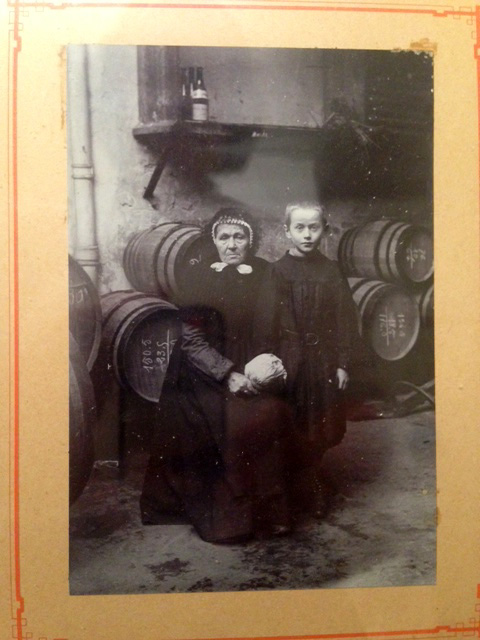 L'unique photo que nous ayons,
prise à l'intérieur de l'ancienne distillerie, dans les années
1885
L'unique photo que nous ayons,
prise à l'intérieur de l'ancienne distillerie, dans les années
1885
(mon grand-père, futur directeur, né en 1873 était encore un
enfant)
Notez la bouteille de
Suc Bourguignon bien en évidence
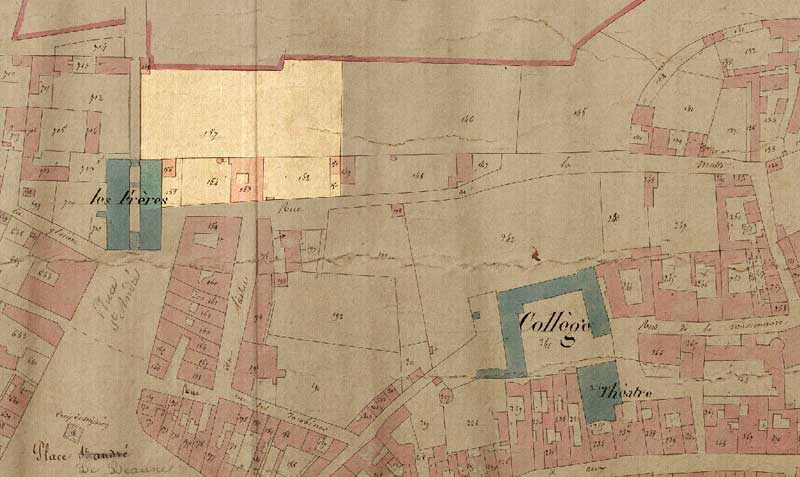 extrait du cadastre napoléonien de 1829 avec
l'implantation approximative du terrain où a été édifié la
nouvelle distillerie,
extrait du cadastre napoléonien de 1829 avec
l'implantation approximative du terrain où a été édifié la
nouvelle distillerie,
à l'angle de la place Saint-André (devenue place de Beaune) et
de la rue de la Motte

DESCRIPTION
La distillerie Simon-Aîné était située en ville,
à l'extrémité de la place de Beaune, face au kiosque à musique, à
l'angle de la rue de la Motte et de la rue de Belfort. On
reconnaît sur cette carte postale, dans le fond, l'entrée des
bureaux et la cheminée de la distillerie.
Elle se trouvait dans un beau jardin. Je sens
encore l'odeur très particulière des noyers d'Amérique dont une
rangée séparait l'usine de la maison habitée par Jean François
SIMON, puis par son fils aîné Étienne, mon grand-père, qui avait
pris sa succession après la guerre 14-18. Cette maison a été
démolie lors du percement de la rue Colette, en 1973. À sa place
s'élève actuellement un grand immeuble.
Le bulletin n°53 (octobre 2009) de la Société
d'Histoire et d'Archéologie de Chalon-sur-Saône, en grande partie
consacré à l'histoire de la distillerie Simon-Aîné, donne les
précisions suivants: "Les
bâtiments de la distillerie sont restés à l'abandon, après le
dépôt de bilan de la société Simon-Aîné, avant de retrouver une
nouvelle vie avec l'installation, à la fin des années 1960, de
la succursale d'un chaîne de quincaillerie et électro-ménager:
Caténa. C'est ce magasin de 1000 m2 qui a spectaculairement
brûlé le 8 avril 1972 avant d'être rasé pour la construction du
grand immeuble, au rez-de-chaussée duquel se trouve aujourd'hui
une agence de la Caisse d'épargne."

L'emplacement actuel (04° 51' 42" E - 46° 47' 05" N), vu par Géoportail

même prise de vue que la carte
postale en haut de la page, mais actuellement (Google Street
View)

la maison en 1903
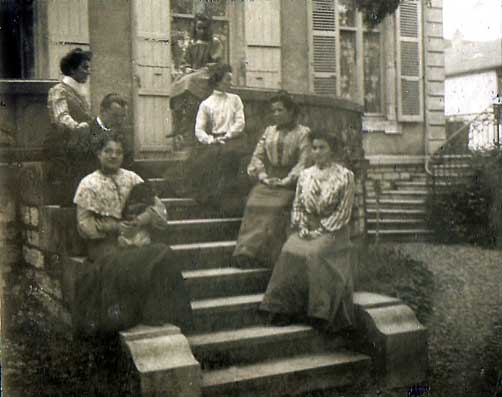 |
|
 |
|
 |
la terrasse en pignon, en 1908
|
|
niveau jardin - communs
|
|
niveau rez-de-chaussée
|
Cette maison était un bel exemple de "maison de
maître" de la fin du 19ème siècle. Elle comportait 4 niveaux:
d'abord les communs en contrebas (buanderie, chaufferie et cuisine
reliée par un monte-plats à l'office sis au rez-de-chaussée, près
de la salle à manger). Ce sous-sol était au niveau de la rue de la
Motte et accessible pour les livraisons et pour les sorties "sans
façon". L'imposant rez-de-chaussée était desservi par une allée en
pente douce, venant du portail d'angle donnant sur la place de
Beaune. Il était bordé par un balcon-terrasse auquel on accédait
depuis le jardin par un majestueux escalier double et par une
seconde terrasse en pignon. C"était "l'étage noble" et de
réceptions (les cuisines étaient en dessous, dans le communs,
déservies par un monte-charge), puis un 2ème étage et des combles.
C'est dans les pièces d'apparat (salle à manger, vaste salon) qu'a
eu lieu en 1903 la réception de mariage de mes grands-parents et
plus tard, en 1931, celle de mes parents. Mes grands parents
furent logés au premier étage, dans un appartement de qualité dont
je me souviens encore fort bien. Le dernier étage, qui était un
comble "à la Mansard" abrita quelques années durant ma grand-tante
Jeanne Simon, épouse de Laurent Pelletier. Ils y élevèrent leurs
enfants. De la sorte, cette grande maison familiale se trouvait en
permanence pleine de frères, surs et cousins qui ont conservé un
souvenir attendri de cette époque. Lorsque Jean-François Simon
décéda, en 1916, sa veuve continua à occuper le sous-sol et le
rez-de-chaussée, avec ses enfants encore célibataires et son frère
Francisque Benoît; ce jusqu'à son départ pour Givry. Je n'ai pas
connu cela. Lorsque j'étais petit, mes grands parents n'occupaient
plus que le premier étage et quelques dépendances au
rez-de-chaussée; le reste était loué à des personnes étrangères à
la famille.
 |
|
 |
le salon et la salle à manger du 1er étage en
1918

vue du côté rue de la
Motte, lors de l'inondation de 1910
la maison se trouve sur la gauche de la photo, suivie par sa
terrasse au 1er étage
La distillerie, en forme de L, faisait face à la
façade au balcon. Elle se composait d'un premier corps de
bâtiment, accessible depuis la place de Beaune, où se trouvait
l'administration.

la distillerie et la maison,
nouvellement édifiées, en 1902

le même point de vue
actuellement (Google
Street View)

entrée de la distillerie, avec la
maison sur la droite
toujours à peu près sous le même angle
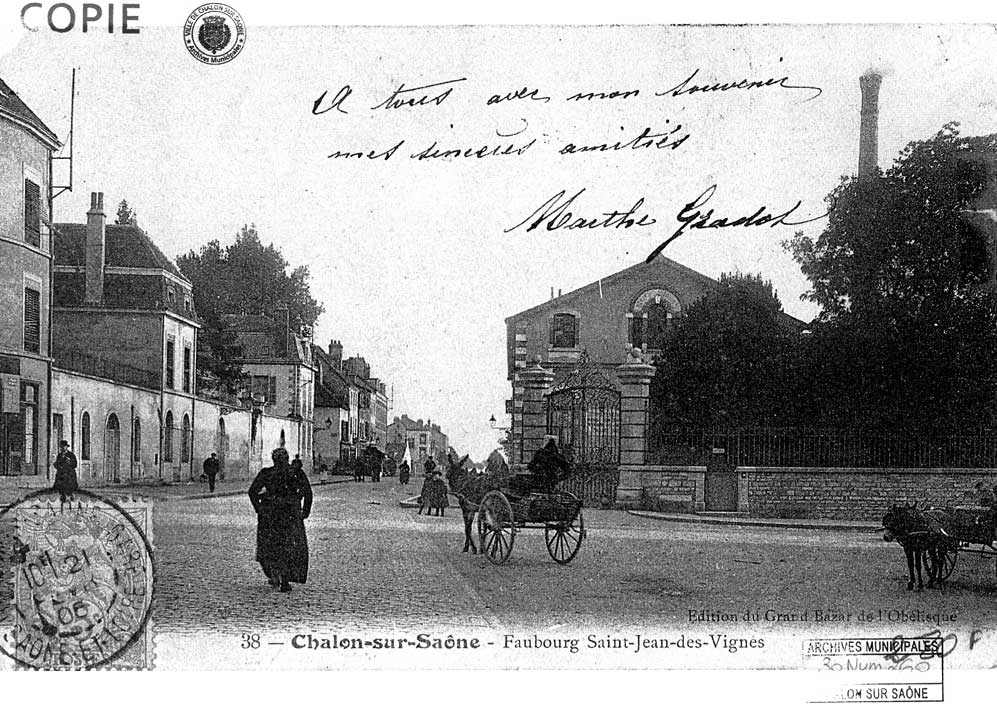
Une autre vue, avec la rue de
Belfort, qui semble être de1906 d'après l'affranchissement
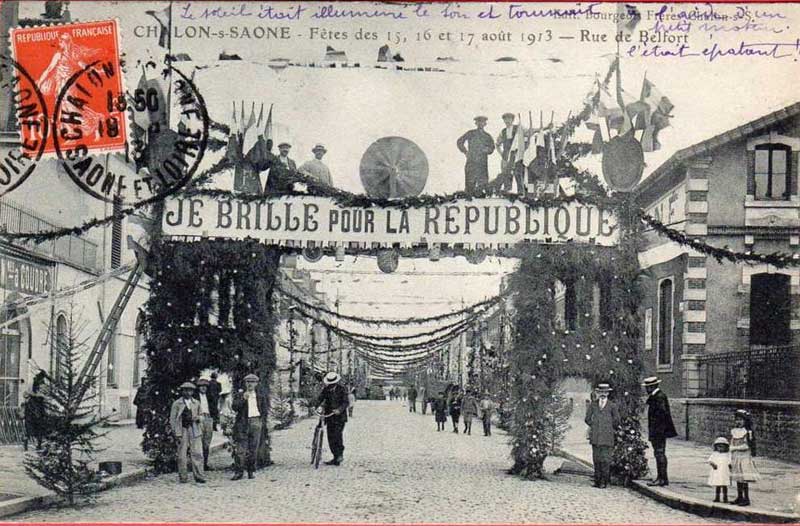
le même endroit lors de la fête de la République de
1913
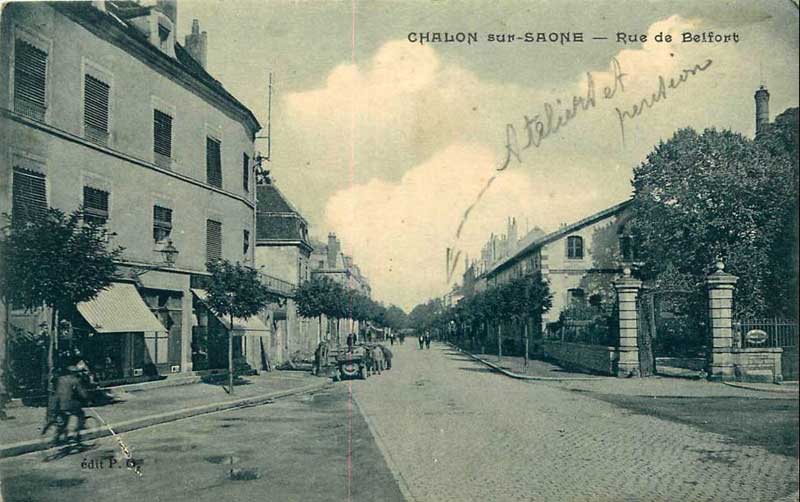 à peu près la même vue en 1926
à peu près la même vue en 1926
 le défilé du carnaval de Chalon passant devant la
distillerie
le défilé du carnaval de Chalon passant devant la
distillerie
Plus tard, la façade des bureaux a été modifiée et
on y a ajouté un perron.
maman et ses plus jeunes surs devant l'entrée
des bureaux
J'ai souvenir d'une vaste pièce meublée de
bureaux et de classeurs en bois sombre, dans le fond de laquelle
ouvraient les bureaux du directeur et de son fondé de pouvoir,
séparés du reste des employés par une estrade (si mes souvenirs
d'enfants sont exacts). Mais je n'avais que rarement le droit de
pénétrer dans ce sanctuaire. On m'a raconté que maman, petite,
aimait à venir y voir travailler la comptable, qui additionnait de
longues colonnes de chiffres plus vite que l'il ne pouvait les
lire. Maman était très impressionnée et s'entrainait en cachette
pour pouvoir en faire autant. Un beau jour, sûre d'elle, elle
laissa entendre à la comptable que cela ne devait pas être bien
difficile de compter aussi vite. Amusée la comptable lui donna à
additionner une page de chiffres et maman, l'air faussement
modeste, fit l'addition aussi vite que la comptable, qui en resta
ébahie. Maman avait eu sa petite heure de gloire...
Derrière les bureaux il y avait deux vastes
ateliers, réservés à l'embouteillage et à l'étiquetage. Toute cela
se faisait encore de façon très artisanale. Les bouchons et leur
collerette d'étain étaient placés à la main dans une presse à
levier et les étiquettes collés une par une.

Sur cette photo, probablement également prise en
1902 à l'entrée des entrepôts, figurent les employés de la
distillerie, avec leurs instruments. On y voit en particulier les
presses à boucher et cacheter les bouteilles; je les ai vues
encore en fonction, dans mon enfance et ai même eu le privilège de
m'en servir.
Un second bâtiment perpendiculaire aux bureaux,
tout en longueur sur deux niveaux, abritait les entrepôts, les
quais de livraison et la distillerie proprement dite. Là, il
m'arrivait parfois d'y rentrer, bien que cela me soit interdit à
cause de la présence d'une redoutable monte-charges dans la trémie
duquel j'aurais pu tomber.

les entrepôts
A l'angle des bureaux et des entrepôts il y avait
le "saint des saints": la distillerie proprement dite. Un grand
four de briques, avec des portes en fer noir, servait à chauffer.
Il était surmonté d'une haute cheminée de briques, visible dans
tout le quartier et dont la fumée revenait parfois désagréablement
vers la maison.

l'entrée de la chaufferie en 1910
Juste derrière le four, mais dans une autre
salle, se trouvait plusieurs beaux alambics de cuivre rouge et, en
face, trois grandes cuves, également en cuivre, où les fruits
macéraient dans l'alcool.
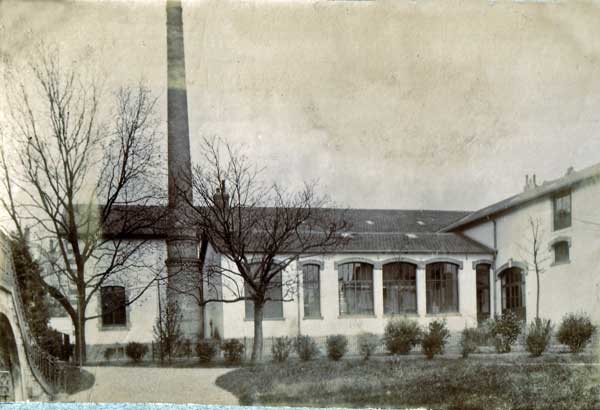
la chaufferie et les ateliers en 1903
Je regrette vivement de n'avoir aucune
photographie de l'intérieur de la distillerie car ce bel ensemble
industriel de la fin du 19ème siècle était une vraie pièce de
musée. En zoomant sur les fenêtres de la vue ci-dessus on arrive
toutefois, après traitement, à distinguer les alambics.
Et au hasard de l'album de famille, un autre
détail de 1923 montrant qu'il y a eu des modifications (un nouvel
appareil est visible par la fenêtre du centre).

Mais sur une autre photographie, de
1934,cet appareil a été remplacé.

L'odeur de liqueur était pénétrante et, dans mes
souvenirs de petit enfant, particulièrement attirante. Je n'étais
d'ailleurs pas le seul à penser cela puisqu'il est arrivé qu'un
essaim d'abeilles vienne s'y engloutir et s'y noyer, heureuses et
comblées. Maman m'a raconté qu'étant gamine, elle avait un cousin
particulièrement déluré qui avait fait le pari de faire pipi dans
les cuves. Il y serait arrivé après être monté sur le toit et
avoir retiré quelques tuiles! Qu'a t-on fait alors du contenu des
cuves? Je l'ignore et je ne pense pas que les enfants se soient
vantés de cet exploit. Par contre on m'a raconté que les fonds de
cuve, une ou deux fois par an, étaient mélangés et revendus à bas
prix dans les cafés de la région sous l'appellation de "n'importe
quoi".
- Que
prendrez-vous?
- Oh, n'importe quoi.
- Je vous l'apporte, monsieur.
Cela faisait sourire.
LES PRODUITS
Suc bourguignon, nectar Simon et suc Simon
La production de la distillerie était variée et
toujours de très grande qualité. Le produit vedette était une
liqueur à base de plantes, proche de la "Chartreuse" qui était
vendue, sous l'appellation de "Suc Simon", en
deux versions: jaune (43°) et verte (56°). Ce produit s'est appelé
au départ "Suc Bourguignon", mais on trouve à la même époque le
"Nectar Simon", d'une présentation un peu différente. Sur la
publicité reproduite en haut de cette page il est question de
"Marjolaine, verte, jaune, blanche" qui est très probablement
l'ancêtre du Suc Simon. Il est écrit sous la représentation de
cette marjolaine en cruchon: "ces
trois liqueurs sont identiques de fabrication, finesse et parfum
aux produits des Chartreux"; cet aveux implicite met fin
à toutes les controverses puisque la commercialisation de la
chartreuse est attestée depuis 1737 et que sa composition
était un secret de polichinelle depuis que Napoléon Ier l'avait
officiellement diffusée.
Comme l'atteste cet extrait du journal officiel, la marque "Suc
Bourguignon" et son étiquette ont été déposées le 21 septembre 1888
au greffe du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par
Jean-François Simon aîné, distillateur-chimiste. Le même jour
étaient déposées les marques "Liqueurs Fines Simon-Aîné
Chalon/Saône" et "Biiter des Alpes" présenté comme une boisson
hygiénique et anti-épidémique... Autres temps, autres moeurs.
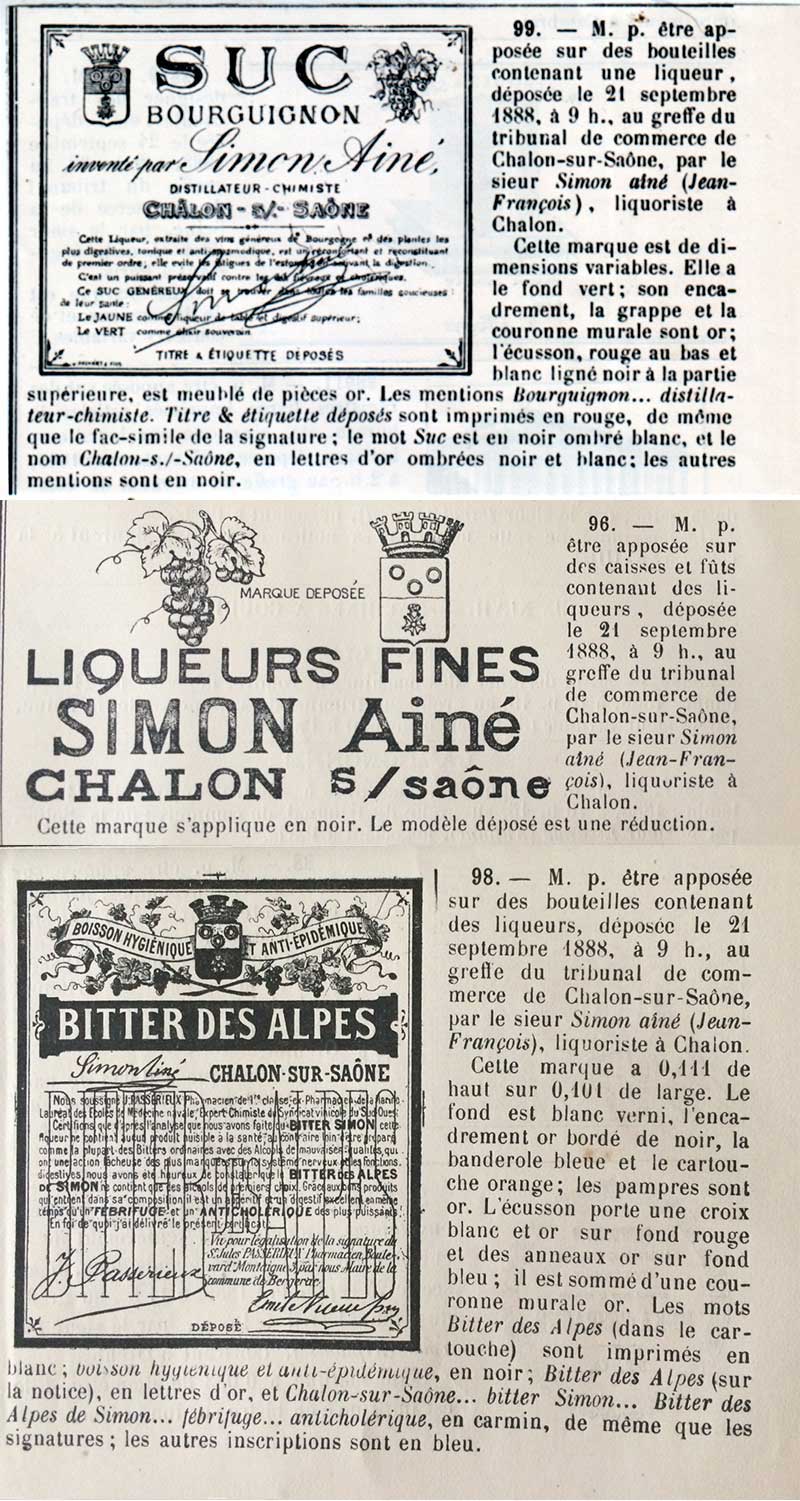
Les documents graphiques - factures, courrier,
affiches - antérieurs à 1902 font état de "Suc Bourguignon" et/ou
de "Nectar Simon". À partir des 1904 (pour les documents que j'ai
trouvés, voir la publicité ci-après), le mot "Bourguignon" se fait
tout petit, coincé entre "Suc' et "Simon", puis finira par
disparaître totalement, dans les années 20. Je pense que cette
période a été l'occasion d'une refonte des recettes, le "Suc
Simon", jaune et vert, reprenant, soit la recette du "Suc
Bourguignon", soit étant des adaptations des deux produits
précédents. La création du "Suc Simon" coïnciderait ainsi plus ou
moins avec la construction de la nouvelle distillerie, place de
Beaune dont la représentation commence d'ailleurs à apparaître sur
les en-têtes de factures et courrier à cette époque.


sur les présentations plus
récentes, le mot "Bourguignon" a totalement disparu

une mignonnette assez ancienne (on y lit Suc "Bourguignon"
Simon); l'étiquette est la même que celle de 1904 reproduite
ci-dessus.
Une mention de médaille obtenue en 1908 à Londres indique
toutefois qu'elle est postérieure à cette date de 1908.
La production ayant été pratiquement arrêtée pendant la guerre
14-18, tous les hommes de la famille étant mobilisés,
je dirais que cet échantillon est probablement de la période
1909 - 1914
Le Suc Simon faisait parfois l'objet d'une
présentation plus personnalisée, en version limitée, comme ce
cruchon de grès flammé.

Les plus anciennes publicités parlent de "Suc
Bourguignon" comme en témoigne ces croquis humoristiques de SAB
parus dans le CHARIVARI en 1894 ainsi que le sceau de cette
bouteille (hélas vide).
On trouve également de la publicité pour le "Nectar Simon" comme on
le voit sur cette petite carte de bar
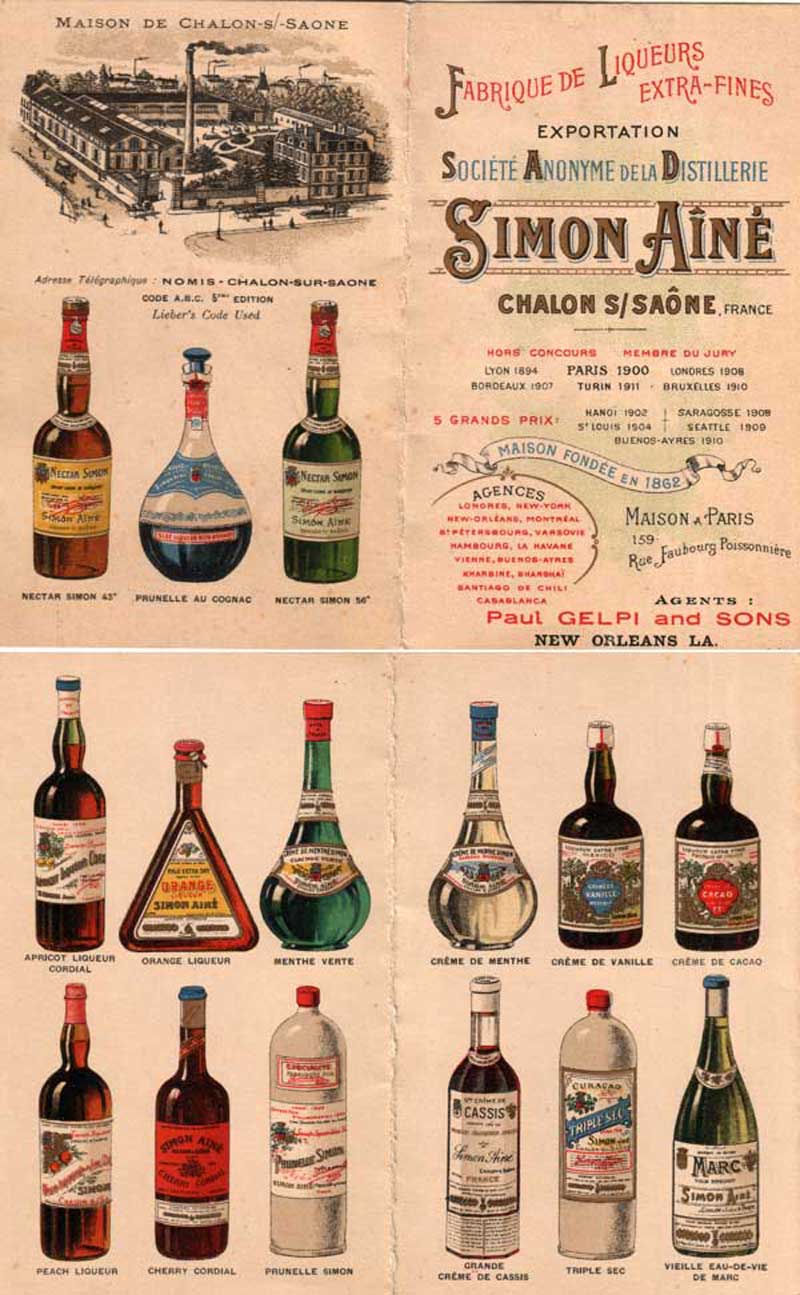
sur cette carte la dénomination
est encore "Nectar Simon"
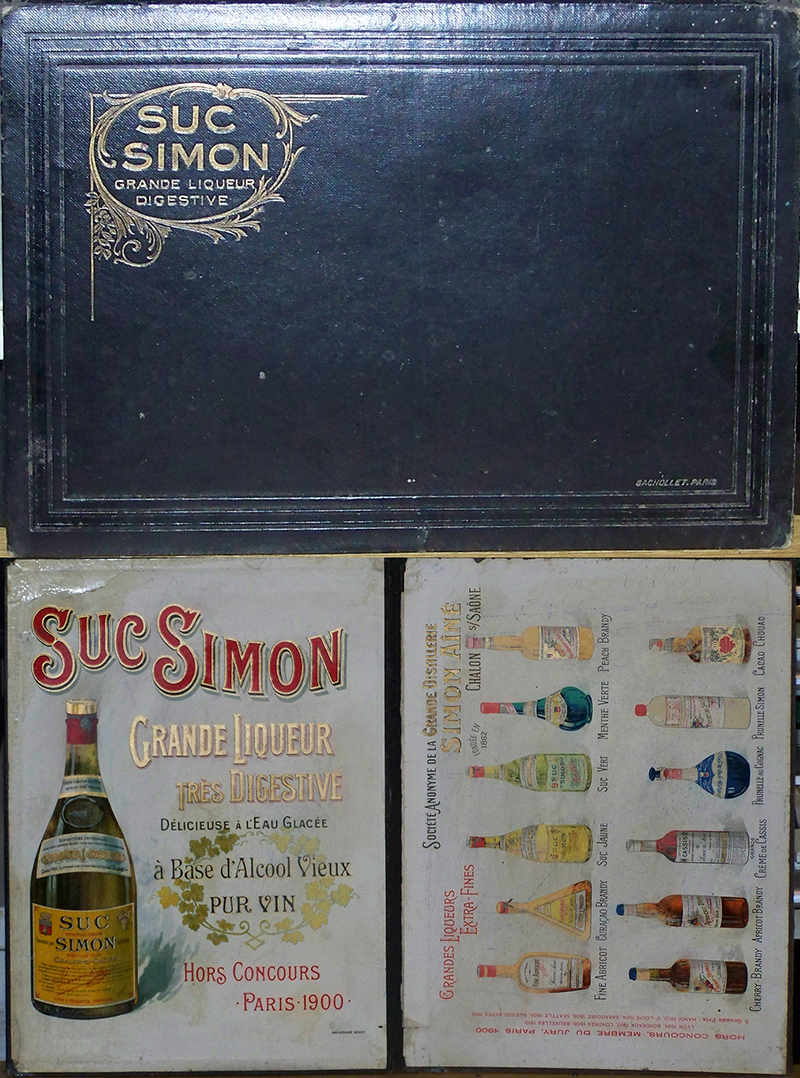
alors que sur ce sous-mains,
plus récent, il est déjà question de "Suc Simon"
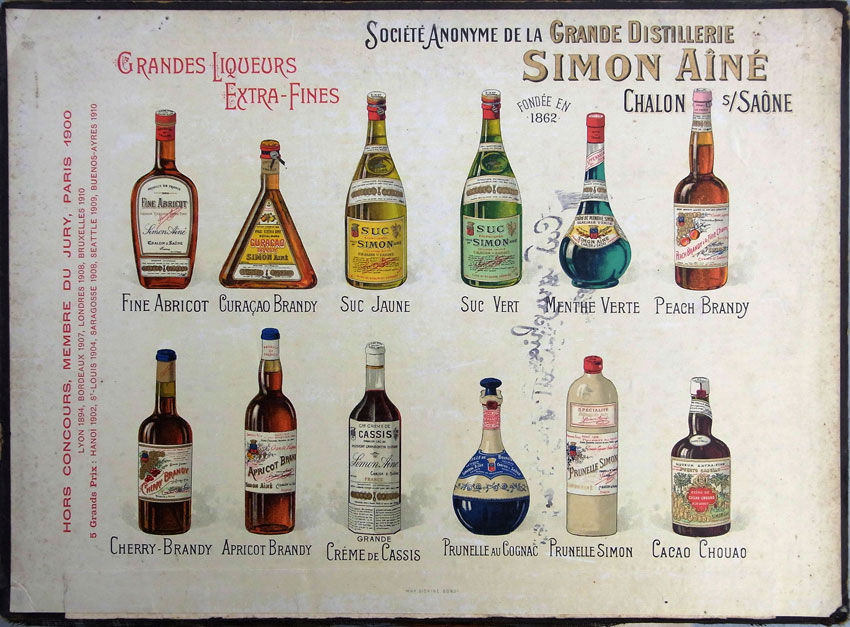
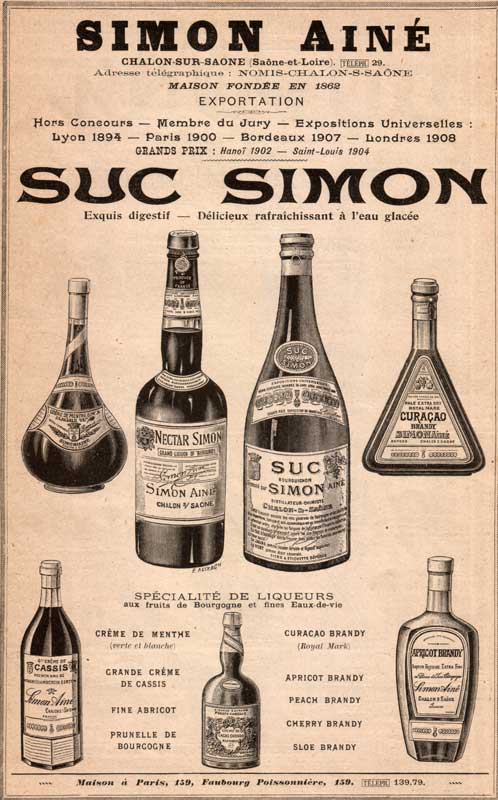
tandis que sur cette
publicité de 1909 cohabitent encore nectar et suc Simon
(la preuve que ce ne sont pas exactement les mêmes recettes)
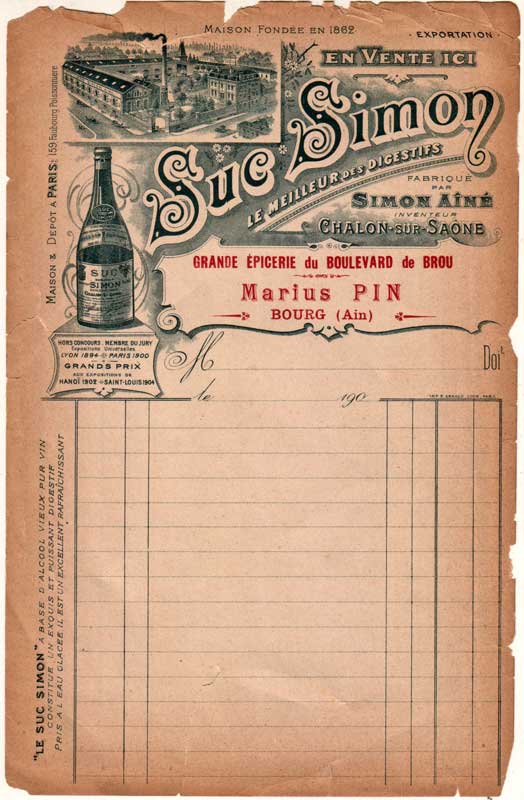
à peu près à la même époque, ce
papier à lettre de l'épicerie Marius Pin à Bourg-en-Bresse
mentionne qu'elle vend du Suc Simon
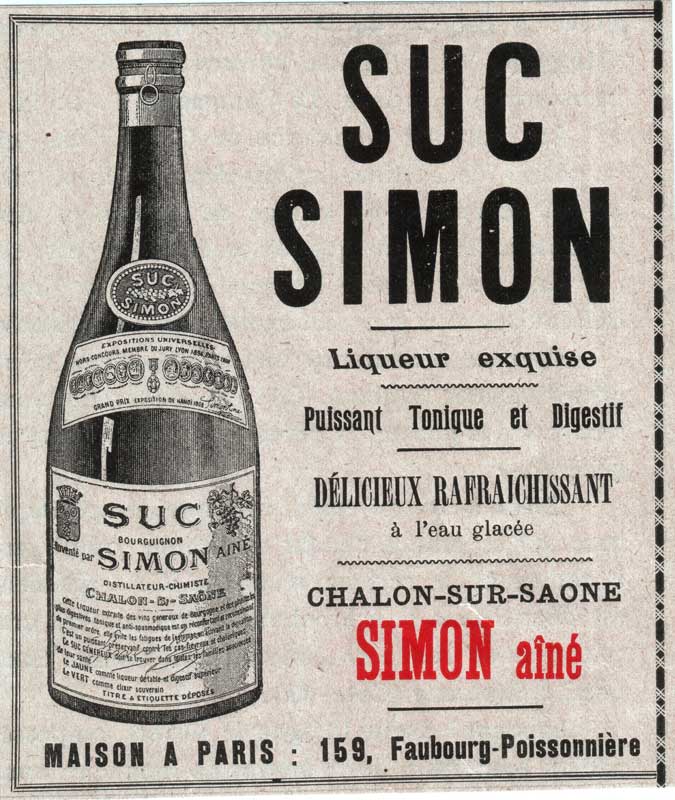
une autre publicité découpée
dans une revue, pour le "suc Simon", datant de 1911. Le mot
"Bourguignon" y est encore visible
 la bouteille de Suc Simon et sa
mignonnette; la mention "Bourguigon" a disparu
la bouteille de Suc Simon et sa
mignonnette; la mention "Bourguigon" a disparu
Mais il devient de plus en plus difficile d'en
dénicher des bouteilles encore pleines... À défaut et si vous
voulez vous faire une idée, ce qui ressemble le plus au Suc Simon
est à mon avis, en dehors de la chartreuse dont elle est une
copie, l'Élixir d'Armorique de la distillerie Warengheim:
une liqueur dont l'origine est aussi ancienne (1902) et qui a reçu
de nombreuses médailles. J'y retrouve à peu de chose près la
saveur que le Suc Simon a laissé dans ma mémoire. Cette liqueur
est toutefois actuellement à base de whisky alors que le Suc-Simon
comportait, je crois me souvenir, du vieux cognac que, par
ailleurs, la distillerie Simon Aîné commercialisait. Une affiche
précise qu'il est fait à partir "d'alcool
vieux pur vin", ce qui exclu tout autre produit.
La liqueur de prunelles
La production de la distillerie, toutefois, était
loin de se limiter au suc-simon et comprenait également de
nombreuses autres liqueurs de fruits dont il reste encore dans la
famille quelques bouteilles pleines et des cruchons de grès
joliment décorés (modèles déposés par l'entreprise Langeron à Pouilloux - cf "Le courrier de
Saône et Loire du 6 septembre 1977). Un de ses autres grands
succès était la liqueur de prunelles, dont on dit qu'elle a été
mise au point par un autre distillateur chalonnais (distillerie
Gaston NALTET-MENAND 27 rue du Temple) selon une recette trouvée
par hasard par un cousin BARRAULT pharmacien, de Buxy, commercialisée en 1842, puis largement
copiée (mais la société Simon Aîné en revendique également la
découverte, sur divers documents). Elle était présentée dans un
joli cruchon en grès émaillé, bleu et blanc, avec bouchon en grès
bleu (la prunelle Naltet avait pratiquement la même présentation
mais le bouchon était de couleur différente. Elle existait
également plus simplement, en cruchon droit.

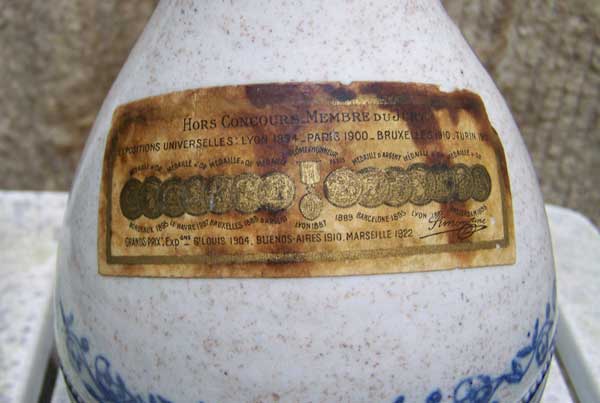
cruchons de prunelle Simon-Aîné

les mêmes en miniature

un beau cruchon en grès à
cristallisations, série limité, probablement début XXè siècle
Tout comme la liqueur de prunelles Simon-Aîné
celle de la distillerie Naltet avait également une présentation
plus simple, en cruchon droit. Il est indéniable que Jean-François
SIMON avait plagié sans le moindre état d'âme; à moins que ce ne
soit le contraire... Mais il faut bien reconnaître, à son excuse,
qu'il est loin d'avoir été le seul à le faire. Toutefois la
publicité de 1890 reproduite plus haut représente déjà un cruchon
de prunelle Simon. Les deux distilleries étaient d'ailleurs
voisines puisque, dans la rue de Lyon, les rues des Lancharres et
du Temple se suivent.

situations respectives des deux distilleries (GoogleMap)
René JEANNIN-NALTET, descendant de Thomas NALTET
me dit que, d'après quelques informations locales, qui m'ont été
confirmées par une cousine, son oncle Maurice NALTET (fils de
Gaston NALTET), ayant quitté l'armée de l'Air en 1919 serait entré
dans l'entreprise SIMON-AÎNÉ à cette date et y serait resté
jusqu'en 1928; il est probable qu'il a apporté avec lui la recette
authentique de cette liqueur et que ce qui a ensuite été
commercialisé était issu des deux recettes. Après la liquidation
de la société Simon-Aîné, la fabrication de la liqueur de prunelle
a été reprise par la société Lejay-Lagoute
(dont la famille était devenu majoritaire dans la société
SIMON-AÎNÉ à cette époque - voir en fin de page), qui en a revendu
en 2009 les droits à Thierry JEANNIN-NALTET (4 rue de Jamproies -
71640 Mercurey) lequel souhaiterait en poursuivre la fabrication
et la diffusion suivant la recette et les présentations
traditionnelles (mais il ne semble pas avoir donné suite à ce
projet).
 cruchons de prunelle Naltet
cruchons de prunelle Naltet
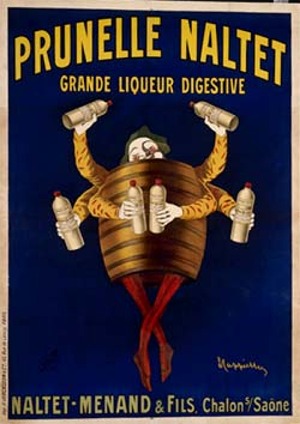
affiche de Cappiello pour la prunelle Naltet
Le cruchon droit de la version Simon-Ainé, tel
qu'on en voit une photographie un peu plus bas dans cette page,
bien qu'étant émaillé avait le défaut d'être à la longue plus ou
moins poreux... j'en ai fait moi-même la triste expérience et
débouché un cruchon que je croyais plein et dans lequel il ne
restait plus que quelques gouttes d'un épais sirop!)
Les autres productions
Mais d'autres liqueurs étaient également offertes
en cruchons, en séries limitées.






 la même présentation en
mignonnettes de grès flammé: peach-brandy, cherry-brandy et
fine-abricot
la même présentation en
mignonnettes de grès flammé: peach-brandy, cherry-brandy et
fine-abricot
Un article de la revue Lyon-Expo, du 5
août 1894, montre que déjà à cette époque les produits Simon-Aîné
étaient reconnus pour leur qualité.
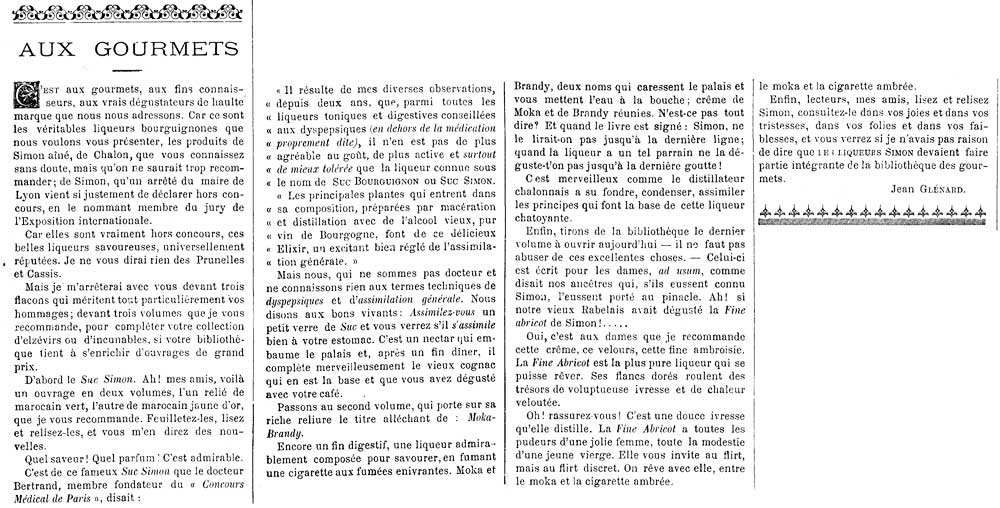
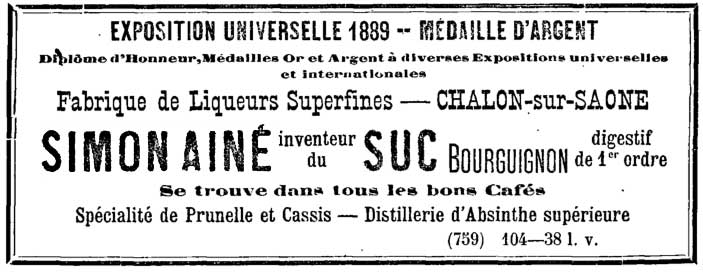
une autre publicité dans le
"Journal de l'Ain" en 1890

Et voici une belle collection de photos
des produits Simon Aîné, pleins, entamés ou vides mais d'une
grande variété.
La facture de 1862, déjà citée, mentionne également
que la distillerie produisait le "Kola-Koff-Simon - Puissant
tonique apéritif à base de Noix de Cola et de Quinquina". Ce
produit a disparu ensuite de la production.
Petite parenthèse à
propos des imitations: On déniche parfois des produits
Simon Aîné dans les enchères sur internet et chez quelques
vendeurs spécialisés, essentiellement en Suisse. Mais je ne
garantirais surtout pas qu'il s'agisse d'originaux car, si je me
souviens bien, les contrefaçons étaient déjà nombreuses lorsque la
distillerie était encore en activité (il y a avait même un petit
"musée de la copie" dans un coin du bureau de mon grand-père!) et,
actuellement, plus rien ne semble s'y opposer, sur le plan légal,
puisque la marque a disparu avec la liquidation de la société.
Ainsi, on peut lire très distinctement sur l'étiquette de la
bouteille de prunelle ci-dessous "Simon Aîné - Beaune (Côte
d'Or)". De même, la bouteille de Marc ci-dessous, est vendue sous
la description "authentique marc de Bourgogne de la famille Simon
Aîné. - récolte de 1975"; la distillerie ayant cessé son activité
en 1959, cela laisse songeur. Un autre vendeur sur internet
propose une bouteille de marc de Bourgogne "égrappé 1963 - produit de la
famille Simon Aîné Beaune" Sont-ce des produits de la
maison François LABET, à Vougeot, dont le nom
commercial déposé est "LA CAVE DES TAILLANDIERS - SIMON AINE A
BEAUNE - BARON DE BOURGOGNE" ? Je ne le pense pas, mais plutôt des
imitations reprenant jusqu'aux médailles décernées à la
distillerie Simon-Aîné. Quant aux capsules métalliques... à quand
ce procédé remonte t-il? Plus je progresse dans mes recherches et
plus je constate que la copie, dans le domaine des liqueurs, a été
et est encore largement pratiquée... et Simon-Aîné n'a visiblement
pas été le dernier à le faire! Mais au moins le nom a t-il été
repris et c'est consolant.

J'ai aussi trouvé, il y a peu de temps, en vente
sur internet une série d'étiquettes de liqueurs de la société
"SIMON Jeune" à Chalon-sur-Saône. Le style de ces étiquettes est
proche de celui des étiquettes Simon Aîné, en particulier pour
celles des crèmes de Menthe et de Cassis qui reprennent les fonds
métallisés des productions tardives de la maison Simon Aîné (voir
la bouteille de brou de noix ci-dessus). Les autres étiquettes
semblent être plus anciennes, avec un logo compliqué proche de
ceux qu'on trouve chez Simon Aîné. Mais, bien que le graphisme et
la typographie soient proches, il ne s'agit ni de copies, ni de
plagiat. J'ai essayé, sans succès, de trouver mention de cette
distillerie "SIMON Jeune" et n'en ai jamais entendu parler dans la
famille.

Cette distillerie Simon-Jeune a
pourtant dû exister, comme en témoigne cette carte postale qui
vante la liqueur "Callistine", liqueur de l'abbaye de Cluny (dont
l'illustration reproduit une gravure bien connue de la façade du
pape Gélase) produite par la distillerie Simon-Jeune à
Chalon-sur-Saône.
Fermons la parenthèse.
Toutes ces liqueurs étaient faites à partir de
fruits frais. Des cousins, qui exploitaient des orangeraies à
Nabeul, en Tunisie, fournissaient régulièrement la distillerie, en
hiver. Les oranges arrivaient par bateau à Marseille où la
distillerie avait un entrepôt, en remontant le Rhône, puis la
Saône et étaient épluchées, car le curaçao et la liqueur d'orange
ne sont faits qu'à partir de l'écorce du fruit. Les fruits
épluchés étaient ensuite distribués dans les écoles, pensionnats,
maisons de retraite, hôpitaux de la région, pour être rapidement
consommés, en salades. À ce propos, j'ai retrouvé dans les
archives de la famille, les photos prises en Tunisie par mes
grands-parents, lors de leur voyage de noces chez leur oncle, à
Nabeul. Les trouvant très intéressantes, je les ai mises en ligne
ici.
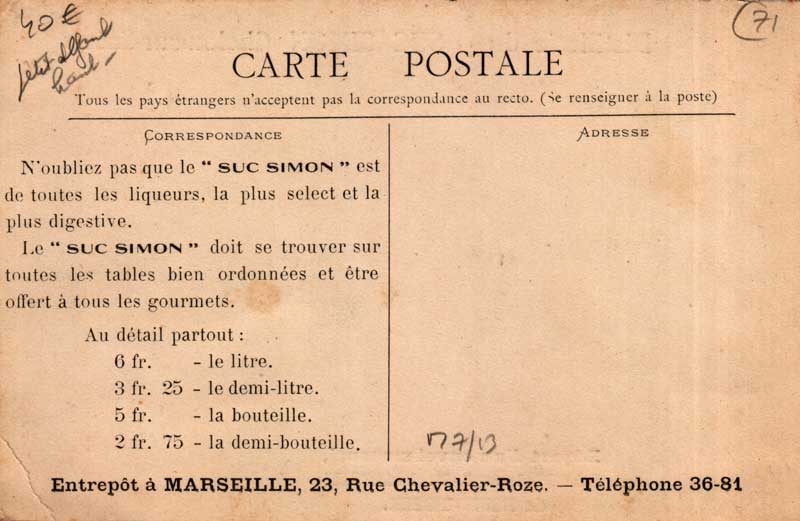

verso de la carte-postale
figurant en tête de cette page, avec l'adresse de l'entrepôt
marseillais
et vue actuelle (Google StreetView)
De même, en été, une véritable armée d'étudiants
allait cueillir le cassis sauvage, dans toutes les haies de la
campagne bourguignonne, pour alimenter la distillerie. L'odeur du
cassis, entêtante, régnait alors en maître dans toute la
propriété. Puis, à l'automne, c'était le tour de la récolte des
prunelles, de la même façon.
|
Un de mes lecteurs vient de m'envoyer une
photographie d'une bouteille de cassis Simon,
précieusement conservée dans la cave de ses parents, à
Chalon et ouverte en juillet 2008 pour fêter leurs 50 ans
de mariage. Vous pouvez comparer l'étiquette de cette
bouteille, authentique, avec celle de l'imitation
reproduite ci-dessus. Voici son appréciation:
"Bien que le bouchon (très court )
ait gardé une faible pression sur la bouteille, le
cassis a développé toute sa saveur, assez sucré avec une
belle robe sombre et une force en gorge qui procure un
réel plaisir."
|

|
Les nombreuses médailles gagnées dans les
concours internationaux, qui souvent figurent sur les étiquettes,
sont la preuve de l'excellence et de la qualité des produits SIMON
AÎNÉ. Ci-dessous une photo prise lors de l'exposition de Turin en
1911. Je n'ai pas réussi à y identifier formellement Jean-François
SIMON (probablement est-ce lui, en costume sombre au fond de la
rangée de gauche, qui s'accoude sur le dossier de sa chaise. Mais,
en tous cas, le repas semble avoir été bien arrosé...
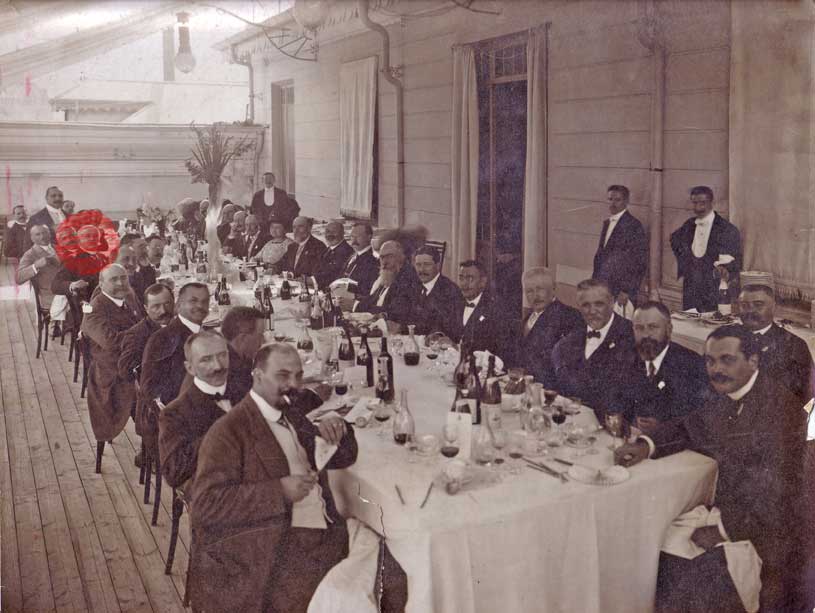
La distillerie SIMON AÎNÉ produisait également
d'autres alcools, comme le marc de Bourgogne (au passage, on note
que la forme de la bouteille ainsi que l'étiquette n'ont rien à
voir avec celles des imitations actuelles). Elle importait
également divers produits dont un vieux rhum de Martinique qui me
laisse encore un souvenir ému (je pense, hélas, qu'il n'en reste
plus une seule goutte), mais aussi du vin et, plus
particulièrement des vins algériens de la région de Mascara, de
grande qualité et qui vieillissaient bien et aussi des vins
tunisiens produits par nos cousins de Nabeul.
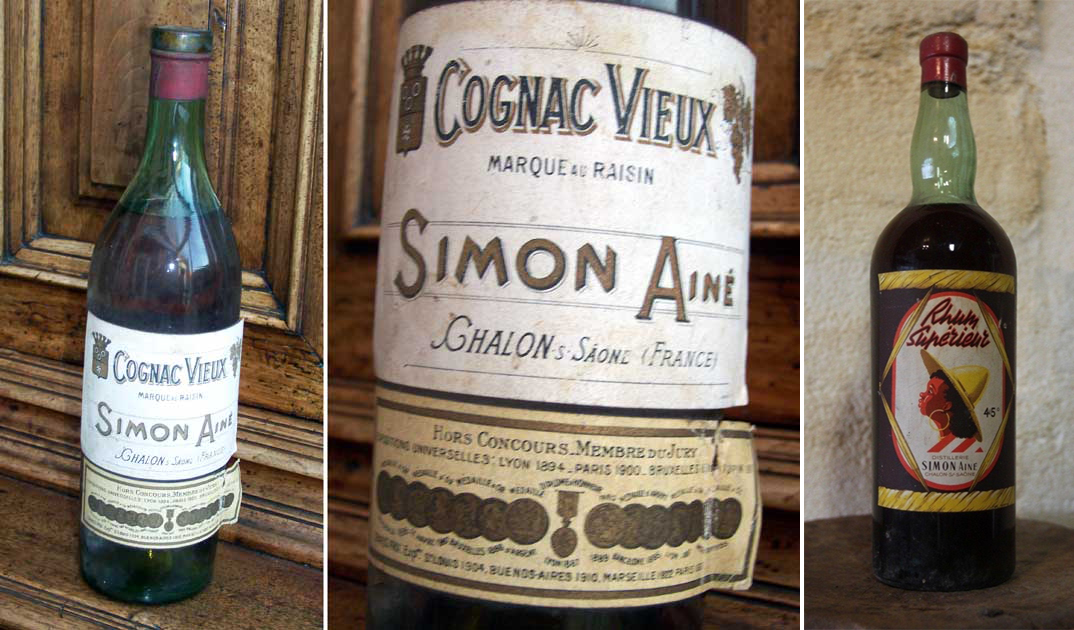
 un muscat de Tunisie et une
autre présentation de liqueur de prunelle
un muscat de Tunisie et une
autre présentation de liqueur de prunelle

LA
PUBLICITÉ
À cela - et c'était assez novateur à l'époque
- s'ajoutaient nombre d'objets publicitaires, cendriers,
pyrogènes (objet dans lequel on plaçait des allumettes, avec un
grattoir sur le côté), mignonnettes, carafes, buvards, bons de
change, jetons, crayons, agenda, plaques, canifs, éventails, tapis
de bar, affiches... que l'on trouve encore régulièrement en vente
aux enchères sur le net (d'où sont extraites la plupart de ces
photographies).
|
|
|
|
|
|
|
|
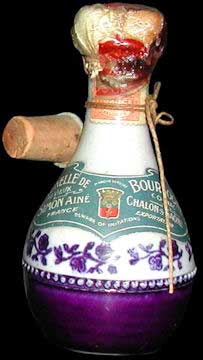 mignonnette de prunelle
mignonnette de prunelle
|
|

|
 pyrogène à pied douche,
avec marque du fabricant
pyrogène à pied douche,
avec marque du fabricant
 pyrogène à coupe en bois
(peut-être un bricolage)
pyrogène à coupe en bois
(peut-être un bricolage)
|
|
 quittances
quittances
|
 crayons
crayons
|
|
 jetons
jetons
|


autres jetons et boîte à
jetons
|
|

couteau - tire bouchons
|

buvards
 encrier
encrier
 carafe suc Simon et
quadruple carafe
carafe suc Simon et
quadruple carafe

petite carafe de jus de fruit
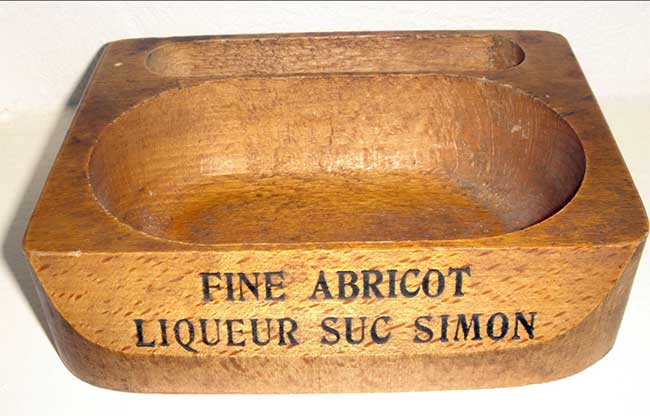 sabot de cartes à
jouer
sabot de cartes à
jouer
|
|
|
|
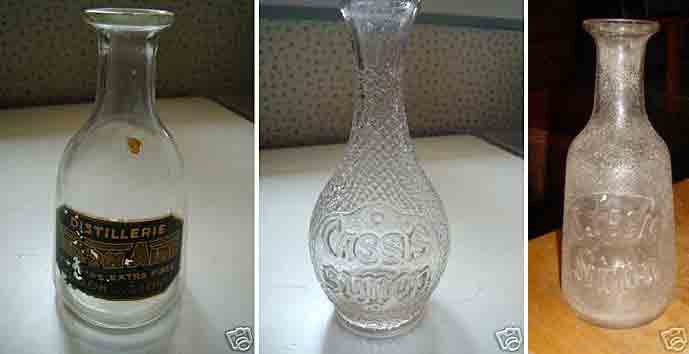
carafes diverses
|
|
|
|
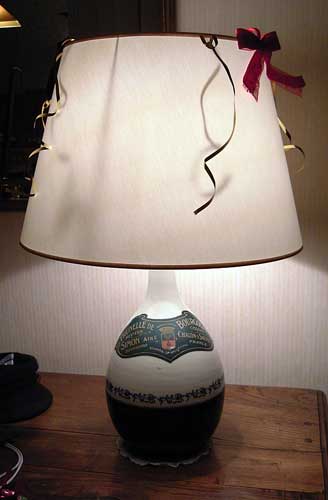 un cruchon de prunelle
grand format
transformé en lampe
un cruchon de prunelle
grand format
transformé en lampe
|
|
 buvards
buvards
|
|
|
|
  |

|
|
|
|
 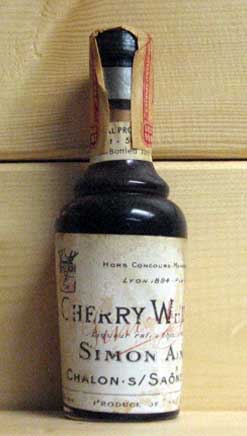
|
|

|




 


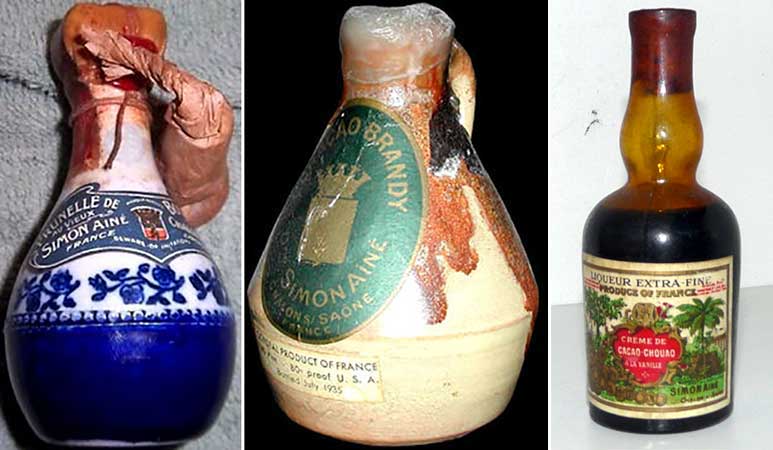
une belle collection de
mignonnettes, la plupart conservées dans la famille
mais également de photos aimablement transmises par un
collectionneur polonais




celles là sont
malheureusement à moitié vides: évaporation, la part des
anges comme on dit
|
|
calepin en tôle émaillée
|
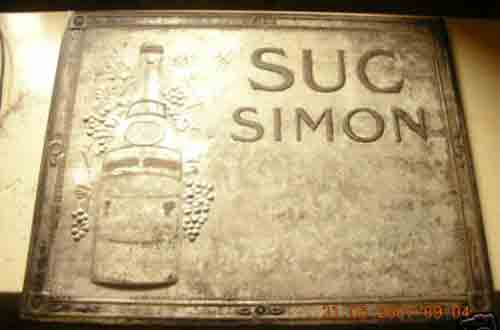 sous-main
sous-main
 |
|
 divers cendriers
divers cendriers
|


 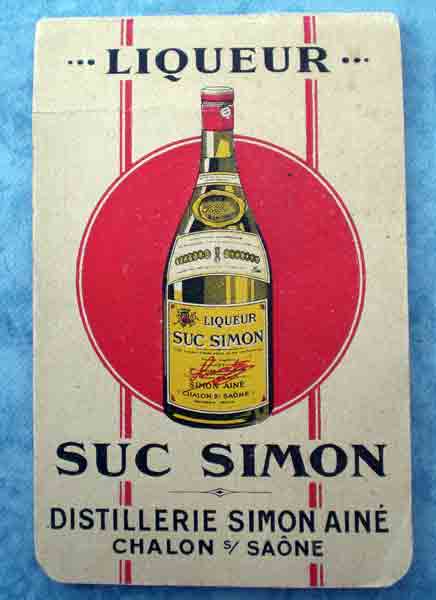
divers tapis de bar et
éventails

publicité à;accrocher dans un bar
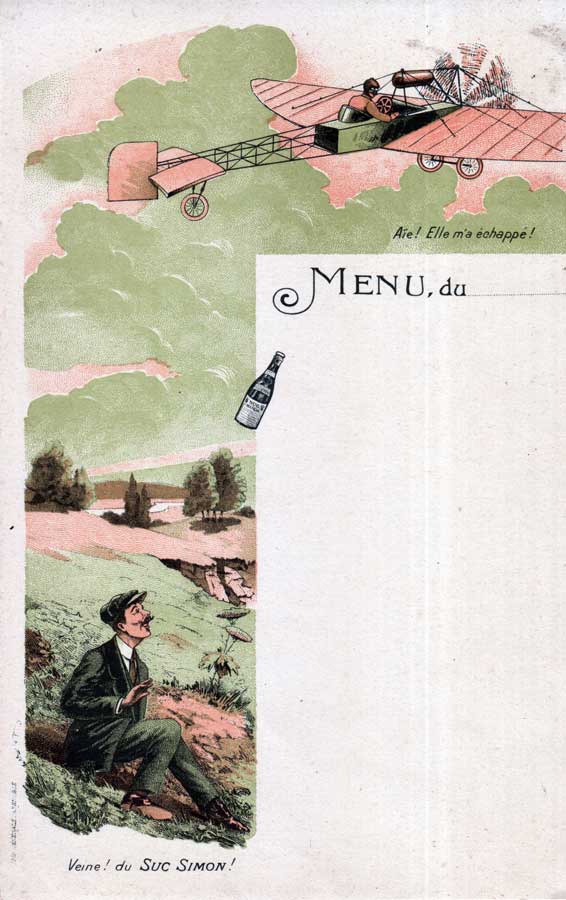
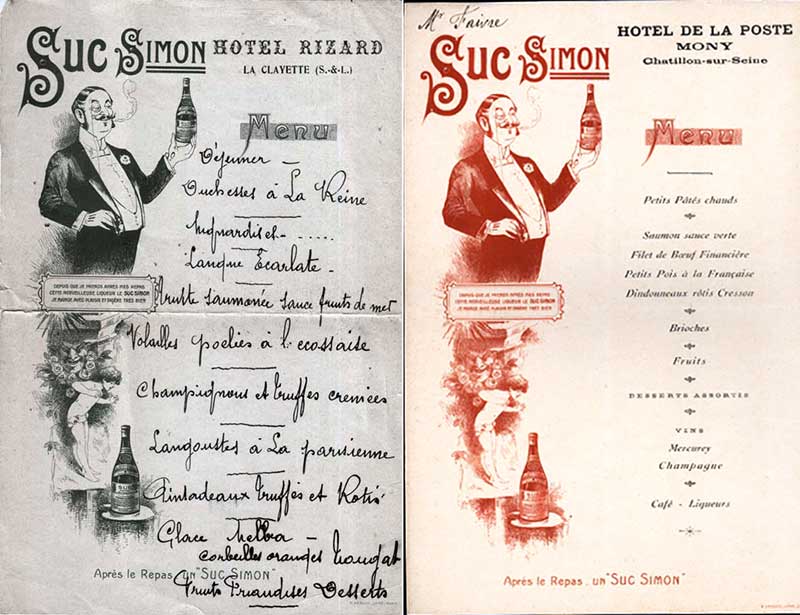
menus
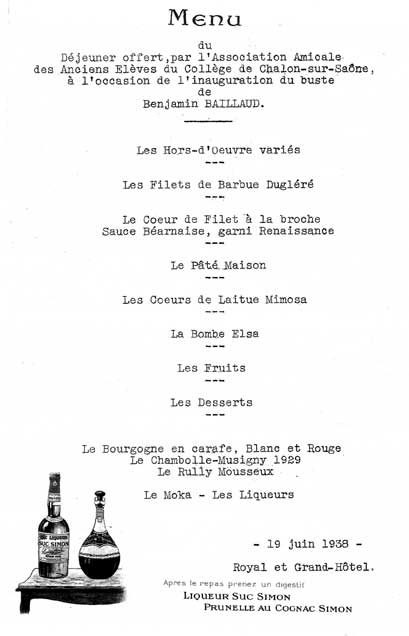
un autre menu pour un
banquet en 1938
|

canifs
 coupe-choux
coupe-choux

DOCUMENTS GRAPHIQUES
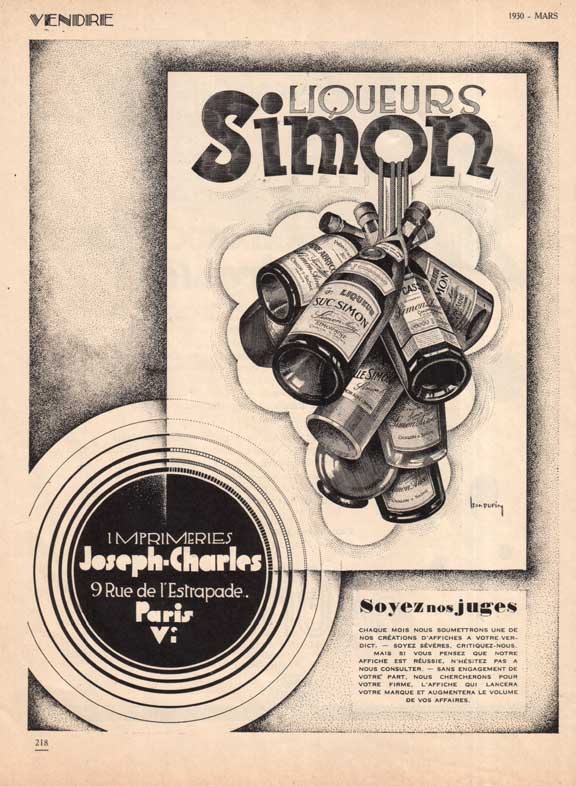
publicité 1930 de Léon Dupin pour l'imprimerie
Joseph Charles, avec les liqueurs Simon comme motif
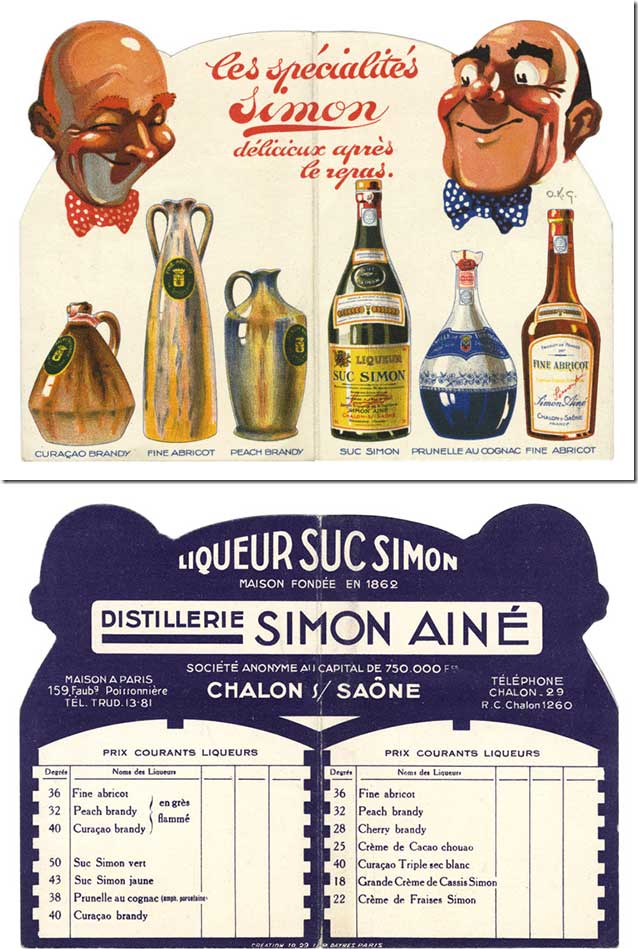
une autre publicité
(recto-verso) avec 3 beaux cruchons de grès émaillé

un tarif
Lettres et factures
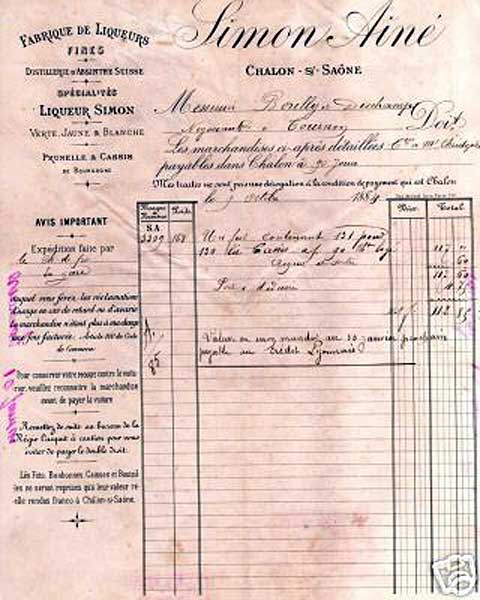
la plus ancienne facture trouvée par moi, du 9 octobre
1884
Elle mentionne "Distillerie d'Absinthe Suisse"
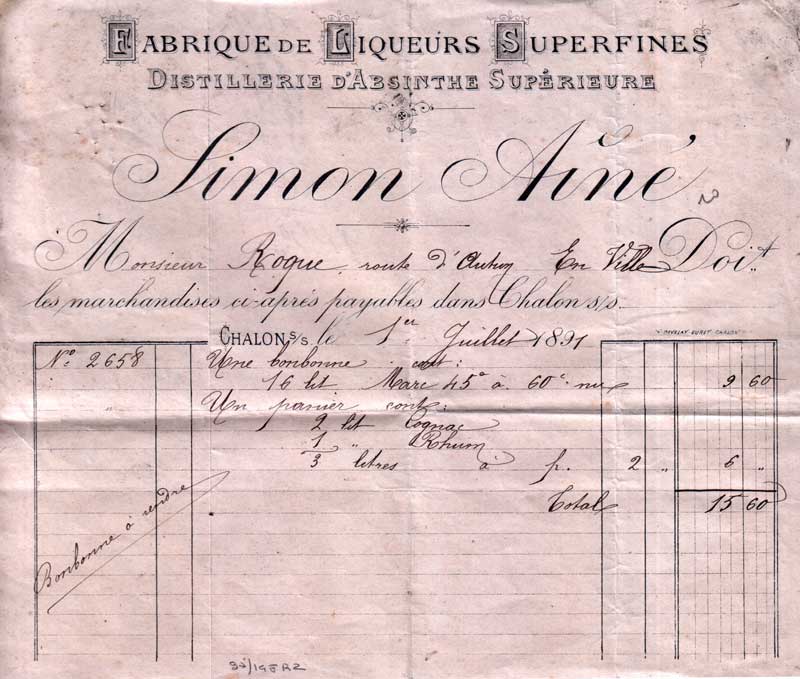
facture 1891
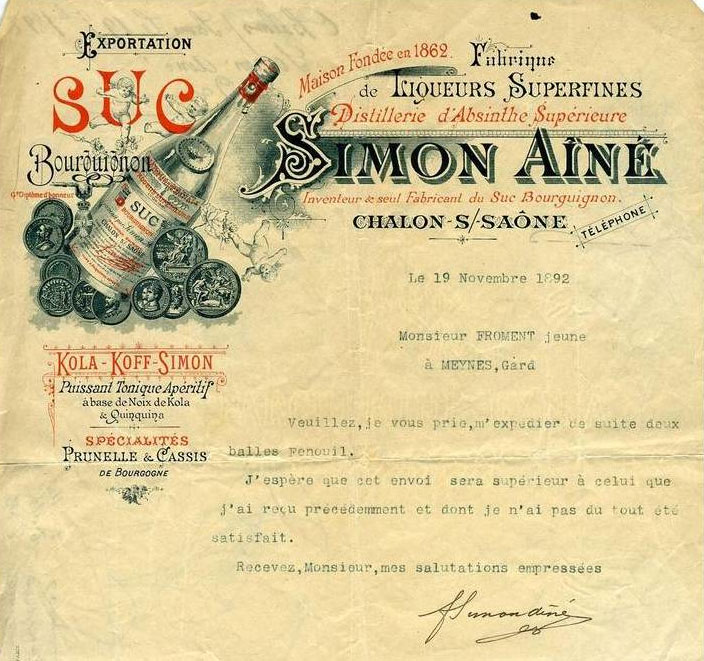
facture de 1892, avec les mentions Kola-Koff-Simon et
Distillerie d'Absinthe Supérieure
le papier à lettre avait changé et affiche fièrement que
la société a le téléphone
(on a toujours aimé le progrès chez les Simon) et
surtout, elle a été tapée à la machine,
instrument encore assez rare au 19è siècle (les
premières Remington datent de 1873)
C'est la plus ancienne mention du Suc Bourguignon que je
connaisse
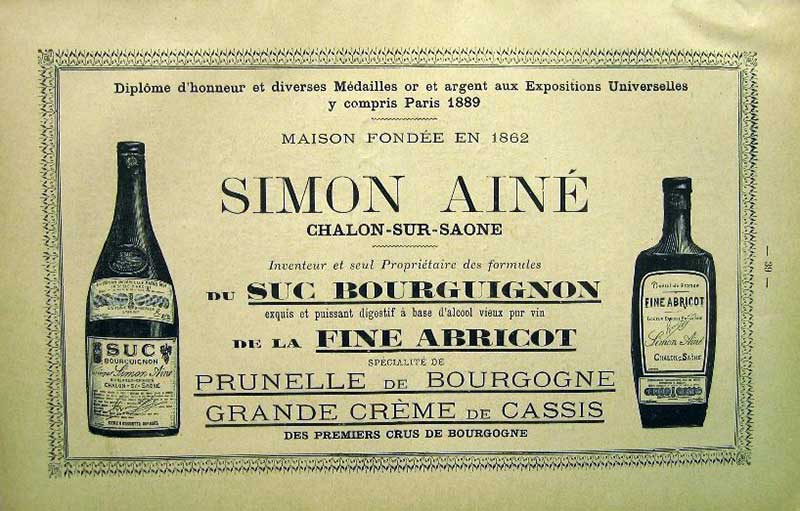
deux ans plus tard, en 1894, une publicité dans une revue
pour le suc bourguignon et
la fine abricot: également une grande première pour la
fine abricot, jusque là inconnue au catalogue
 une enveloppe de 1898
avec une belle illustration, qui sera reprise avec
quelques petites
une enveloppe de 1898
avec une belle illustration, qui sera reprise avec
quelques petites
modifications sur les documents suivants
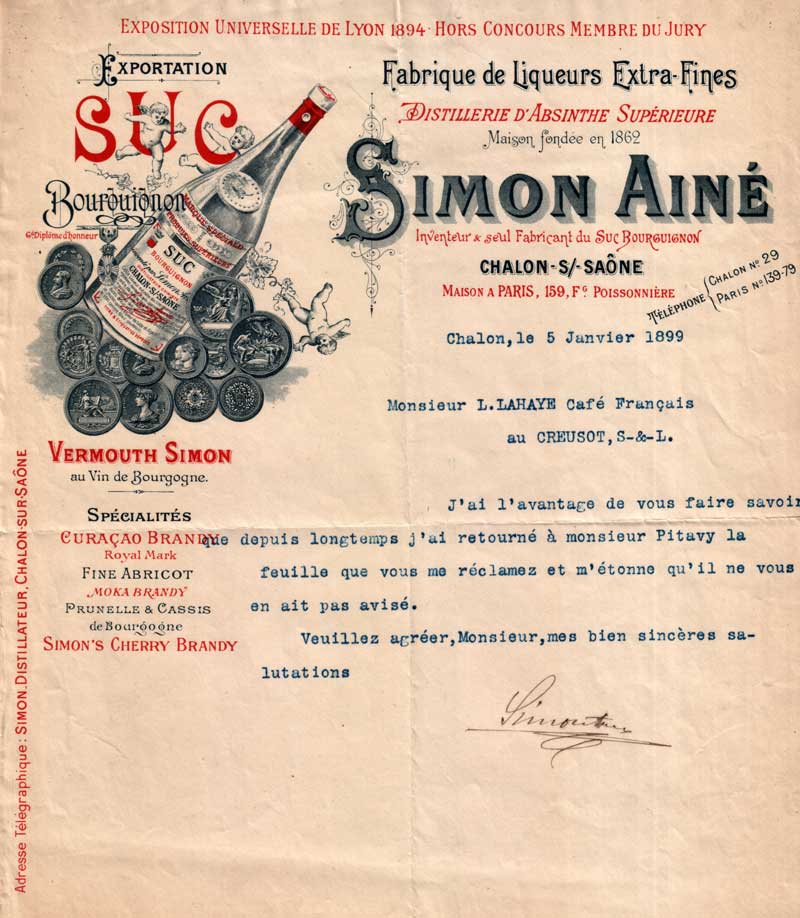
Une facture de 1899 signée "Simon Aîné", donc de
Jean-François Simon.
Cette fois ci les numéros de téléphone sont donnés: ils
étaient encore peu nombreux à l'avoir à Chalon
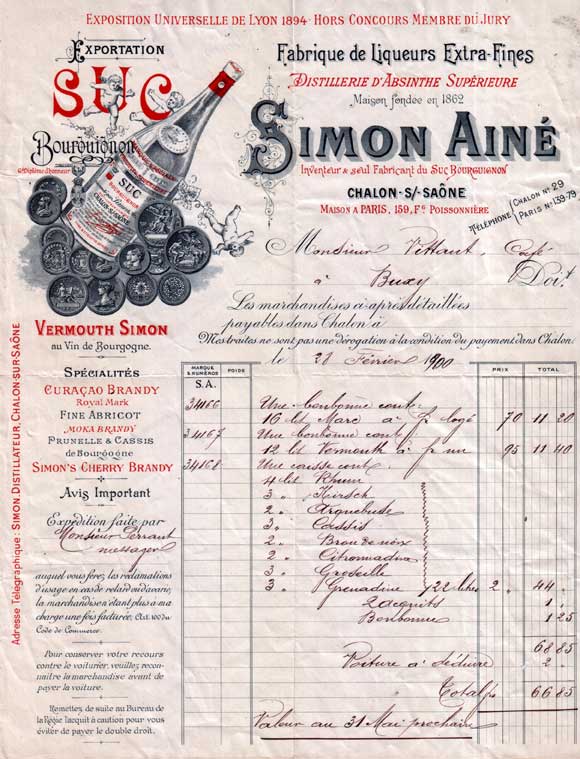
sur cette facture de février 1900 figure l'adresse du
159 faubourg Poissonnière
qui est celle du gendre de Jean-François Simon, Auguste
Loisy

du côté droit de la rue, l'immeuble du 159 faubourg
Poissonnière
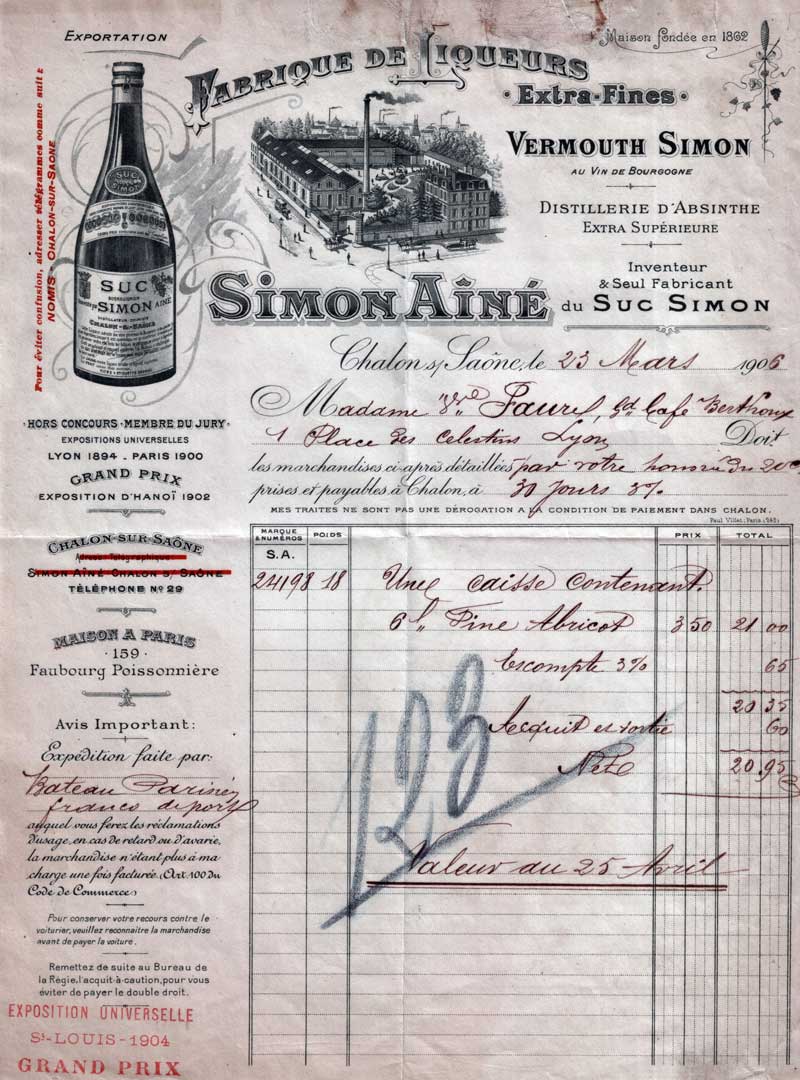
facture de 1906 montrant une bouteille de Suc
(bourguignon) Simon et une vue cavalière de l'usine
cette vue sera reprise ensuite sur de nombreux documents
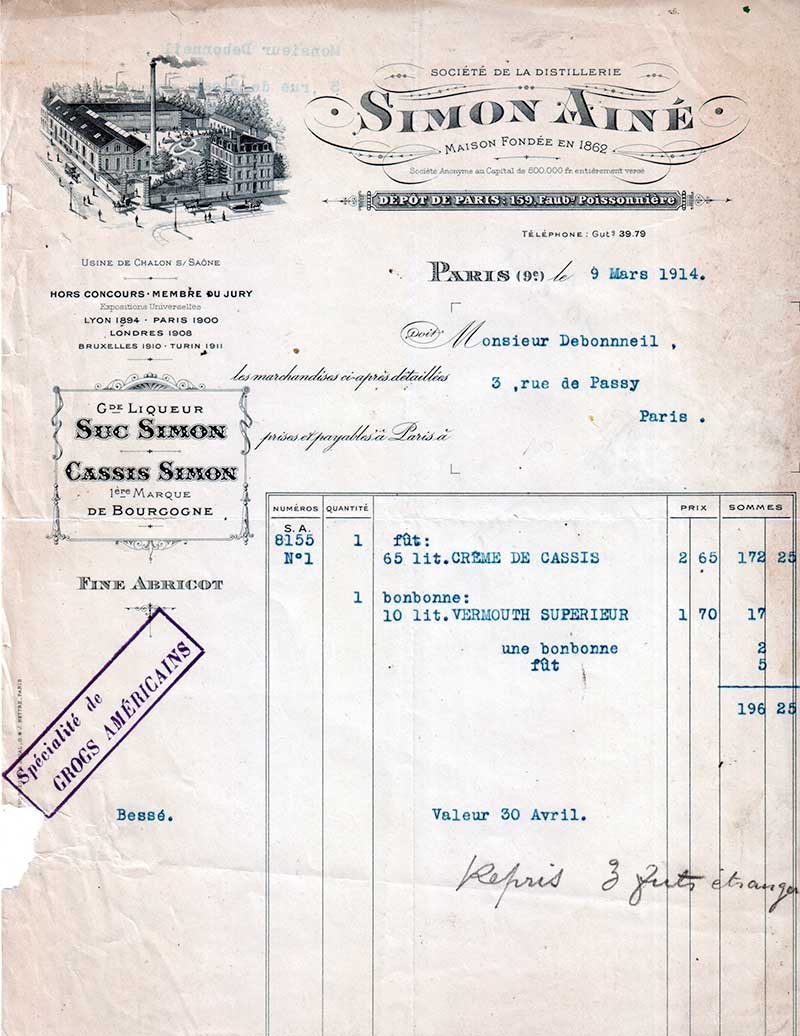 facture de mars 1914;
cinq mois avant la déclaration de guerre.
facture de mars 1914;
cinq mois avant la déclaration de guerre.
C'est la première mention que je connaisse du Suc Simon
(sans le mot "Bourguignon")
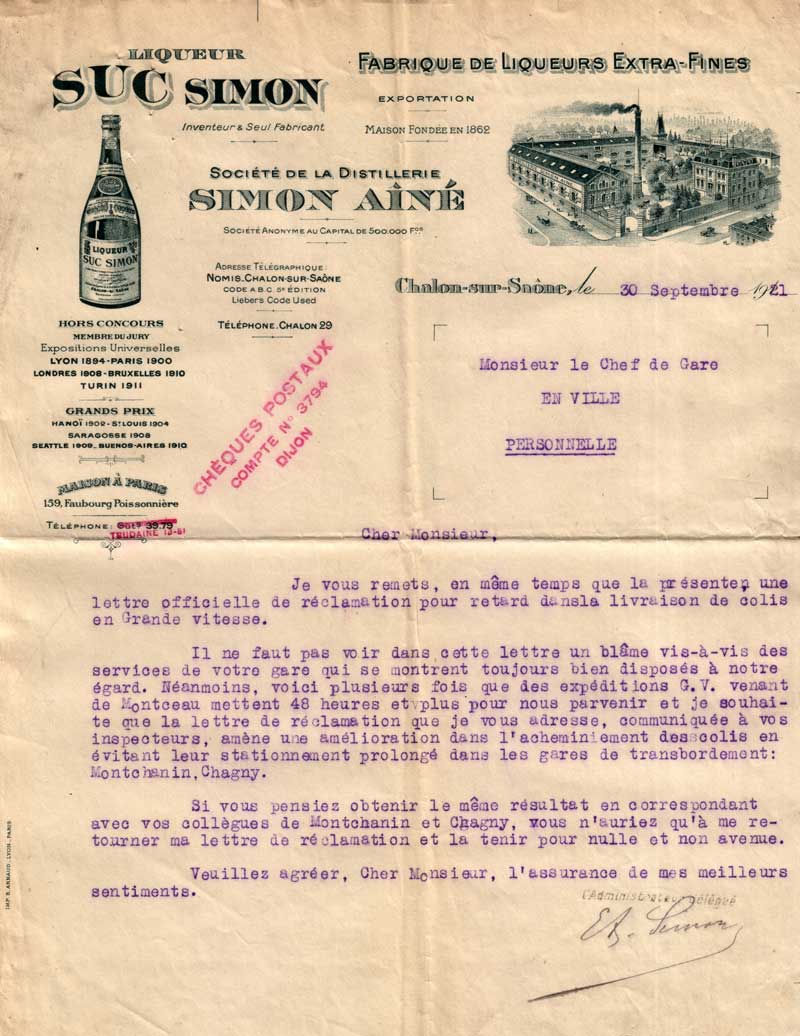
lettre de 1921 avec un nouveau papier à lettres où l'on
voit une seconde version de la vue perspective
de la distillerie et la maison, plus exacte mais moins
animée et sans les cheminées d'arrière-plan
(tout cela me semble d'ailleurs plus grand que dans mes
souvenirs)
Elle porte la signature de mon grand-père Étienne Simon
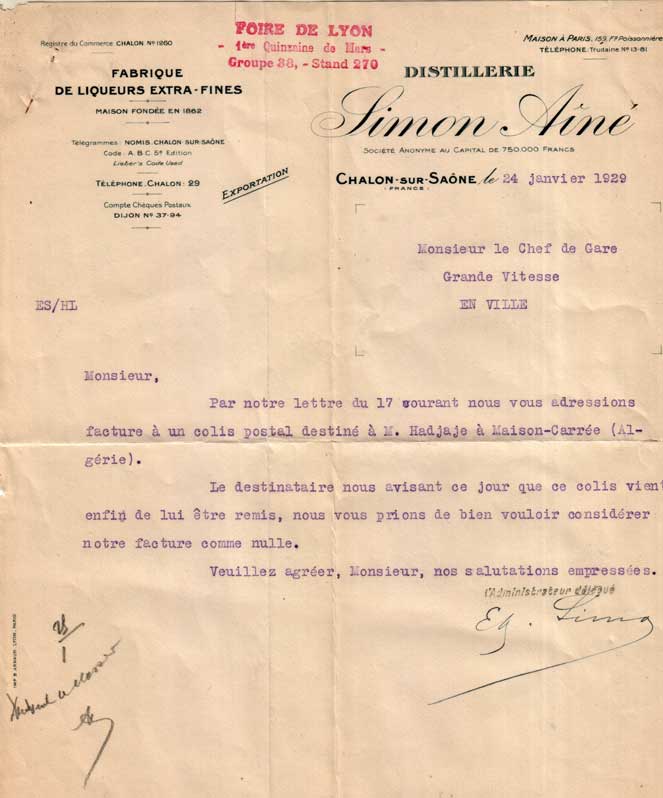
lettre de 1929, avec une nouvelle présentation, plus
simple
également signée par mon grand-père
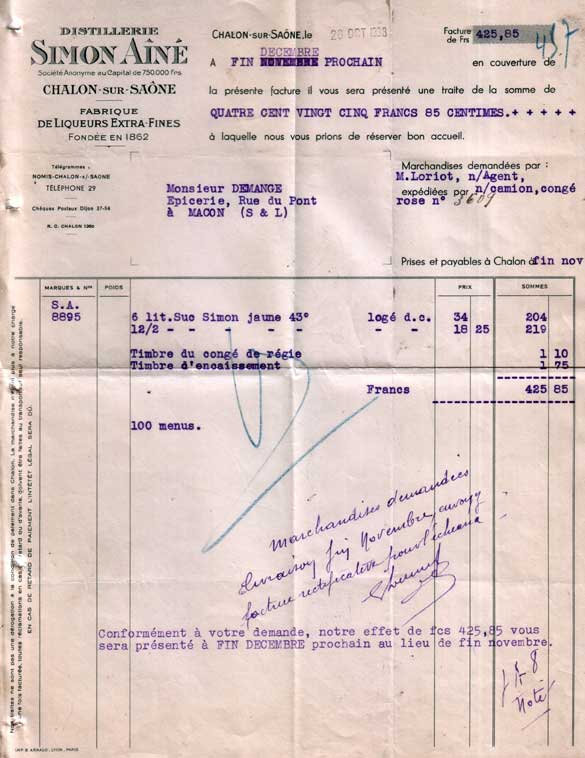
facture 1938
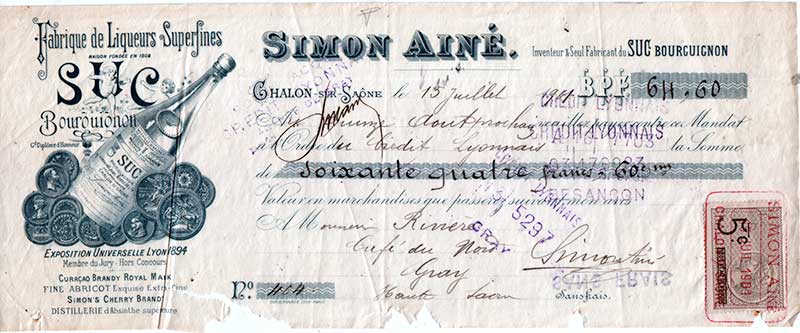
lettre de change 1901
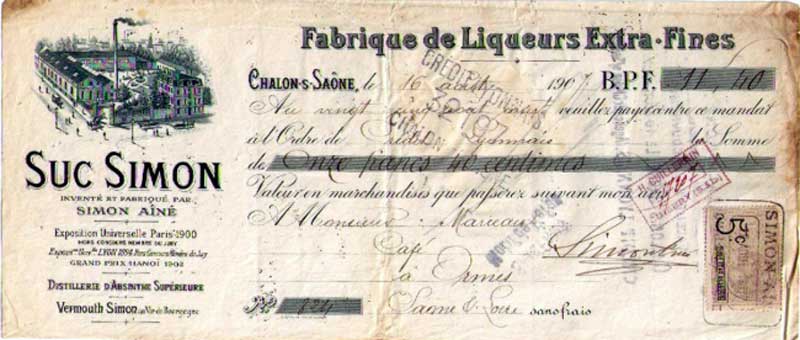
Mandat de 1907, avec la signature de Jean-François
Simon, qui signe "Simon Aîné"
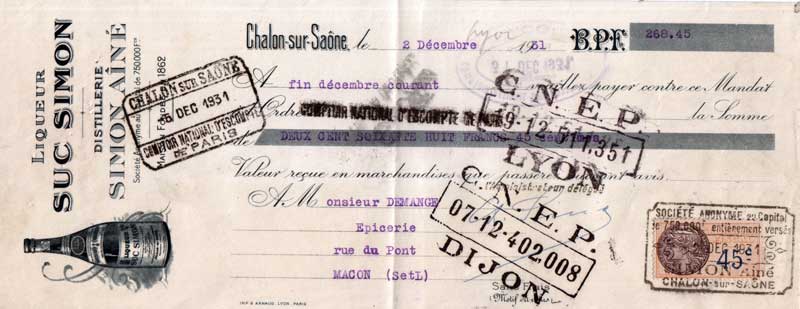
traite de 1931
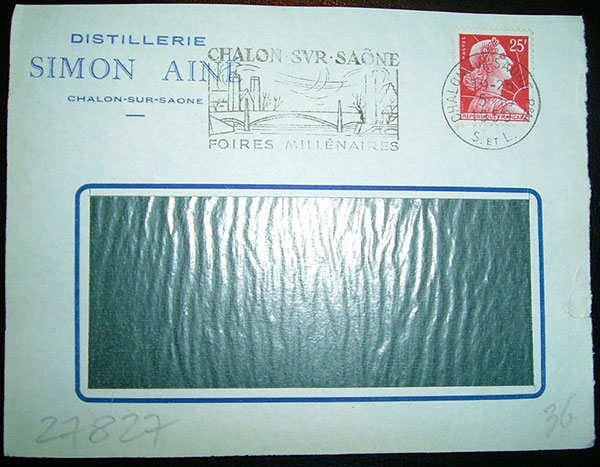
enveloppes
Cartes postales,
photographies, journaux
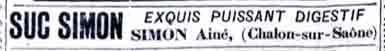 Publicité dans un
journal du 28 octobre 1902
Publicité dans un
journal du 28 octobre 1902
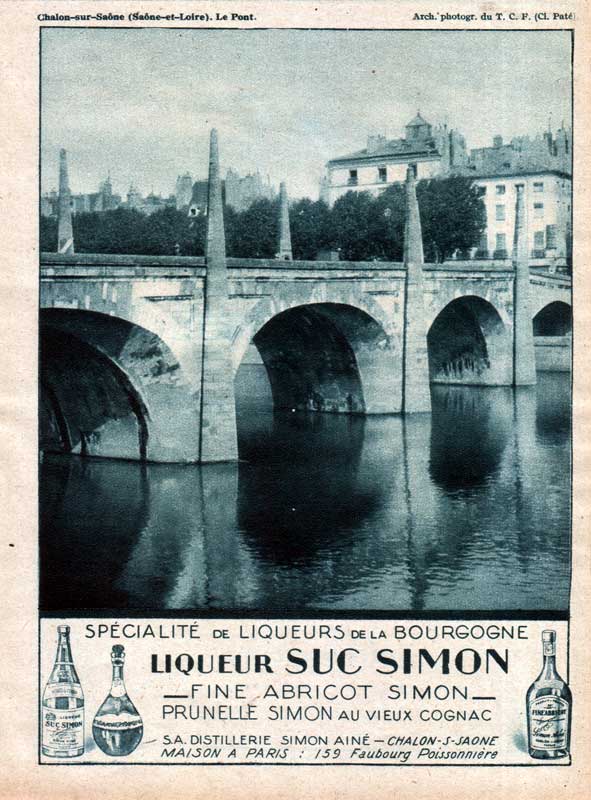
publicité dans un almanach de 1931
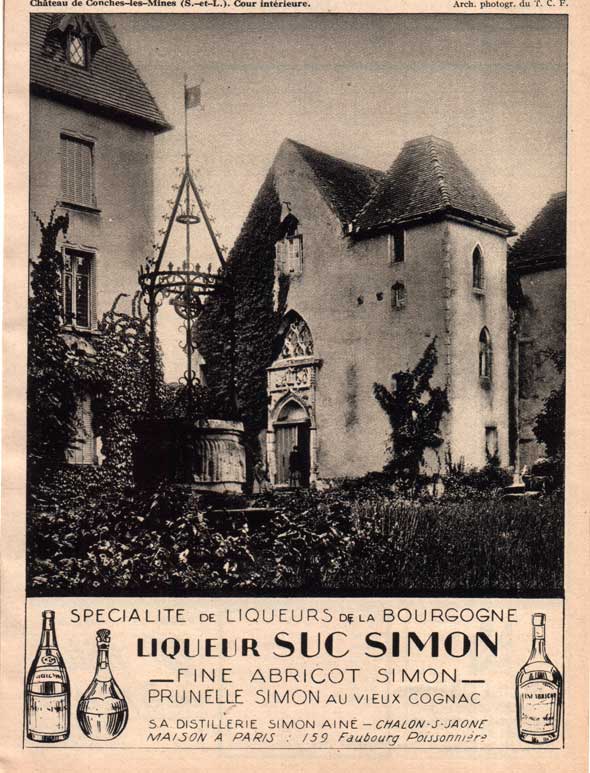
la même série en 1932
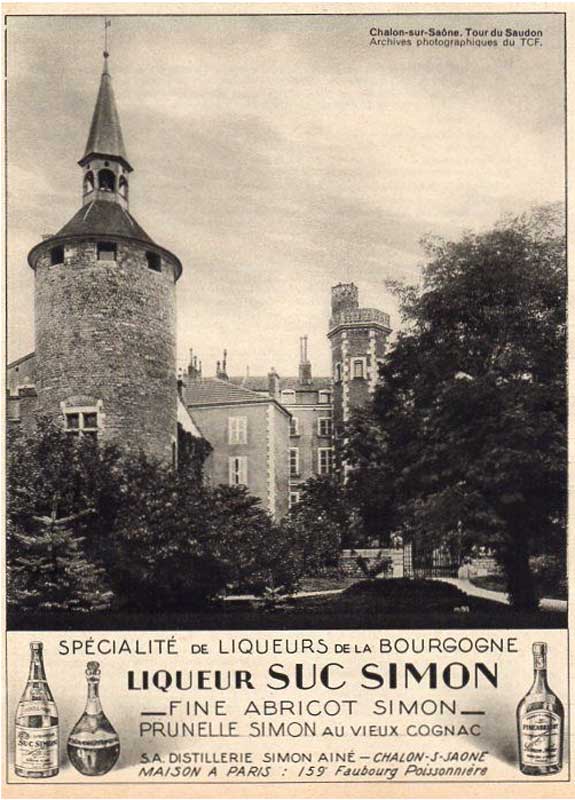
encore une, cette fois de 1930

un café vers 1900, avec une publicité pour le suc
bourguignon (telle que reproduite un peu plus loin)
(Il s'agit du café tenu par mon arrière-grand-mère
maternelle, que l'on voit sur la photo, 55 boulevard
Saint-Martin à Paris)

Sur cette photographie, que je possède mais dont
j'ignore l'origine, un autre café avec un calendrier
Suc-Simon au mur

Affiche publicitaire, à St Étienne
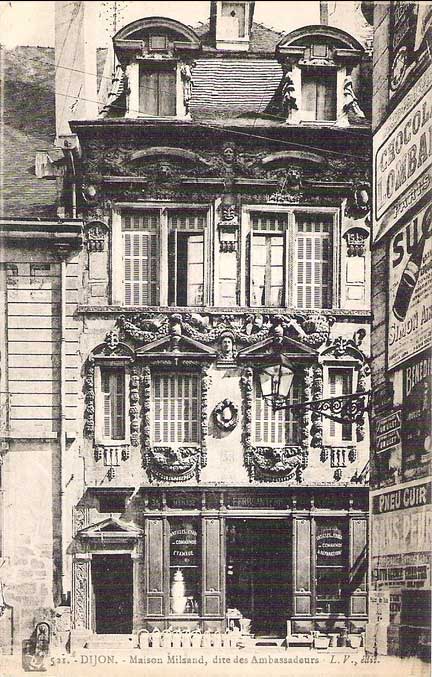
Dijon: affiche suc Simon, sur le mur de droite
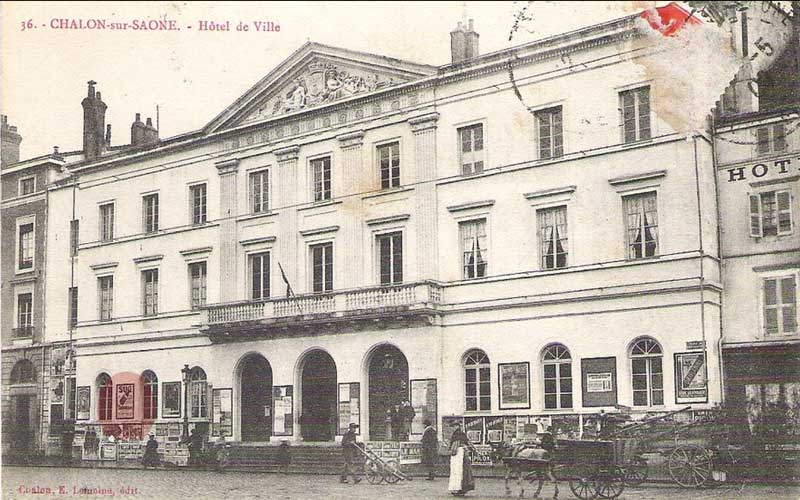


sur la mairie de Chalon-sur-Saône
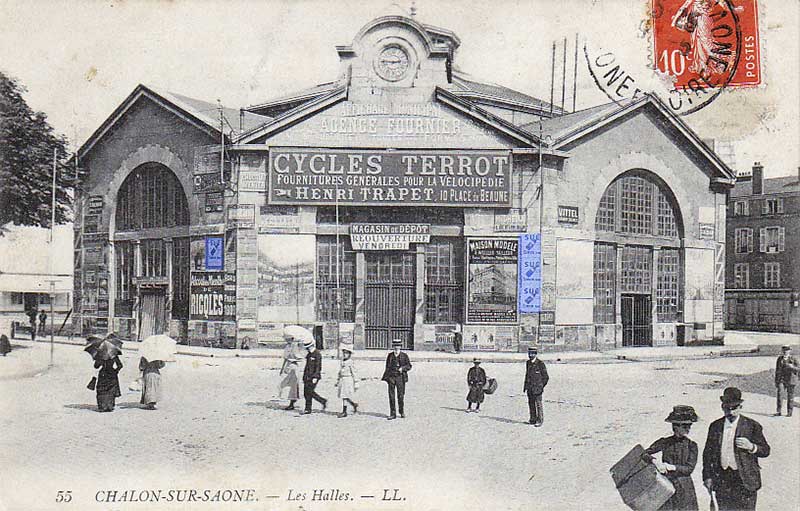
sur les halles de Chalon-sur-Saône
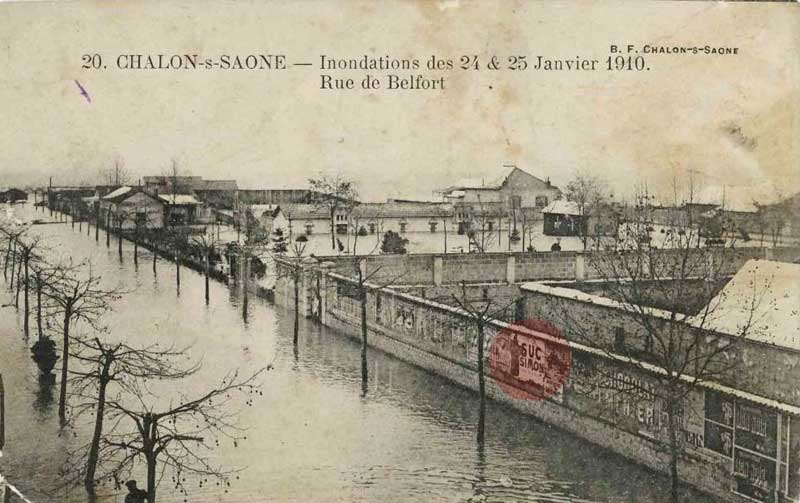
rue de Belfort à Chalon-sur-Saône, pendant les
inondations de 1910, juste derrière la distillerie

rue de l'obélisque à Chalon-sur-Saône
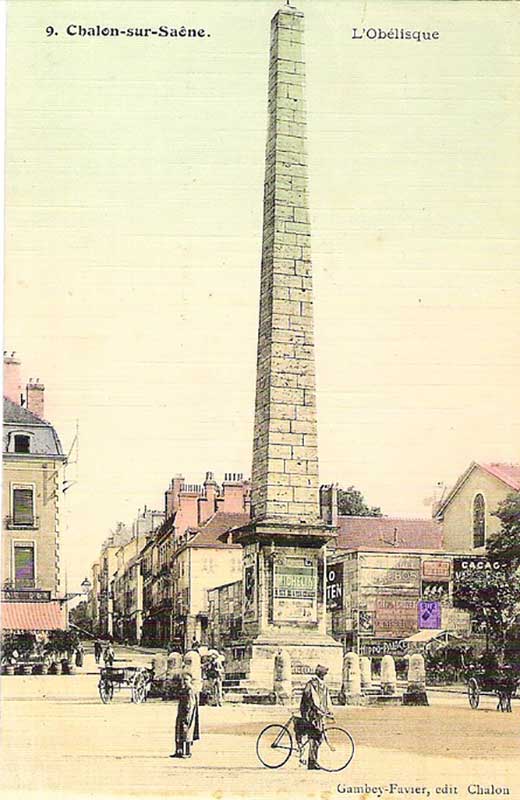
à Chalon-sur-Saône,
place de l'obélisque
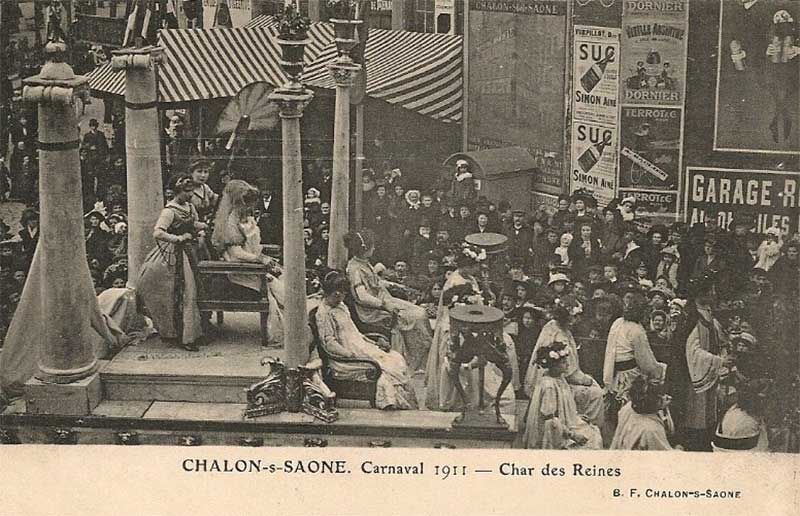
également
à Chalon-sur-Saône: carnaval 1911
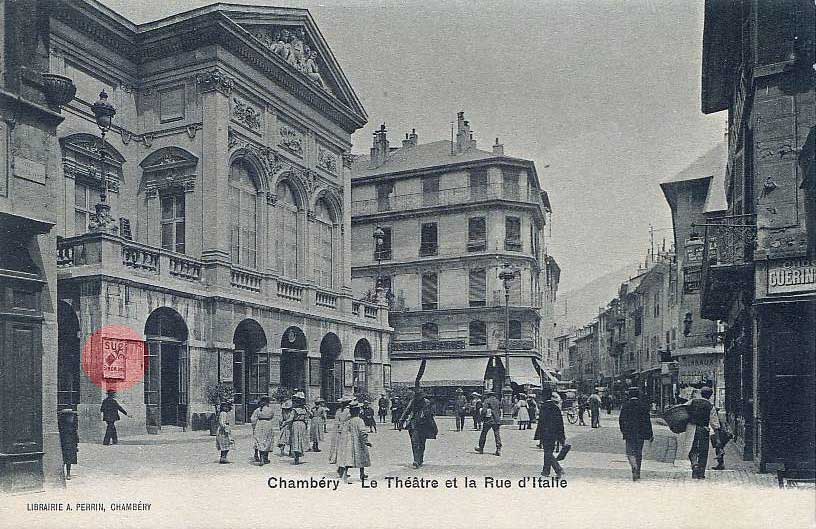
sur le théâtre de Chambéry

à Firminy


à Précy
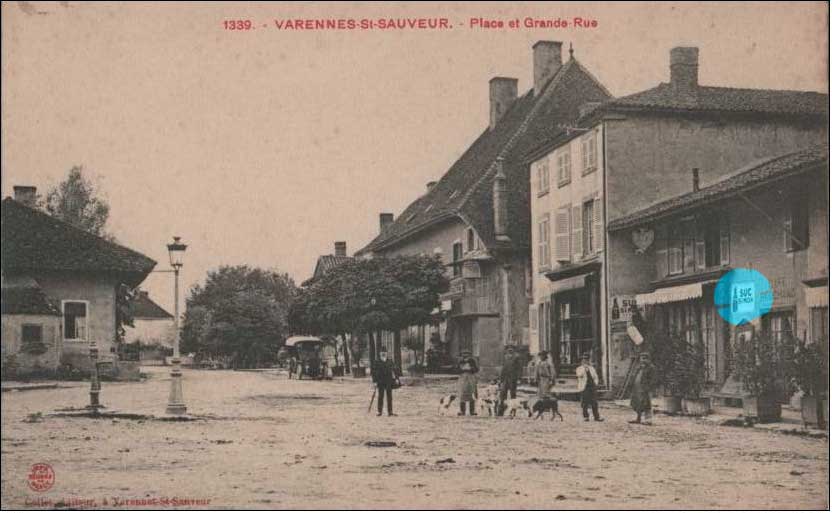

à Varennes-Saint-Sauveur
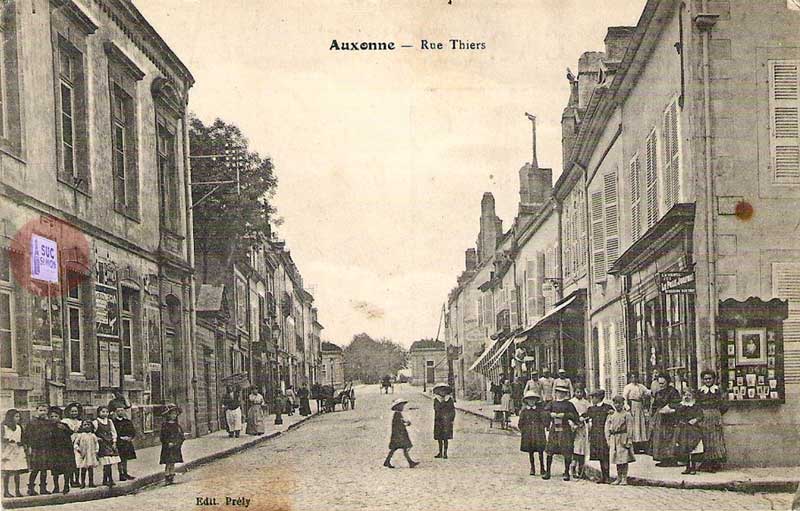
à Auxonne

à Eu, ce qui prouve que le rayon d'action en publicité
était étendu
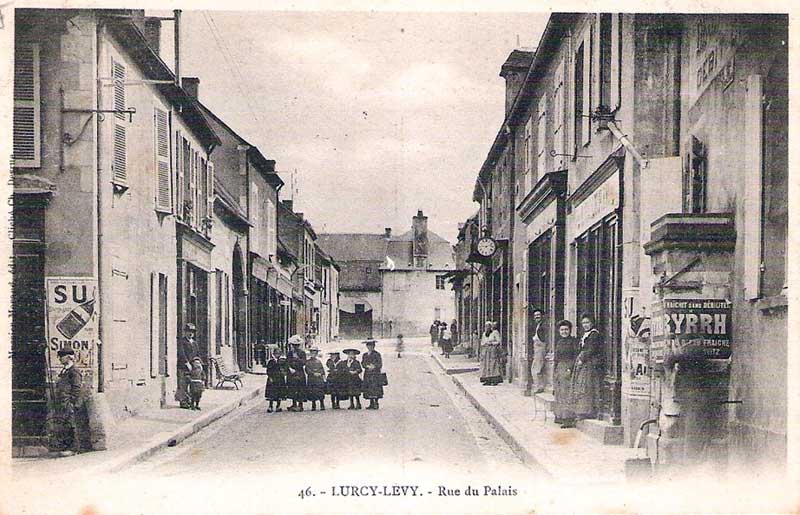
à Lurcy-Lévy

à Langres

à Cosne-sur-l'il

à Vendeuvre
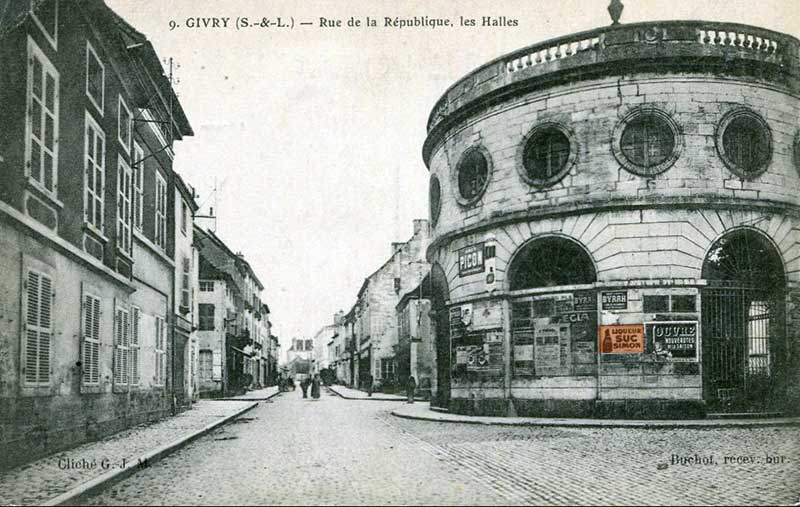
à Givry
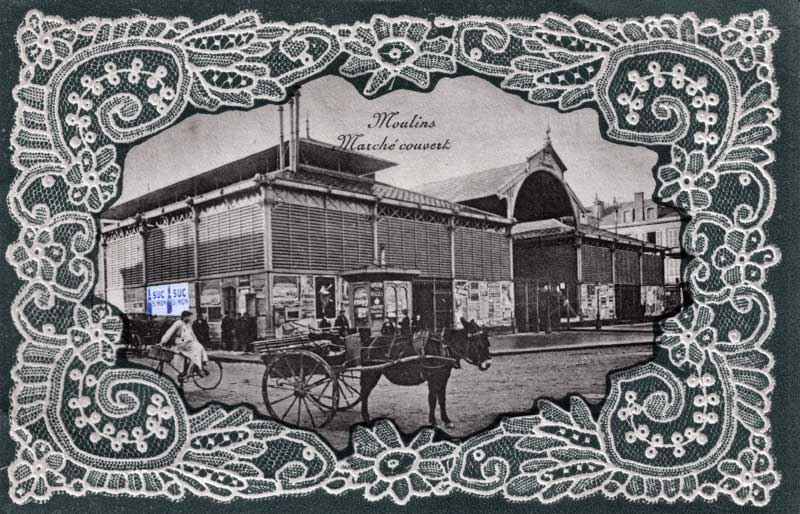
à Moulins
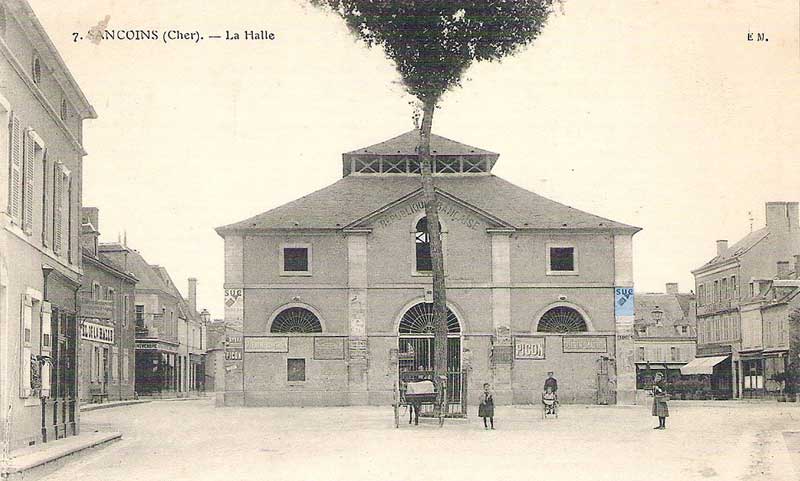
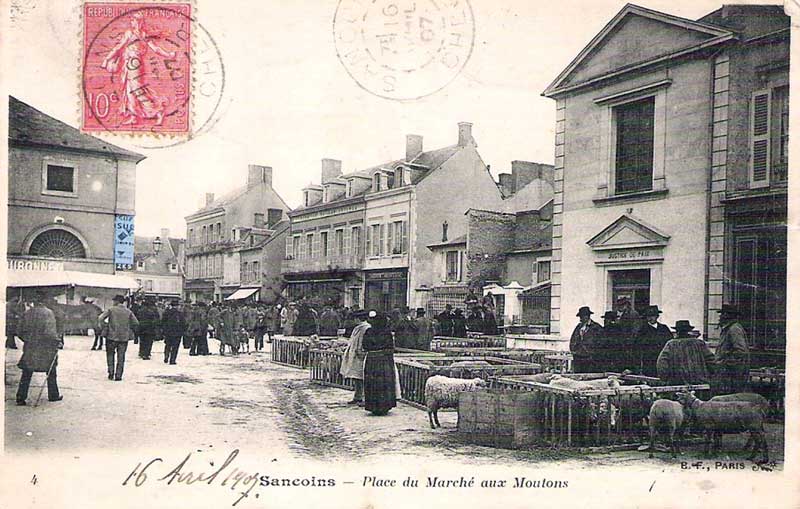
à Sancoins



à Roanne
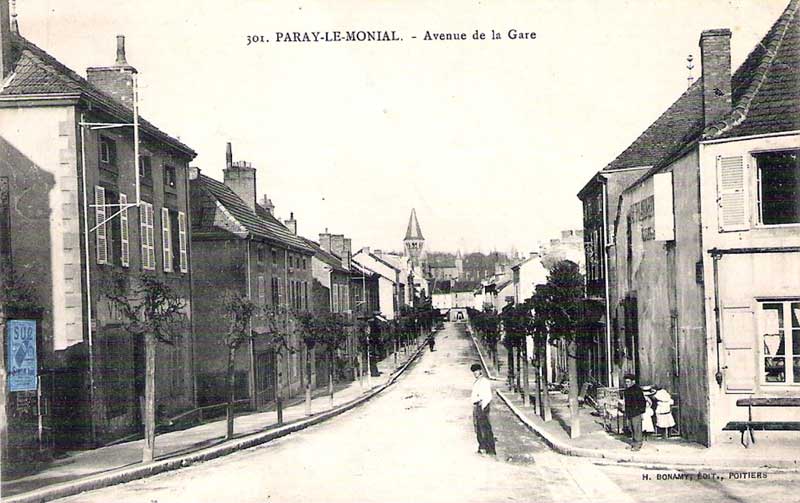
à Paray-le-Monial

à Amplepuis

à Bourges, lors des
inondations de 1910

à Autun, sur l'hôtel de
ville

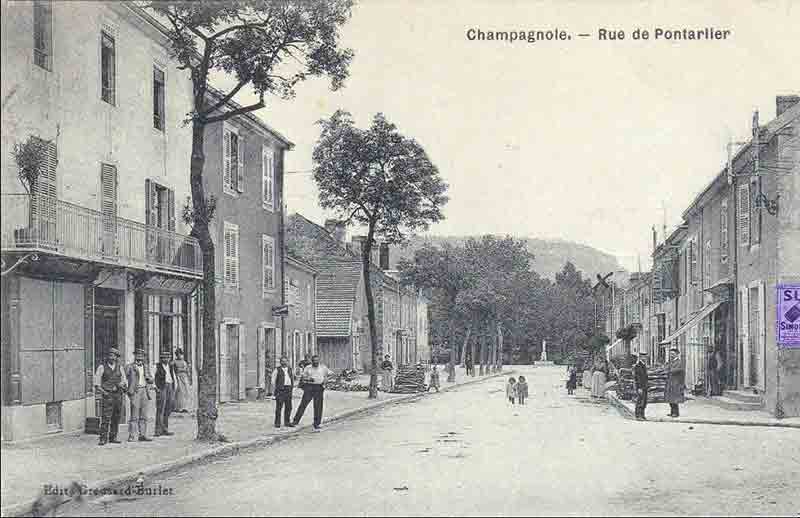

trois publicités à Champagnole

à Charolles, sur le mur
du collège

à Buxy
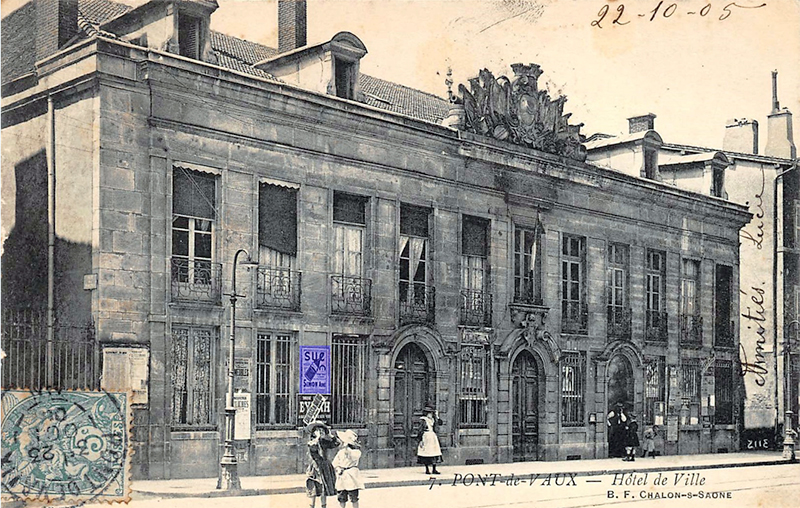
à Pont-de-Vaux

à Bligny-sur-Ouche, sur la mairie

à Bourg-en-Bresse

à Cluny

à Vernon

Gravure de Louis Coin (1895) la rue Saint-Laurent
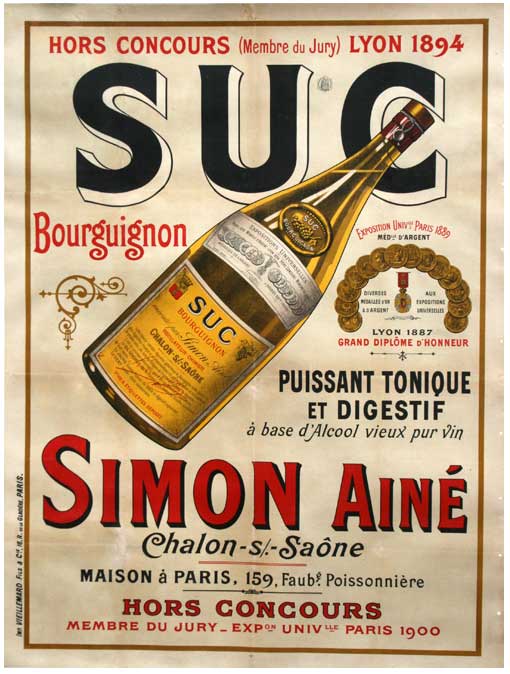
Une de ces affiches. Les collectionneurs
professionnels la datent de 1920 environ mais je
pense,
étant donné qu'il y est question de "Suc Bourguignon"
et non de "Suc Simon", qu'elle est probablement
antérieure,
le "Suc Simon" étant déjà attesté en 1904. La mention
de l'exposition universelle de 1900 en situerait
l'impression entre ces deux dates.
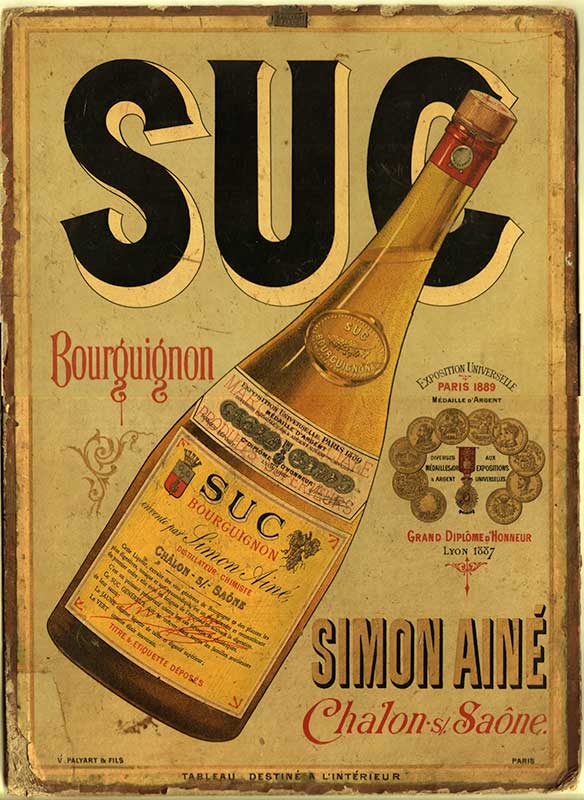
La même, simplifiée et en format réduit, pour un
affichage à l'intérieur
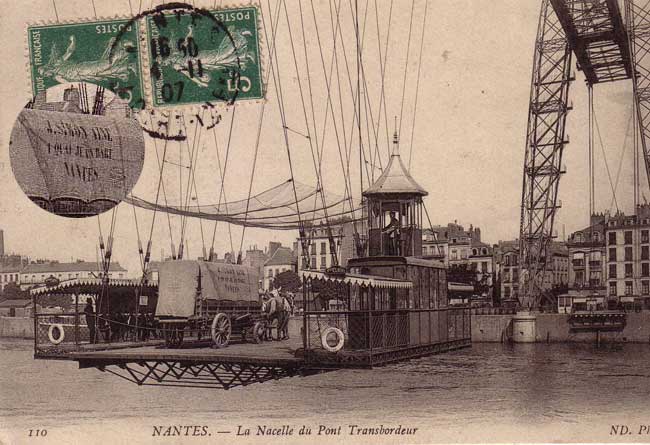
Attelage Simon Aîné sur le pont transbordeur de
Nantes
(s'agit-il de la même société? ce n'est pas certain
car aucun autre document connu de moi ne fait état
d'un établissement à Nantes
mais la société y avait peut-être un entrepôt, comme à
Marseille)

|
EXPORTATION
La production de la distillerie se vendait dans
toute la région, ainsi qu'en Suisse où elle avait un représentant
fort actif et aux USA, sous une présentation légèrement
différente, en particulier par la société "Paul Gelpi and sons",
négociants d'origine française à la Nouvelle-Orléans.
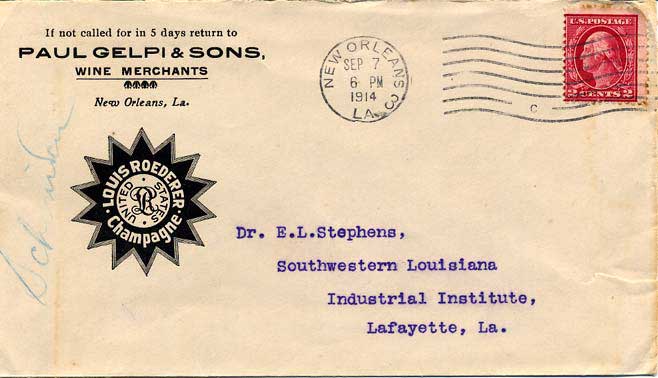
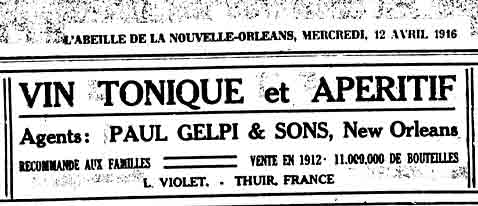
un courrier et une publicité de la société Paul Gelpi
à l'époque on parlait encore beaucoup français à la
Nouvelle-Orléans et les journaux y étaient en cette langue
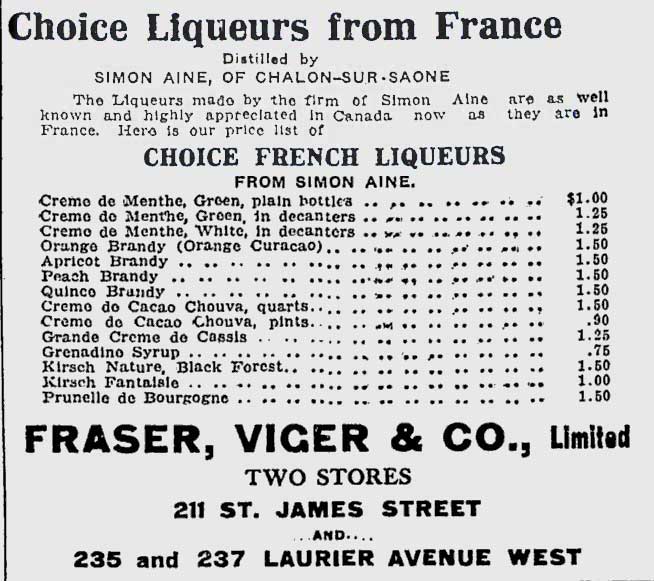
extrait du journal du dimanche, Montréal 10 août 1912
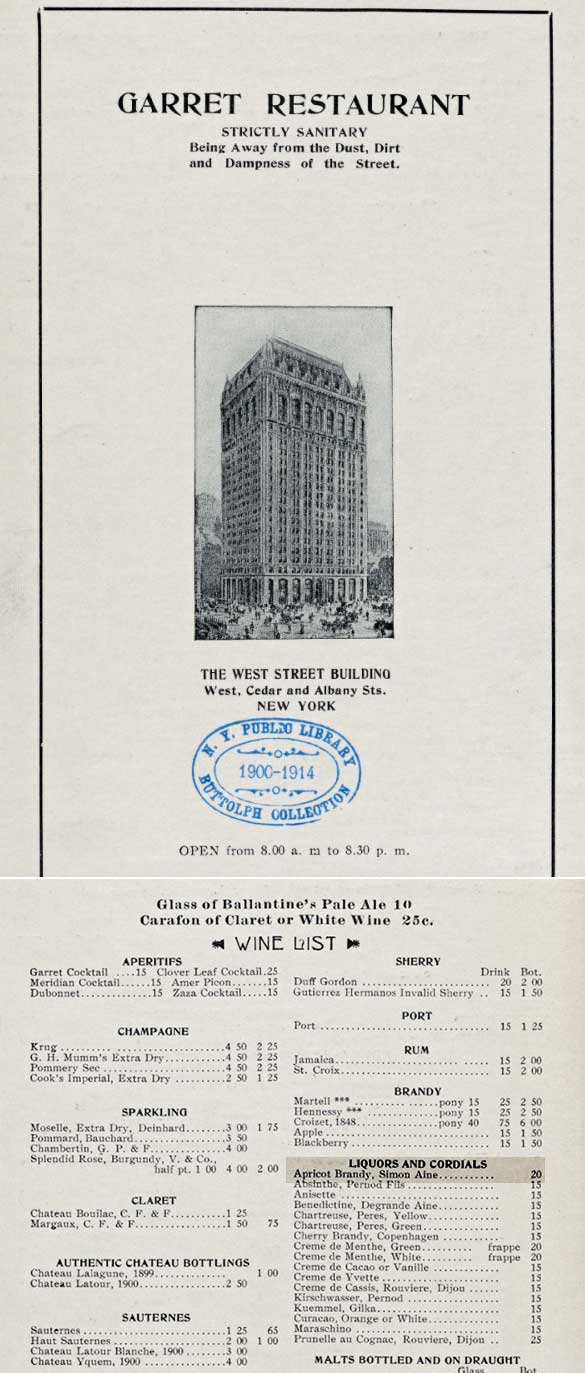
extrait de la carte des vins d'une des meilleures tables de
New-York au début du XXè siècle, le restaurant Garet
où l'Apricot brandy Simon Aîné figure en très bonne compagnie
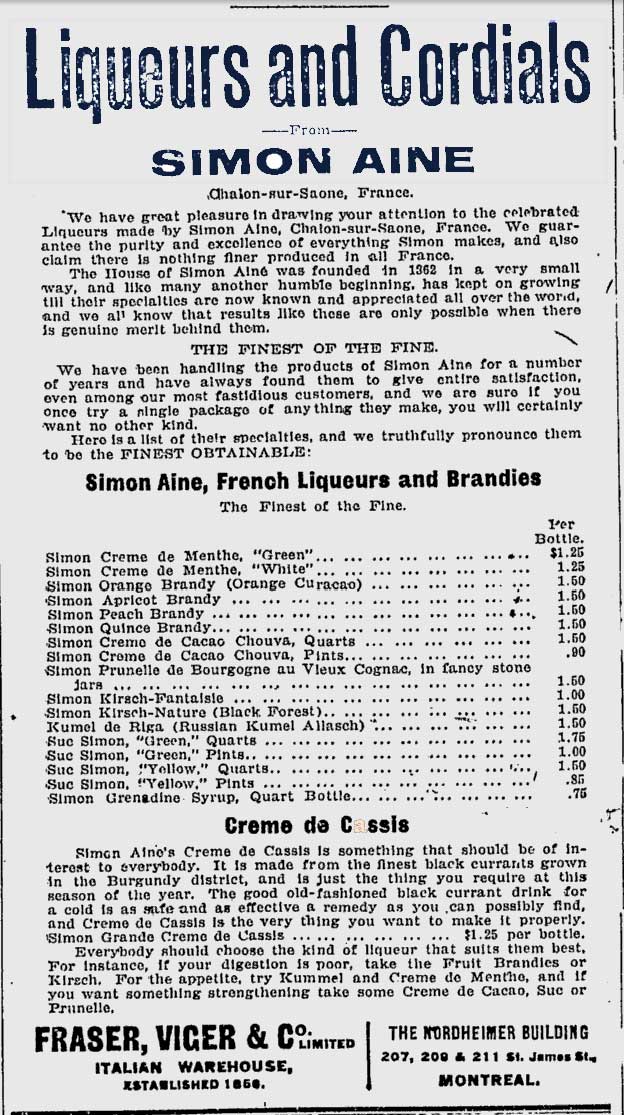
extrait du même journal en 1907
Le texte de cette publicité est intéressant. Il atteste de la
pureté et de l'excellence des liqueurs Simon. Il dit qu'il n'y a
rien de plus fin dans toute la France
et confirme que, lors de sa fondation, en 1862, la distillerie
Simon Aîné était une toute petite entreprise
qui, comme bien d'autres ayant eu d'humbles débuts, n'avait
cessé de croître jusqu'à ce que sa production soit mondialement
reconnue
et appréciée, démontrant ainsi ce qui devient possible lorsqu'on
est poussé par un réel génie.
La distillerie Chardeau à New-York
On trouve également les liqueurs Simon Aîné à
New-York où Joseph, un des fils de Jean-François se chargeait de
la commercialisation et avait créé sa propre distillerie, portant
le nom de son épouse (Chardeau).

Marie Simon, née Chardeau, en
1915 (rare photographie en couleurs, mais les Simon ont toujours
adoré les nouveautés techniques
et puis il ne faut pas oublier que la photographie a été
inventée à Chalon-sur-Saône, par Nicéphore Niépce)
Cette distillerie de New-York fut vendue à la
mort prématurée de Joseph Simon. Sa veuve revint vivre en France,
avec ses enfants et ouvrit un hôtel-restaurant à Semur en Auxois.
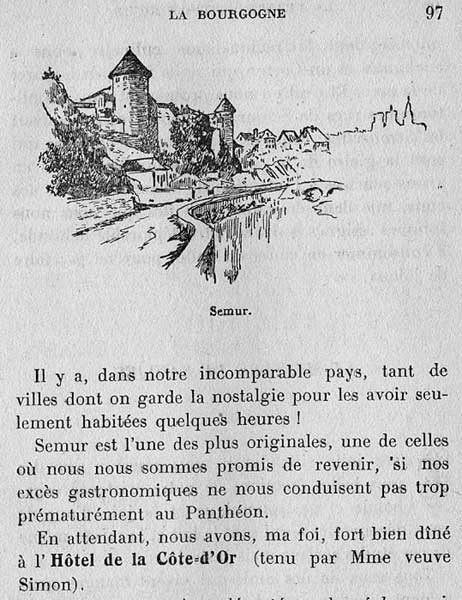
Je suppose que la distillerie fut fermée à
l'époque de la prohibition et que le terrain fut revendu car le
siège social, à mi-chemin en Manhattan et Soho, était
particulièrement bien placé. En ce qui concerne la distillerie et
la maison d'habitation il ne reste rien, les bâtiments ont été
rasés il y a longtemps pour construire le célèbre terrain de
sports de Flushing Meadows. Mais nous avons récemment retrouvé
quelques photographies de famille.
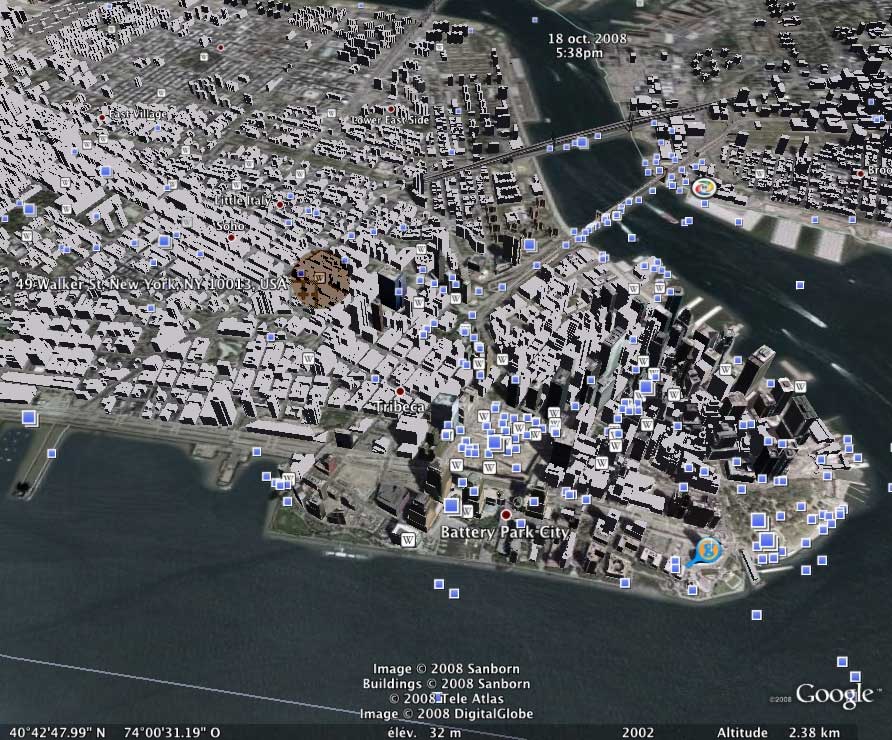
Une vue actuelle, par Google-earth
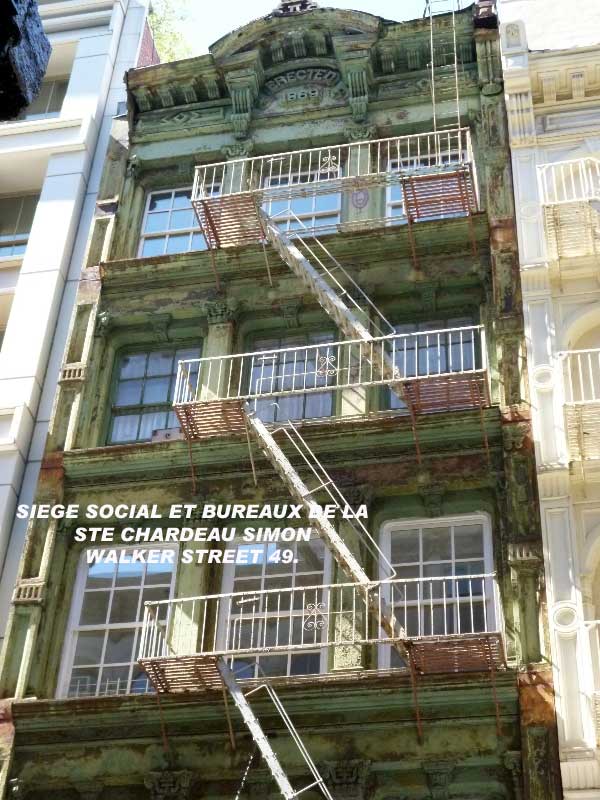 l'emplacement de la distillerie
Chardeau, Walker-Street: un monument historique pour New-York
l'emplacement de la distillerie
Chardeau, Walker-Street: un monument historique pour New-York
puisque cet immeuble a été édifié en 1869
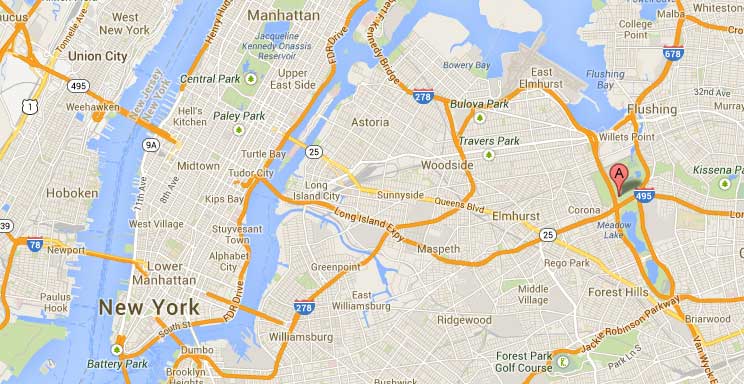 situation de la distillerie à Flushing-Meadow
situation de la distillerie à Flushing-Meadow
 traversée de la famille Simon
sur le Rochambeau, en 1903:
traversée de la famille Simon
sur le Rochambeau, en 1903:
on passait le temps comme ou pouvait, en jouant à la grenouille
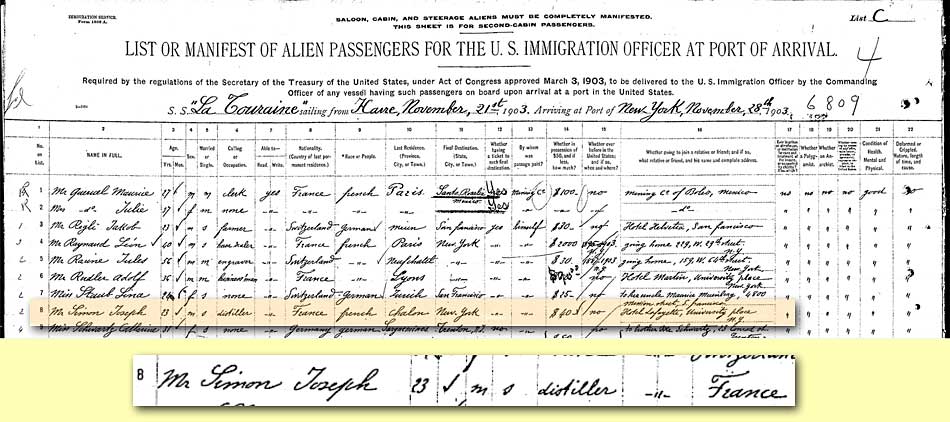
document d'immigration
de Joseph Simon - 28 novembre 1903


arrivée à la Pennsylvania
Station de New-york, qui n'a pas trop changé depuis



la maison de
Murray-Hill street à Flushing-Meadow, où la famille Simon s'est
installée
avec une vue de l'intérieur (une autre photo en couleur de 1915)

angle de Sanford avenue et de
Murray Hill street
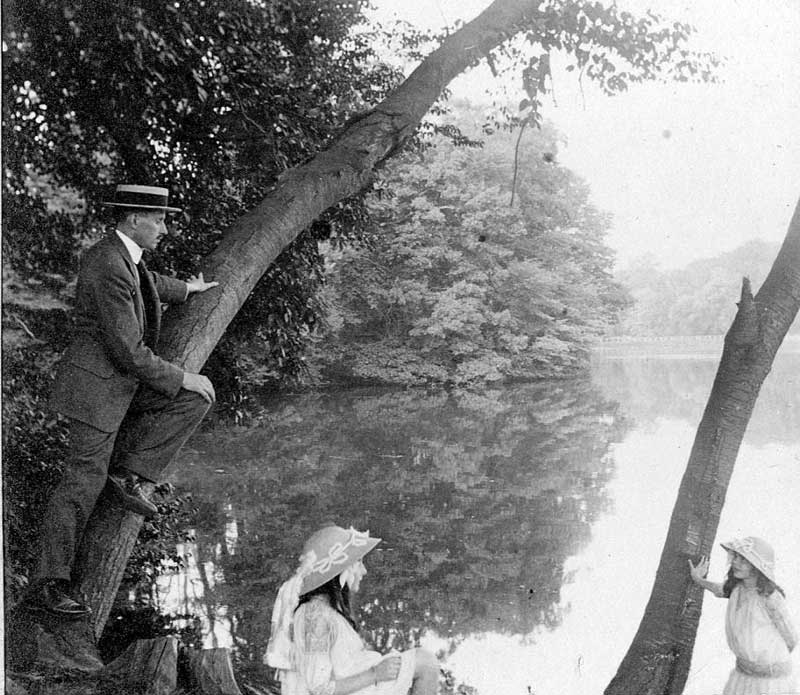
la maison se trouvait dans un
bel environnement, proche d'un lac: ici Joseph Simon est ses
filles, à proximité de leur maison

ce qui n'empêchait pas les
sorties à la plage de Rockaway, le week-end (plage qui a
certainement bien changé depuis)


deux vues de Flushing Meadow,
depuis la terrasse de la distillerie Chardeau

les employés de la distillerie
Chardeau, sur la terrasse
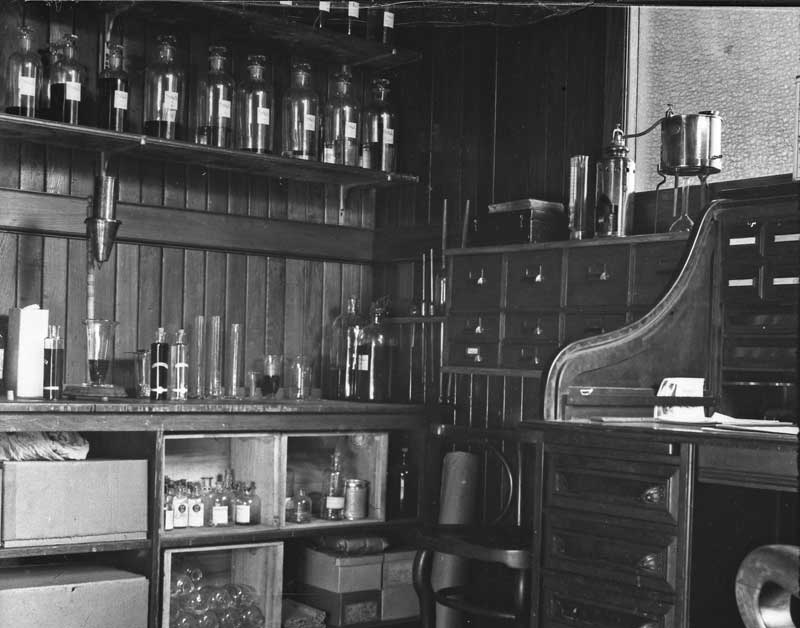
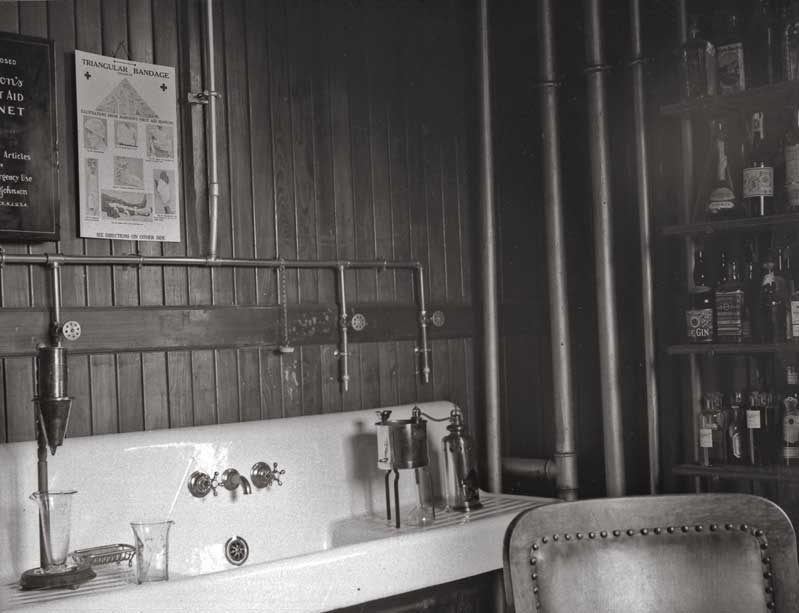
le laboratoire de la distillerie
Chardeau
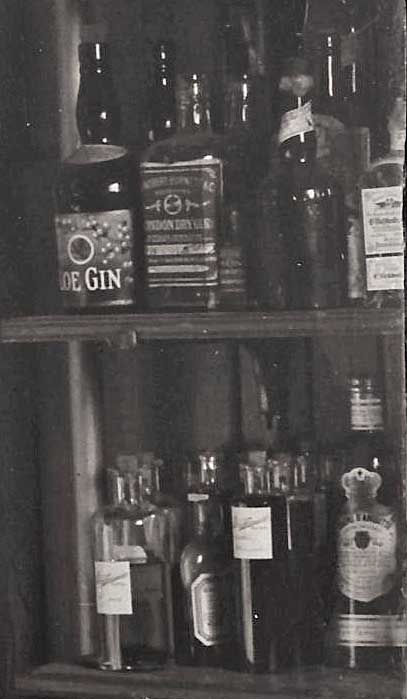
en agrandissant on peut voir quelques bouteilles (sur
la droite) dont certaines sont peut-être des produits Chardeau
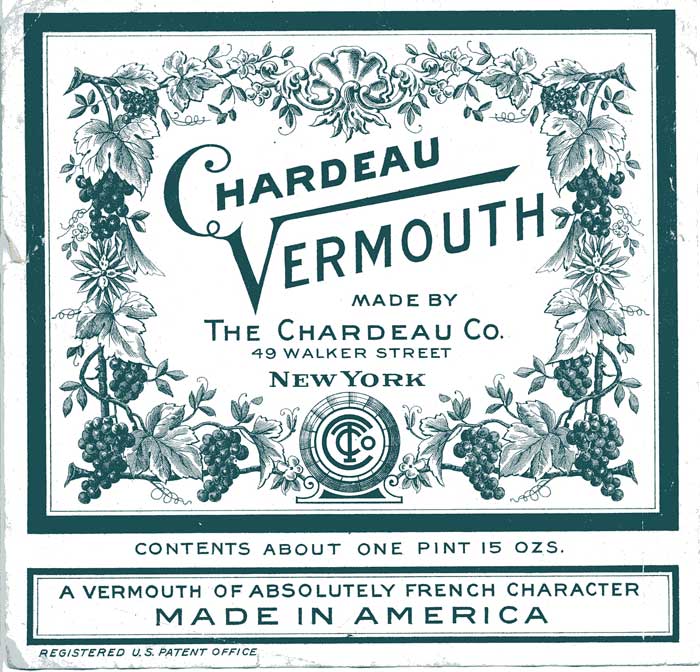
Une étiquette de la distillerie Chardeau, probablement la seule
qui reste
Autres exportations
Plusieurs courriers font état d'une activité commerciale en Pologne
et de quelques déboires avec les représentant locaux comme en
témoigne la lettre ci-dessous, signée Simon Aîné en 1909, avec une
très belle en-tête que je ne connaissais pas encore.
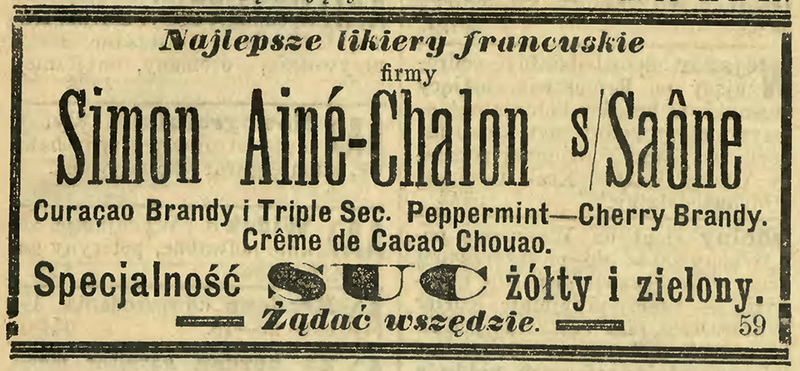
 il subsiste également quelques
publicités
il subsiste également quelques
publicités
J'ai aussi fait il y a peu l'acquisition d'un courrier de 1922,
signé par mon grand-père, par lequel il demande à un confrère des
références sur un représentant souhaitant vendre des produits Simon
Aîné en Pologne. Le marché était donc vaste.
On trouve parfois des bouteilles et cruchons étiquetés en anglais et
destinées aux USA.
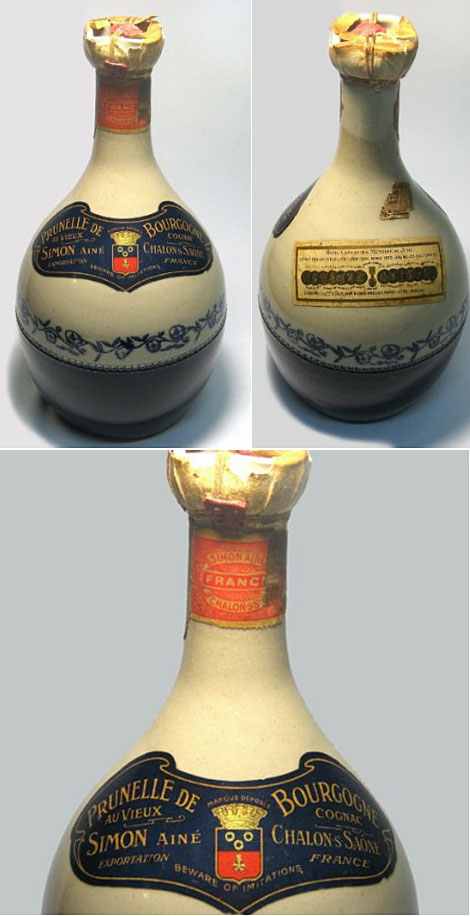
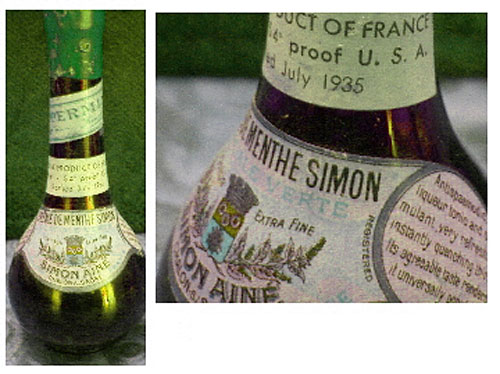
quelques produits Simon-Aîné destinés à l'importation aux USA
un cruchon de prunelle
au cognac, importé en Argentine
(curieusement le bouchon et l'étiquette ne sont pas bleus)
et un cruchon de curaçao importé aux USA
Un extrait de l'Almanak Administrativo, Mercantil e
Industrial do Rio de Janeiro - 1891 à 1940 qui signale
(curieusement classé dans les produits pharmaceutiques) un
délicieux apéritif de la maison Simon-Aîné Chalon-sur-Saône, vendu
sous le nom ravissant de "a Seductora" (la séductrice)

J'ai également retrouvé la trace d'importations en
Italie: une bouteille de fine abricot de 1940 (comme quoi la
guerre n'empêche pas le commerce...):


ÉPILOGUE
Lorsque mon arrière-grand-père Jean-François
Simon, fondateur de la distillerie est décédé, il laissait
derrière lui 12 enfants. Pour faciliter la succession une société
fut créée (en 1911), dont les enfants se partagèrent les actions.
Mon grand-père Étienne Simon, qui était l'aîné, en devint le
directeur.

Mais Étienne n'eut que des filles (à l'époque il
était pratiquement inconcevable qu'une femme occupât un poste de
direction, bien que certaines de ses surs aient laissé le
souvenir de femmes brillantes) et ses jeunes frères avaient été
destinés à d'autre tâches: Joseph avait été envoyé aux USA
représenter la société; Francisque fit de même à Leipzig (ville
réputée pour ses grandes foires), avant de travailler en Ile de
France (voir l'en-tête de lettre ci-dessus, où l'adresse de la
distillerie est à Aubervilliers); Pierre le plus jeune, faisait
l'objet de tous les espoirs. C'est lui qui détenait les (précieux)
secrets de fabrication et il aurait volontiers vu son fils,
également prénommé Jean-François, en "repreneur de l'enseigne".
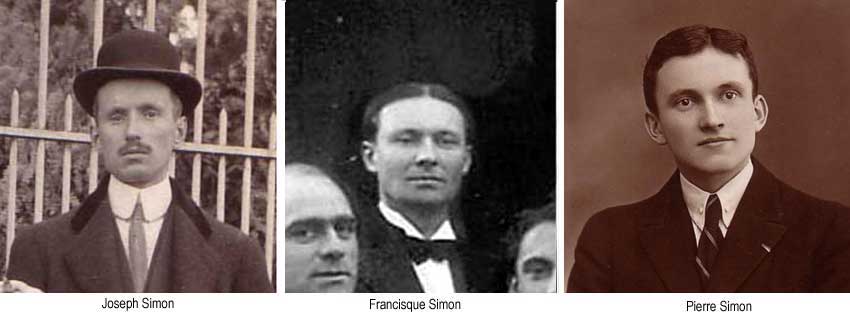
Deux des gendres furent également appelés à
collaborer: Auguste Loisy en Ile de France et Laurent Pelletier
comme représentant.
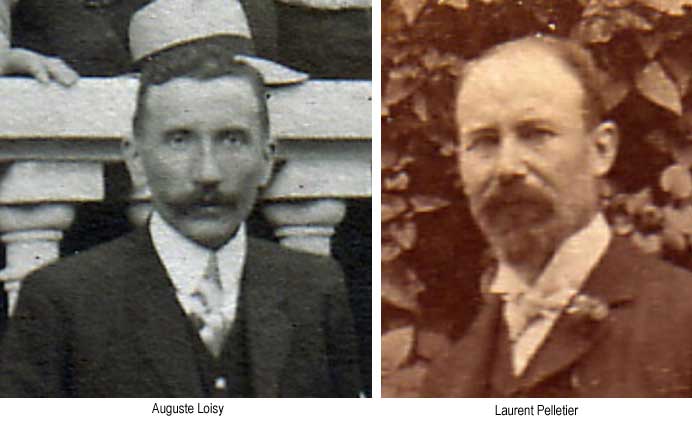
Dans les années 50, la distillerie qui commençait
à avoir des problèmes financiers a diversifié sa production,
obtenant un contrat pour l'embouteillage des jus de fruits de la
marque "Orangina" pour une partie de la France, comme l'atteste la
facture ci-dessous, émise en 1957.
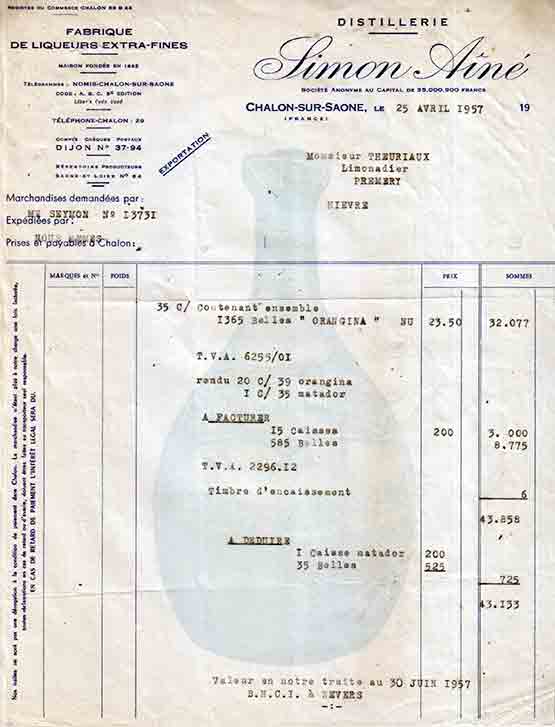
Cela n'a toutefois pas suffi à sauver
l'établissement, face à une concurrence et une industrialisation
de plus en plus fortes et, il faut bien le dire, du fait d'une
gestion à l'ancienne, peut-être un peu laxiste et dépensière,
ainsi que d'une recherche de qualité, de plus en plus inadaptée au
marché et aux exigences de la vie moderne. À cela sont venues
s'ajouter des malversations de la part d'un employé (voir
ci-dessous) qui ont largement contribué à "couler" l'entreprise.
Étienne Simon ne prit donc sa retraite qu'à un âge avancé. D'après
ce que j'ai entendu dire (mais j'étais encore enfant), il n'aurait
pas su discerner à temps les signes avant-coureurs alarmants
relevés par ses banquiers, dûs à des dépenses excessives. Puis un
mauvais contrôle des actions aurait amené la famille à perdre la
majorité dans la société, au profit d'une firme concurrente de
Dijon. La coupure de presse que je reproduis ci-dessous, donne les
tristes circonstances dans laquelle la distillerie a déposé son
bilan. Notre famille y a perdu un bien précieux, tout comme les
nouveaux actionnaires dijonnais (d'après les souvenirs d'une
cousine, il s'agirait essentiellement de membres de la famille Lejay-Lagoute dont la
liqueur de cassis est plus ancienne de la société Simon-Aîné,
puisqu'elle aurait été inventée en 1841/
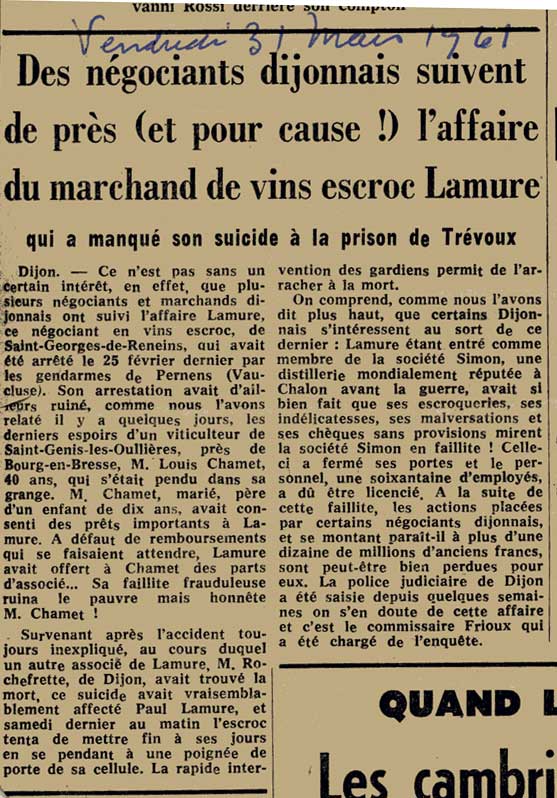
C'était en 1959. Mon grand-père est décédé dans
l'année. On lui avait laissé la disposition de la maison, jusqu'à
sa mort: on savait vivre en ces temps là. Je pense, en fait,
que la maison avait été la propriété de la société Simon-Aîné,
puis qu'elle avait été mise en vente lors de la liquidation, sans
trouver acquéreur. Ce n'est que plus tard, après l'incendie des
ateliers, qu'elle a été rasée pour faire place à des logements et
des commerces.
J'ai récemment déniché toutefois une facture de
la distillerie Simon-Aîné datée du 22 mars 1960 ce qui prouve que,
avant d'être liquidée, la société a dû être placée en redressement
judiciaire et conserver quelques activités (ou liquider ses
stocks) après 1959
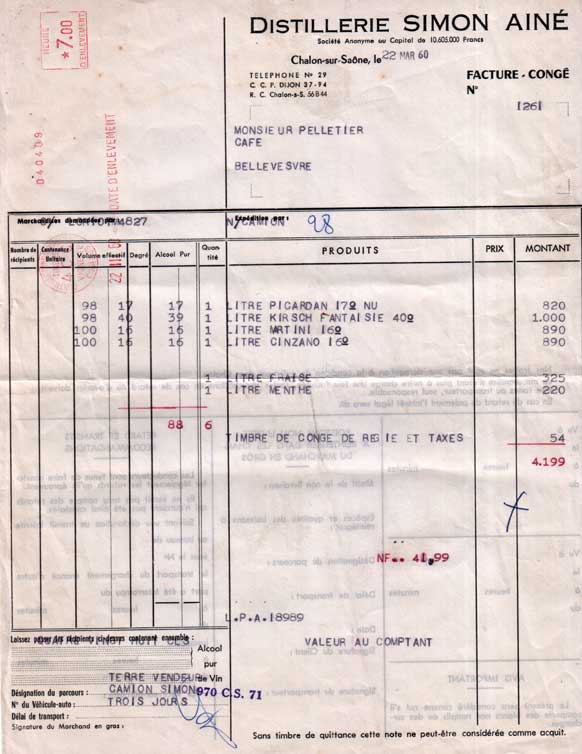
Il ne reste plus à la famille que la marque et
les "secrets" de fabrication (ils sont pieusement conservés par un
cousin) qui pourraient peut-être un jour, qui sait, redonner vie à
ces merveilles qu'étaient les liqueurs Simon-Aîné.
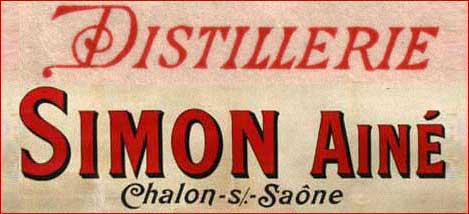
 un clin d'il pour terminer:
un clin d'il pour terminer:
un beau tag dans mon quartier, sur le rideau d'un café!
Le produit a cessé d'exister, mais la pub (involontaire) est
bien vivante.